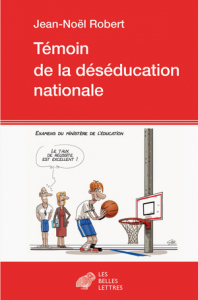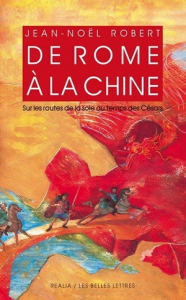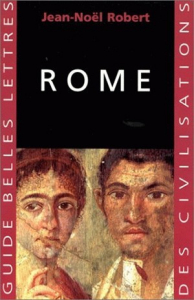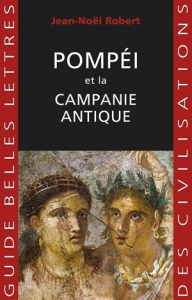Entretien La vie des classiques avec Jean-Noël Robert, suite à la parution de son livre L’agonie d’une république. La violence à Rome au temps de César (Les Belles Lettres, 2019).
Comment vous présenter ? Quelles ont été les rencontres déterminantes de votre formation ?
Mon histoire personnelle ne présente guère d’originalité. C’est celle d’un étudiant en lettres classiques, attaché aux langues anciennes depuis la 6e et qui en a poursuivi l’étude en classe préparatoire jusqu’aux concours et à la recherche. C’est aussi celle d’un enseignant qui a toute sa vie été enthousiaste à l’idée de transmettre ce que j’ai toujours considéré comme les fondements de notre culture et de notre civilisation. Certains maîtres m’ont fortifié dans cette voie, tant par leur enseignement lumineux que par leur science et l’aide qu’ils m’ont apportée. Je pense particulièrement à l’étruscologue Alain Hus (ainsi qu’à Raymond Bloch à l’EPHE), et à Pierre Grimal, sans oublier les heures claires passées sous l’autorité de Madame de Romilly, en particulier à Ulm dans l’exercice de la traduction d’Euripide.
Mais il faut ajouter un autre centre d’intérêt qui m’a permis de mieux cerner les bases de notre civilisation, c’est celui porté aux autres civilisations et particulièrement à celles de l’Asie, un continent maintes fois parcouru, parfois dans des conditions difficiles (je pense aux expéditions ethnologiques effectuées par exemple chez les Papous voici plus de trente-cinq ans, ou chez les Mentawai, à un moment où les explorateurs se hasardaient dans leur jungle de Siberut, sans oublier, entre bien d’autres, les Toraja des montagnes à une époque où ils n’avaient encore jamais vu de blancs, ou le peuple himalayen du Spiti…). Tous ces voyages n’avaient, et n’ont toujours pour moi, qu’un objectif : celui de rencontrer des hommes dont les mœurs si différentes des nôtres permettent de remettre en cause nos certitudes, et de comprendre ainsi ce qui fait notre humanité. Cette réflexion nourrit un humanisme qui demeure, même à l’heure de ma retraite d’enseignant, le but ultime de mon existence.
Enfin, même s’il est impossible de tout mentionner, je me dois d’évoquer la musique que j’ai beaucoup pratiquée et qui m’a toujours accompagné tout au long de ma vie. La musique est un langage plus sensible et plus intime encore que celui qui s’exprime par les mots, un langage plus que beaucoup d’autres en quête d’humanité. L’opéra est pour moi essentiel dans ma formation et continue de m’ouvrir la voie de l’âme humaine.
Quelle a été le premier texte latin et grec que vous avez traduit/lu ? Quel souvenir en gardez-vous ?
De mes premières années de latin et de grec, je retiens surtout la découverte de l’histoire à travers des pages de Tite-Live ou de Thucydide, ainsi que l’émerveillement causé par la lecture des tragiques grecs. Un vers de l’Antigone de Sophocle est resté gravé dans ma mémoire comme une devise qui, selon moi, pourrait peut-être être méditée par certains de nos supposés « grands hommes » (et femmes !) : « Je ne suis pas né pour haïr, mais pour aimer ».
Vous avez consacré une grande partie de votre vie à l’histoire romaine. Comment est née la passion ? Et comment avez-vous « entretenu la flamme » ?
Je me suis souvent demandé comment avait pu naître « la passion » pour les langues anciennes dont vous parlez. De mon temps (comme aiment dire les vieux), au lycée, nous traduisions un texte et, lorsque nous arrivions à la fin, nous passions à un autre. Qu’avions-nous réellement compris ? Quasiment rien, faute d’un commentaire éclairant, du texte lui-même et du contexte, pour en extraire « la substantificque moelle ».
Mais, depuis toujours, j’ai cherché à répondre à la question « pourquoi ? ». C’est, paraît-il, une question que posent les enfants en bas âge et, de ce point de vue, je me sens toujours jeune ! Sans le savoir, j’étais déjà pénétré du vieux proverbe latin «Ad nova per vetera », et je souhaitais comprendre comment nous en étions arrivés là où nous sommes. La réponse m’a toujours paru devoir davantage être trouvée du côté des Romains plus que des Grecs dont nous sommes plus éloignés. C’est d’ailleurs par les Romains que nous ont été transmises « les beautés de la Grèce » (comme disait G. Boissier). D’où mon intérêt pour comprendre le fonctionnement et, surtout, la mentalité de la société romaine. Car, trop longtemps, l’étude des mentalités a été, sinon ignorée, du moins considérée comme mineure, ce qui a induit des erreurs d’interprétation, heureusement corrigées par notre époque récente. Voilà ce qui justifie mon intérêt pour les plaisirs, les modes, la morale sexuelle, la vie à la campagne (car Rome ne se résume pas à la seule Ville, capitale du monde). Mon intérêt pour les civilisations asiatiques m’a encore conduit à mettre mieux en lumière les rapports entre le Far-West et le Far East mille ans avant Marco Polo. Mais toujours avec un souci de vulgarisation (que je voudrais dans le meilleur sens du terme) afin de permettre tant aux étudiants qu’aux amateurs éclairés, de pénétrer nos antécédents historiques afin de mieux comprendre ce qui a fait notre monde d’aujourd’hui. Mon travail se présente donc d’abord comme humble et bien modeste en regard de celui des savants qui continuent de nous guider dans la voie de la recherche.
Aujourd’hui, vous publiez un ouvrage sur la violence et la fin de la république romaine : pourquoi ce choix ?
Le dernier siècle de la République romaine (assurément l’un des plus célèbres de la longue histoire de Rome) que l’on date traditionnellement de l’époque de Tiberius Gracchus à la victoire finale d’Octave sur Antoine et à l’instauration du principat (qui n’est autre qu’une forme de monarchie), est un moment très intéressant à plus d’un titre. C’est en effet le siècle pendant lequel va se déliter inexorablement un régime assez original que des hommes dotés d’un caractère fort ont mis des siècles à édifier et à conforter. La République romaine se caractérise par une valeur que tous revendiquent : la liberté, c’est-à-dire le fait, pour les citoyens, de ne dépendre d’aucun tyran (au sens grec du mot), d’aucun maître, mais de la loi, assurant ensemble selon des règles communes le fonctionnement de l’État. Évidemment, la réalité est moins idyllique, et les citoyens savaient très bien de cette égalité n’était qu’un mot. Cependant ils acceptaient cet état de fait dans la mesure où le statut de citoyen libre était respecté. La grande crainte des hommes de la République était de se trouver de nouveau assujettis à un roi. Comment un engrenage fatal a-t-il conduit ce régime qui fera plus tard l’admiration et suscitera l’intérêt de nos ancêtres au XVIIIe siècle à sombrer au point de renier les valeurs qui l’avaient nourri ? Quant à la violence – et nous rejoignons là l’histoire des mentalités – il ne faut pas se tromper sur la définition du mot à l’époque. La vie à Rome était d’une violence inimaginable pour nous aujourd’hui. Elle était quotidienne et omniprésente dans tous les aspects de l’existence d’un Romain, et pas seulement dans les spectacles. Se promener dans la rue exposait les passants à des risques majeurs à chaque instant. Mais cette violence faisait partie du quotidien et chacun l’acceptait comme une norme. Ce que les Romains ne pouvaient supporter, c’est la transgression de cette norme, notamment quand les règles sociales et politiques étaient bafouées au point d’en venir à la guerre civile, c’est-à-dire quand des citoyens combattaient contre leurs propres concitoyens. C’est cette désagrégation du tissu social qui m’a intéressé.
Dans un récit chatoyant et passionnant, vous proposez un livre noir de la République romaine, pourquoi ?
Peut-on parler d’un livre noir ? Je ne sais sinon que cette chute inexorable d’un régime qui avait permis l’établissement d’un empire fort sur l’ensemble de la Méditerranée pose question. J’ai voulu alterner dans ce livre des chapitres d’analyse et des récits fondés sur les auteurs anciens (ce n’est donc pas du roman, même si nous savons que les Anciens édulcoraient parfois la réalité ou la noircissaient). Ces récits ont pour fonction de restituer quelque chose de l’atmosphère de ces heures tragiques.
Peut-on en tirer des leçons pour notre époque ?
La tentation est toujours grande d’établir des ponts entre les périodes de l’histoire et de chercher dans le passé des prédictions pour l’avenir. C’est bien entendu une erreur à éviter. Les contextes sont totalement différents, ainsi que les situations. Tout au plus demeurent les réactions humaines. La haine, la jalousie, et surtout l’ambition demeurent une constante quelle que soit l’époque. Mais l’histoire ne se répète pas même si elle donne parfois l’impression de bégayer. Cependant l’analyse d’une époque historique tragique comme celle de la fin de la République romaine peut servir la réflexion et, comme le disait si bien Valéry, « L’histoire, je le crains, ne nous permet pas de prévoir ; mais associée à l’indépendance de l’esprit, elle peut nous aider à mieux voir ». A chacun, à partir de cette histoire, de nourrir sa propre réflexion.
S’il fallait retenir un enseignement de votre livre ce serait lequel ?
Tout d’abord, je ne pense pas qu’un livre d’histoire soit manifestement porteur d’un message pour les hommes d’aujourd’hui. Cependant il est indéniable que l’agonie de la République romaine offre un intéressant sujet d’étude, notamment sur la fragilité de la paix, sur l’ambition des hommes de pouvoir et sur la difficulté de préserver la liberté, quel que soit le sens qu’on donne aux mots, puisque la liberté revendiquée aujourd’hui n’a pas le même visage que celle défendue par Brutus (pour ne parler que de lui). Ce sont des valeurs que nous croyons bien établies, oubliant que nos ancêtres ont parfois donné leur vie pour arriver à les imposer, et qu’il ne nous semble pas toujours nécessaire de les défendre encore et encore. Gare aux illusions !
Dans la même chronique

Entretien ludopédagogique avec Claire van Beek

Entretien apocalyptique avec Jean-Louis Poirier et Hubert Le Gall
Dernières chroniques

Marches Légères / Itinera Levia – Sentiers