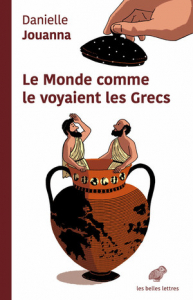A l'occasion de la parution de Le Monde comme le voyaient les Grecs, Danielle Jouanna a accordé un entretien exclusif à La vie des Classiques.
Comment vous présenter ?
Je suis agrégée de lettres classiques, ex-professeur de khâgne et hypokhâgne (Classes Préparatoires aux concours des Grandes Écoles), et désolée de me trouver à la retraite en voyant qu’on manque de professeurs de grec. Alors, à défaut d’enseigner directement, j’écris des essais historiques et des manuels de grec ancien.
Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre formation ?
Quelle a été votre formation intellectuelle ?
Je ferai sans doute sourire les élèves actuels si j’avoue que mon « idole » quand j’étais élève était… Corneille et sa morale héroïque sans concession. Evidemment, j’y ai ajouté ensuite d’autres passions, comme Stendhal, mais surtout les poètes : Hugo, Baudelaire, Apollinaire, ou encore Laforgue et Saint-John Perse. Je suis encore capable de vous réciter par cœur presque toutes les Fleurs du Mal ou la Chanson du Mal Aimé – et bien sûr des tirades du Cid ou d’Horace.
J’ai été élève au lycée Jeanne d’Arc à Clermont-Ferrand, puis au lycée Camille Sée à Paris, où j’ai eu la chance d’avoir des professeurs de CPGE tout à fait passionnants. À la Sorbonne enfin, j’ai bénéficié, pour le grec, de professeurs extraordinaires, comme Jacqueline de Romilly, ou, dans un genre très différent, Pierre Chantraine (l’homme du dictionnaire Bailly/Chantraine, et du Dictionnaire étymologique de la langue grecque). L’une m’a appris l’enthousiasme (ou plutôt a augmenté ma prédisposition naturelle), l’autre la rigueur. J’y ajoute avec reconnaissance Fernand Robert, passionnant lui aussi, qui a joué un rôle certain dans mes orientations et dans mes choix.
Mon environnement familial n’était pas a priori un atout : aucun de mes parents n’avait fait d’études. Mais ma mère veillait avec soin à ce que, ma sœur et moi, nous suivions une route bien droite. Et comme, en ces temps lointains, les divertissements étaient assez rares, l’étude était une distraction bienvenue. Je dois dire qu’ensuite, l’environnement familial a été très stimulant.
Ma passion pour le grec ancien a été un peu le fruit du hasard. J’ai choisi le grec comme seconde langue, en 4ème, au lycée de Clermont-Ferrand, par élimination (l’allemand ? ah non ! l’espagnol ? je n’arrivais pas à rouler correctement les r…). Mais évidemment, je n’ai jamais regretté ce choix.
Quel a été le premier texte latin et grec que vous avez traduit/lu? Quel souvenir en gardez-vous ?
J’ai du mal à me souvenir du premier texte latin. Mes souvenirs de 6ème sont plutôt ceux d’un apprentissage laborieux de déclinaisons, de conjugaisons. Ensuite, bien sûr, mes grands hommes ont été Tacite, Sénèque et Virgile. Pour le grec, après les phrases grammaticales d’Allard et Feuillâtre, je suis sûre que c’était le « Pour l’invalide » de Lysias. Et on nous faisait approcher assez vite les textes les plus faciles de Platon. Chaque fois, c’était un plaisir de découvrir des façons de penser et de s’exprimer qui me paraissaient beaucoup plus proches des miennes que celles des Romains, qui m’ont toujours paru moins naturelles, moins spontanées (je prie les latinistes – en particulier l’une de mes filles qui s’est illustrée dans cette voie – de me pardonner cette remarque).
Quelle est la particularité de la géographie antique ?
C’est une science essentiellement grecque et non romaine. On a des traces très anciennes de cette envie des Grecs de définir, de décrire et de dessiner une image de la terre et du monde. La première carte dont l’existence est attestée (mais qui hélas ne nous est pas parvenue) est celle d’Anaximandre, au VIe siècle avant notre ère. Inversement, comme l’écrit Janick Auberger, « les Romains eux-mêmes avaient une piètre opinion de cette discipline, que Cicéron qualifie d’obscurior scientia dans le De Oratore ». Et il est vrai que, même si les connaissances scientifiques avaient fait d’énormes progrès à l’époque romaine, les savants proposaient parfois des théories bien étranges concernant l’espace habité.
Quelle est son importance dans l’histoire ?
Elle est indissociablement liée à l’histoire même de la Grèce. Le monde grec, à ses débuts, s’organise autour de la mer Égée, puis (avec l’expansion du commerce et des conflits) autour de la Méditerranée, avant de se tourner vers l’est avec l’expédition d’Alexandre, puis vers l’ouest avec la conquête romaine. La vision du monde chez le peuple, et sa représentation chez les géographes, se modifient en accompagnant clairement ces étapes commerciales et politiques.
Comment les Grecs voyaient-ils le monde ?
Il est difficile d’en donner une image unique, tant elle a varié au cours des siècles. Il est même surprenant de constater que certains philosophes/savants des VIe et Ve siècles « voyaient » seulement les atomes ou les éléments qui le constituaient. Mais, même si les géographes modifiaient régulièrement leurs cartes en tenant compte des découvertes et en s’approchant finalement très près de nos cartes modernes, il est évident que l’image homérique d’une terre plate et ronde en forme de galette est restée ancrée dans la mentalité populaire. On la retrouve encore dans bien des cartes médiévales, naïves et très simplifiées, certainement héritées de celles qu’on trouvait encore à la fin de l’antiquité, à côté des cartes savantes bien plus élaborées.
Peut-on aujourd’hui comprendre leur vision du monde ? Pourquoi s’y intéresser aujourd’hui ?
On la comprend d’autant mieux que cette image naïve correspond fort bien à notre perception immédiate de la terre et du monde ; on constate d’ailleurs avec surprise que certains de nos contemporains soutiennent encore que la terre n’est pas sphérique, mais plate, et se proposent de le démontrer. Mais les esprits plus éclairés admirent d’autant plus la qualité scientifique des écrits savants de la dernière période, tout en analysant avec intérêt ce qui pouvait encore égarer le jugement des savants.
Quelle a été votre plus belle réussite d’enseignante ? Votre meilleur souvenir ?
Je vais citer deux exemples. Le premier concerne le lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, et plus précisément une classe de 1ère C (la future 1ère S) qu’on m’avait confiée pour les cours de français un an après mon arrivée. C’était une classe de presque 40 garçons. Cela aurait pu être très difficile : ça a été une année euphorique. Tous ces garçons avaient des personnalités différentes, mais très attachantes, souvent enthousiastes, très motivés (il y avait une épreuve de français à la fin de l’année !) et constamment attentifs. C’est ce genre d’expérience qui fait, quand on peut la vivre, le bonheur d’être professeur. L’autre exemple est celui des cours d’initiation au grec en hypokhâgne, tant à Strasbourg qu’à Versailles au lycée La Bruyère. Là, c’est une expérience aussi enthousiasmante, mais très différente. On se trouve devant un public très limité, mais très désireux d’apprendre, et prêt à s’émerveiller (contrairement à ce que certains pourraient penser) des subtilités de la langue grecque et de la beauté des textes qu’ils découvrent.
À quoi ressemble votre bibliothèque ?
Il faudrait plutôt dire mes bibliothèques. Il y en a deux près de mon bureau remplies de Budés et d’ouvrages savants. Il y en a deux autres dans la chambre d’amis, l’une où figurent par ordre alphabétique tous les grands auteurs de la littérature française, l’autre (plus fréquemment consultée !) où se trouvent quantité de romans et deux rayons de romans policiers… mais pas de science-fiction. Il faudrait enfin ajouter dans le vestibule des rayonnages où figurent noblement presque toutes les éditions de la Pléiade.
S’il fallait retenir une phrase/une idée de votre livre ce serait laquelle ?
« Notre vision du monde quotidien a-t-elle vraiment changé ? Les certitudes ont-elles tué le besoin de merveilleux ? »
Dans la même chronique

Entretien tragique avec Christine Mauduit

Entretien rhétorique avec Stéphane Marchand, Pierre Ponchon et André Rehbinder
Dernières chroniques

Grand écart – Moi et les autres