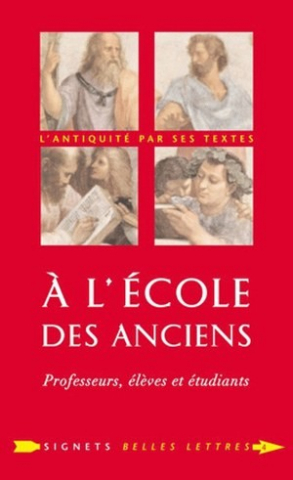
Aujourd'hui, La Vie des Classiques vous invite à lire l'entretien liminaire de l'anthologie À l'École des Anciens entre Laurent Pernot et Jacqueline de Romilly.
Jacqueline de Romilly, membre de l’Académie française et de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur émérite au Collège de France, s’est consacrée à l’enseignement, à la recherche et à l’écriture. Helléniste de réputation mondiale, elle a publié de nombreux travaux qui font autorité sur la littérature et la civilisation de la Grèce antique. Elle est également fondatrice et présidente d’honneur de l’association « Sauvegarde des enseignements littéraires » (SEL), qui milite en faveur de l’enseignement du français, du latin et du grec.
LAURENT PERNOT : Dans votre œuvre, Madame, vous avez abordé de nombreux thèmes en rapport avec l’éducation antique, et il est une catégorie de professeurs à laquelle vous avez consacré un livre entier : ce sont les sophistes, ces « professionnels de l’intelligence » qui ont exercé dans l’Athènes classique[1]. Quelle est la raison qui vous a portée vers ces personnages, sachant qu’ils ont parfois mauvaise réputation et que le mot même de « sophiste » est loin d’être attrayant en général ?
JACQUELINE DE ROMILLY : Ils ont eu très mauvaise réputation, en particulier à cause de Platon, qui s’est beaucoup moqué d’eux. Platon estimait – idée fort importante – qu’il fallait enseigner la vérité pure, alors que les sophistes enseignaient l’art d’analyser, de parler, de discuter, de répondre, donc un art qui n’était pas entièrement consacré à la vérité. Il s’agissait de deux positions bien différentes. Les grands sophistes concevaient leur art comme destiné à servir la discussion politique ainsi que les plaidoyers de cette démocratie où les gens parlaient eux-mêmes, plaidaient eux-mêmes, comprenaient et jugeaient eux-mêmes; mais l’art de plaider et de réussir a été vite utilisé par de plus jeunes élèves qui ont mieux correspondu aux critiques de Platon. Quand je dis « les grands sophistes », cette expression désigne principalement les deux premiers, Protagoras (Ve siècle av. J.-C.) et Gorgias (Ve-IVe siècle av. J.-C.), et il se trouve que jamais Platon n’attaque ces deux grands pour leur doctrine. Il s’en prend aux disciples, en montrant comment, avec eux, l’art tourne mal.
Y aurait-il eu une sorte de décadence entre le maître et l’utilisation de son enseignement faite par les élèves ?
Du moment que l’on vise une réussite pratique, il est un peu nécessaire qu’il se produise une décadence, ou une utilisation de moins en moins justifiée. Oui, je le crois. Mais, quoi qu’il en soit, la position de Platon – ou de Socrate – était résolument opposée à celle des sophistes et elle visait autre chose. D’ailleurs, le mot « sophiste » désigne quelqu’un qui a atteint, ou croit avoir atteint, un certain degré de savoir et de sagesse, tandis que le « philosophe » est celui qui cherche le savoir, la sagesse et la vérité. Ce développement correspond au moment où Athènes cesse de se consacrer à la seule réussite politique et où naissent la philosophie et les écrits théoriques, ce qui donnera ensuite toutes les écoles de philosophie et l’extraordinaire succès des maîtres de philosophie grecs et latins.
Face aux sophistes, il y a donc Socrate.
Oui.
Socrate apporte-t-il encore quelque chose aujourd’hui ? Sa manière de mettre en doute, de discuter, de dire que la vérité doit être cherchée et qu’on ne peut la professer d’en haut a-t-elle une actualité pour nous ?
Vous pensez bien que je vais répondre oui ! Je crois que cette attitude est essentielle et qu’elle est le principe même d’une activité intellectuelle réfléchie. Socrate arrête les jeunes gens et dit à chacun : « Tu fais cela, mais pourquoi ? Que veux-tu faire, quel est ton but ? » Ses interlocuteurs ne se posaient pas la question. Socrate a joué un rôle extraordinaire. Il n’était pas professeur comme les sophistes, en ce sens qu’il ne faisait pas payer ses leçons et qu’il se contentait d’aller comme cela par les rues, parlant aux gens. Mais il a fondé une conception
capitale pour l’enseignement et pour la réflexion. Il est frappant de constater – les mots, ici encore, sont révélateurs – que nous parlons d’une philosophie « présocratique », avec l’idée que Socrate a véritablement marqué un tournant. Il fut le premier à s’interroger, non sur le monde, la naissance du monde, la cosmogonie, etc., mais sur les problèmes posés par notre activité, à nous, humains, dans la cité, dans nos métiers et dans la conduite de notre vie. Cela est essentiel et joue, ou devrait jouer, un rôle dans l’enseignement de toute discipline aujourd’hui. Lorsqu’on reçoit des jeunes gens qui n’ont pas beaucoup réfléchi aux choses, il s’agit de dire : « Attention ! Pourquoi faites-vous cela ? Que voulez-vous ? Quel est le but ? À quoi votre action est-elle liée ? » C’est la prise de conscience des problèmes humains.
Au-delà d’un enseignement qui veut seulement donner une formation technique et visant un but immédiat, il s’agit de prendre de la hauteur ?
L’enseignement des sophistes était avant tout d’ordre intellectuel et technique. Il était aussi – reconnaissons-le – un peu moral, parce que les sophistes avaient le souci de la politique. Mais ce souci portait avant tout sur une réussite pratique dans la vie politique, plutôt que sur le sens, le Bien et sur l’effort à faire pour atteindre le Bien quelles que soient les données. Socrate, quant à lui, était engagé dans la cité ; il refusa de la quitter en s’enfuyant lorsqu’elle l’eut condamné, et il avait le respect des lois, comme le montre la « prosopopée des lois » dans le Criton (50a-54d); mais tout cela était au niveau des principes.
Les lecteurs sont souvent étonnés de la manière dont Socrate dialogue. L’échange entre Socrate et son interlocuteur revêt, dans nombre de passages, une forme spéciale, qui amuse les élèves lorsqu’ils font leurs premières versions grecques : face aux questions de Socrate, l’interlocuteur répond par des formes variées de « Oui », « Assurément », « Et comment ! »… Beaucoup de lecteurs se demandent si l’on a le droit de parler de dialogue, s’il s’agit d’un dialogue ou d’un faux dialogue.
Ce faux dialogue, moi, il m’enchante, car il signifie qu’on ne franchit pas le moindre pas sans s’assurer d’un accord à ce sujet, qu’il existe une succession logique qui demande accord du début à la fin. En général, l’interlocuteur de Socrate est pris dans une espèce de nécessité qui le déroute. L’ordre des raisons le conduit à découvrir des vérités qu’il ne pensait nullement devoir approuver. Pour cela, il faut que chaque petite étape soit marquée. De cette manière de procéder, il peut rester quelque chose dans tout enseignement. Tandis que le cours magistral est dans la manière des sophistes, si l’on veut, l’enseignement comporte aussi l’interrogation, le soin de répondre à chaque surprise d’un élève, le souci de franchir doucement chacune des étapes qui se suivent et qui s’enchaînent logiquement.
Comme un chemin parcouru en commun ?
Oui, faussement en commun, parce que l’un sait d’avance où il va. Mais il faut amener l’autre à le découvrir.
À côté des sophistes, à côté de Socrate, il est un autre grand domaine de la civilisation grecque sur lequel vous avez beaucoup écrit : la tragédie.
Certainement, les professeurs ne sont pas liés au genre tragique, car celui-ci a pour origine de grandes forces, des ressorts beaucoup plus simples. Mais, dans la tragédie, toute tirade développe une thèse morale, condamne ou approuve une conduite, fait l’éloge de la paix ou de l’héroïsme à la guerre, examine dans quel cas l’on peut, ou l’on doit, ou l’on ne doit pas faire la guerre, dans quel cas l’on peut, ou l’on doit, ou l’on ne doit pas sacrifier sa famille, et ainsi de suite. Il n’y a pas de professeurs, mais il y a un enseignement très net. Ainsi de l’Antigone de Sophocle : on ne peut pas dire que cette pièce contienne une thèse ni le moindre professeur, mais la discussion qui y est conduite, pour savoir s’il faut obéir à telle règle religieuse ou à tel ordre de la cité, et où sera la récompense, est une discussion morale, qui aurait sa place dans un cours de philosophie: or, c’est publiquement et devant toute la cité que cette discussion a lieu. Et ceci m’amène à une autre réflexion. À Athènes, les professeurs ne constituaient pas une profession ou un corps établi, ou pas uniquement. À Athènes, et, plus largement, chez les Grecs, tous enseignaient à tous. Déjà, chez Homère, Nestor n’est pas plus un professeur qu’un guerrier, un roi, un sage, mais il donne de bons conseils. Ensuite, à l’époque classique, les modes d’enseignement étaient multiples. Grâce au premier enseignement, les enfants apprenaient à lire, à écrire et à réciter des vers. Par les liens d’amoureux à jeune garçon, il faut le dire, ils apprenaient également. Dans le fonctionnement de la démocratie, avec tous ses discours et toutes ses démonstrations, ils apprenaient encore.
Dira-t-on qu’Athènes était la cité de la formation permanente, en quelque sorte, d’une formation omniprésente, parce que la société tout entière était attachée à la transmission du savoir et des valeurs et que chacun acceptait l’idée d’avoir quelque chose à apprendre, non seulement dans un cadre scolaire, mais aussi dans les différentes occasions civiques, discours publics ou représentations théâtrales par exemple ?
Oui, le souci était de chercher le bien, et de le chercher sous une forme simple, universelle, en ne visant pas seulement la formation des jeunes gens, ou celle de telle ou telle catégorie. Toute la littérature grecque, depuis Homère, s’emploie à dire ce qu’il faut admirer, ce qu’il faut blâmer.
Ceci se reflète dans une fameuse formule de Thucydide, par laquelle l’historien fait dire à Périclès, à propos d’Athènes : « Notre cité, dans son ensemble, est pour la Grèce une vivante leçon[2]. »
Je suis ravie que vous me parliez de cette formule, parce que c’est un des points dont je suis contente dans ma traduction. Dans cette phrase, on traduit en général le mot grec paideusis par « école ». Mais ce mot, avec sa terminaison en -sis, désigne une activité. C’est pourquoi j’ai traduit, et je m’y tiens encore, par « une vivante leçon », afin de rendre l’idée d’une activité qui se répand. La littérature et la culture grecques avaient une tendance à l’universel qui explique leur extraordinaire diffusion dans le temps et dans l’espace.
Pour passer au second volet de cet entretien, je rappellerai que, parallèlement à votre oeuvre d’helléniste, vous avez déployé une très grande activité pour promouvoir une juste conception de l’enseignement, peut-on dire, face à des ignorances ou à des dérives. Vous avez publié des livres qui ont eu un large retentissement, et dont l’un porte le mot « professeurs » dans son titre[3]. Vous avez fondé l’association « Sauvegarde des enseignements littéraires » (SEL)…
… Pas toute seule.
À la tête de cette association, vous avez mené une activité inlassable, avec des succès… je dirais : des succès toujours recommencés…
… Et toujours démolis !
Pourquoi toute cette activité ? Pourquoi défendez-vous l’idée d’un enseignement littéraire qui serait formateur dans la société d’aujourd’hui ?
Répondons tout simplement. Premièrement, par expérience. J’ai enseigné toute ma vie. J’étais bien partie, car je suis fille, petite-fille et arrière-petite-fille de professeur : fille par mon père, petite-fille et arrière-petite-fille par ma mère, de professeurs d’anglais, de lettres, de philosophie. J’ai enseigné, donc, et j’ai adoré enseigner. Et, surtout, j’ai eu une joie constante à observer, quand j’enseignais, que la formation de l’esprit par l’enseignement littéraire est un phénomène concret, que l’on reconnaît à la fin de l’année, et plus tard quand on les revoit, les jeunes gens qui ont été nourris de cette formation, qui en ont profité, qui se sont posé des questions, qui ont éprouvé soudain un coup de coeur pour tel texte ou pour telle forme d’héroïsme. Les élèves à qui l’on enseigne, quel que soit leur âge, sont beaucoup plus malléables qu’on ne croit. Et quand je dis « malléables », il ne s’agit pas leur imposer quoi que ce soit, il s’agit de les former. Dans le domaine du grec, cette formation est large et multiple. On n’enseigne pas « les valeurs grecques », car il n’y a pas de valeurs grecques univoques. Les sophistes et Platon étaient radicalement différents, nous venons de le voir ; certains textes sont pour la démocratie et d’autres sont contre ; les stoïciens s’opposent aux épicuriens, etc. Il n’y a pas une pensée grecque, il y a une attitude consistant à chercher sous forme universelle ce qui concerne l’homme, et à le dire au moyen de formes concrètes, de personnages, et en une langue claire et simple. C’est cela qui est transmis aux élèves, et cela se transmet tellement bien qu’ils réagissent, qu’ils sont émus, qu’ils se posent des questions. Donc, par expérience, j’ai su que l’enseignement était merveilleux. Et j’ajouterai : par contre-expérience. On a progressivement abandonné les études grecques dans l’organisation de l’enseignement, en grande partie parce qu’elles avaient constitué l’éducation de la haute bourgeoisie, des classes supérieures, et qu’on s’est dit :
Tout cela, c’est le passé, les hellénistes sont des gens « rétro ». On s’en est détourné. Or, que voit-on ? c’est combien, aujourd’hui, elles manquent. Mon action n’est pas conduite pour l’intérêt du grec – qu’est-ce que cela veut dire, l’intérêt du grec ? –, mais pour l’intérêt de la formation des jeunes gens et des jeunes filles, dont on voit, en ce moment même, qu’ils sont déroutés, incertains, marqués par le matérialisme et privés des chocs, des illuminations qui font aimer un héros ou qui amènent à se demander ce qu’il faut faire et pourquoi.
Vous portez un constat pessimiste sur l’état actuel de l’enseignement en France ?
Sur l’état actuel, oui. Il y a encore de très bons élèves et étudiants, de très bons professeurs, mais je porte un jugement sévère sur l’organisation des études. Après le latin et le grec, maintenant, le français souffre aussi, même la langue française. En Europe, la crise est partout ; mais les éléments de sursaut et de retour sont partout aussi. Je me penche surtout sur l’enseignement secondaire, n’étant pas très inquiète pour l’enseignement supérieur, dans lequel, avec une certaine lucidité, on y arrivera toujours.
Que faut-il dire à des parents qui hésitent à faire étudier le latin ou le grec à leurs enfants ?
Il faut leur faire comprendre que l’enseignement n’est pas seulement une acquisition de savoirs pratiques qu’on peut revendre à la sortie, mais qu’il est une formation de l’esprit, de l’homme, de son jugement, et que le but n’est nullement d’amener les élèves à se servir du grec, du latin ou de telle notion historique plus tard. Grâce à l’enseignement littéraire, les élèves se forment, se posent des questions, se donnent un bagage de symboles et de présences figurées représentant les diverses façons d’agir, de s’émouvoir, et de percevoir la beauté. Ils se donnent tout cela au moment d’aborder la vie, et peuvent se spécialiser dans d’autres domaines ensuite. La vraie objection, à l’heure actuelle, n’est plus la question des classes sociales, qui est dépassée, mais la concurrence avec les langues vivantes. Il faut des langues vivantes, et il est difficile de demander à un enfant d’étudier deux langues vivantes et deux langues anciennes. Aussi voudrais-je insister sur le fait que le latin et le grec sont à la racine de quantité de langues vivantes, et qu’il est possible d’apprendre plus aisément des langues vivantes quand on a été formé au latin et au grec. Il s’agit donc de répartir les enseignements suivant les âges et les horaires, en se rappelant qu’il est plus facile d’apprendre une seconde langue vivante quand on a étudié un peu de latin et de grec que d’apprendre un peu de latin et de grec quand on a étudié une seconde langue vivante.
En plus des langues étrangères, et même avant, il y a la langue française, sur laquelle vous vous penchez à l’Académie française, et qui occupe une place croissante dans vos écrits, où les mots, la magie des mots, jouent un rôle important[4].
Je ne dissocie pas le latin et le grec du français. J’allais dire : c’est la même langue. L’étude du latin et du grec aide à mieux apprendre le français, qu’il s’agisse de l’étude des temps, de l’orthographe, du sens, des étymologies (cela amuse beaucoup les enfants, les étymologies !). À preuve, l’exemple de ce professeur de lycée, Augustin d’Humières, qui fait étudier le latin et le grec dans un établissement dit défavorisé[5]. Je l’ai rencontré : il a un grand succès. Il a fait jouer des pièces grecques dans les banlieues, et il fait aussi revenir ses anciens élèves, qui ont bien réussi, pour qu’ils expliquent comment cet apprentissage leur a servi. Le latin et le grec, pour moi, ne sont pas tournés vers le passé, mais nourrissent l’avenir.
À vous entendre, cela paraît si évident qu’on se demande pourquoi il y a des résistances. Certainement, il n’est pas question d’imposer le latin et le grec à tous les élèves, mais il est difficile de comprendre que ces langues soient menacées même en tant qu’options.
Le problème du métier à la sortie, du gagne-pain, est décisif. Il est de fait que les débouchés directs et immédiats sont rares : il y a plus de professions scientifiques que de professions littéraires, plus d’interprètes et de traducteurs de langues vivantes que de langues anciennes. En apparence, pour qui n’a pas l’expérience de ces choses, l’enseignement du latin et du grec donne l’impression de ne servir à rien du point de vue pratique. Mais ma position, c’est qu’il sert indirectement dans tous les métiers et quoi qu’on doive faire ensuite. Un de mes anciens élèves est devenu codirecteur d’une des plus grosses entreprises industrielles du pays. Et, si un tel cas est rare, tout jeune homme ou toute jeune fille qui postule pour un emploi, qui rédige une lettre de motivation,
qui se présente à un entretien, a besoin de savoir s’expliquer, de s’exprimer clairement et de trouver les arguments pour convaincre. Depuis le premier curriculum – qui est d’ailleurs un mot latin – jusqu’à la gestion d’une grande entreprise, il s’agit de pouvoir dominer son sujet, définir son but, expliquer et argumenter : les enseignements littéraires sont extrêmement utiles pour cela.
Si vous le voulez bien, Madame, nous pourrions évoquer à présent votre expérience personnelle de l’enseignement. Avant d’être un très grand professeur, vous avez été vous-même élève, c’est la loi naturelle. Quels sont les maîtres qui vous ont particulièrement marquée ?
Quand j’étais élève au lycée, nous avions, pour les langues anciennes, des professeurs masculins. J’ai appartenu à la première génération de jeunes filles qui ont eu le droit d’étudier le grec ; auparavant, cela n’existait pas. C’étaient donc des professeurs hommes qui venaient au lycée de filles pour le latin et le grec, et c’était un événement. À cette époque, j’ai eu pour professeur M. Cayrou,
qui devint Inspecteur général par la suite. Il était sec, méthodique et précis, et nous enseignait la grammaire. C’étaient la règle ceci, la règle cela, qui n’avaient rien de révélations intellectuelles ; mais nous apprenions bien et nous nous amusions bien. Ensuite, en faculté, il y a eu Paul Mazon. Il avait une belle voix et il avait le sens de la présence du texte. Il lisait les oeuvres, les analysait, en faisait sortir pour nous des choses que nous n’avions pas vues, et nous étions enthousiasmés. Je fus son élève fidèle. Comme je travaillais sur Thucydide, il m’a dirigée vers Louis Bodin, qui était un homme infiniment respectable et son ami, mais je suis restée en contact avec lui. J’ai été son élève à la Sorbonne et, puis-je dire, dans la vie. Il a été témoin à mon mariage. J’ai le souvenir que, plus tard, quand il était directeur de la Fondation Thiers, Paul Mazon me faisait venir pour relire sa traduction de Sophocle[6]. Je n’habitais pas loin. J’arrivais à deux heures ou deux heures et demie – comme vous –, et il me lisait sa traduction par environ cent vers à la fois. Moi, je suivais sur le texte grec. Et c’était un effort d’attention ! Puis il s’arrêtait. Il demandait : « Qu’est-ce que vous avez remarqué? Qu’est-ce qui vous a gênée ? Avez-vous des questions à poser ? » Et nous discutions sur le texte. Lorsque nous avions fini, vers cinq heures, j’étais morte de fatigue, mais j’étais éblouie. Cela a été pour moi une grande chance. Une autre rencontre qui a compté fut celle de Pierre Chantraine. Je n’ai pas vraiment suivi son enseignement, mais ai été plutôt amie avec lui, lectrice de ses publications, et je lui dois beaucoup. Je lui ai succédé à l’Académie des inscriptions. Vous parliez de mon goût pour les mots : c’est entièrement à lui que je le dois. Je consulte encore souvent, autant que je le puis, son Dictionnaire[7]. Certains de ses articles consacrés à des étymologies, et qui étaient d’une superbe précision scientifique, révélaient l’évolution des mots en fonction de la société, les surprises que les mots réservent. Je crois que de ce point de vue Chantraine a marqué toute notre génération.
Après avoir suivi les leçons des maîtres, vous avez enseigné à votre tour, dans les établissements les plus prestigieux.
Et dans les autres aussi ! J’ai enseigné partout, autant qu’il est possible. Si je n’ai pas véritablement enseigné dans le primaire, je suis allée y faire des interventions à de nombreuses reprises. À partir de la sixième, j’ai enseigné dans toutes les classes. J’ai été professeur en khâgne, en université – en province et à Paris –, au Collège de France. J’ai encore enseigné dans les écoles normales d’instituteurs, à l’École normale supérieure de garçons et à l’École normale supérieure de jeunes filles, ce qui n’était pas la même chose, et j’ai fait passer les concours des Écoles normales supérieures et de l’agrégation. Tout, tout, tout !
Est-ce qu’en tant que femme, dans un milieu où il y avait beaucoup de professeurs masculins, vous enseigniez d’une manière différente ?
Je crois que cela ne fait aucune différence. La différence, c’est qu’il y a de bons et de mauvais professeurs, des professeurs qui y croient et d’autres qui n’y croient pas.
Après avoir évoqué tout à l’heure les difficultés, la nécessité de lutter pour l’enseignement du grec, il faut dire aussi que le métier de professeur procure de grandes joies. Qui a eu la chance de suivre vos cours sait que vous communiquiez aux auditeurs, avec le savoir, votre force, votre enthousiasme. Vous souvenez-vous particulièrement de moments de bonheur goûtés à enseigner ?
Non, je ne peux pas dire qu’il y ait eu de grands moments, car il y avait des moments tout le temps ! Naturellement, il y a des cours moins réussis, parce que le professeur n’est pas en forme, ou que les élèves sont fatigués. Mais, en règle générale, une des choses que je trouve les plus belles dans le métier de professeur, c’est qu’en entrant dans la classe on laisse dehors toute la vie, tous les problèmes. On a l’âge de ses élèves, c’est-à-dire l’âge de découvrir et de s’émerveiller.
Pour clore cet entretien, en manière d’exhortation finale, auriez-vous un conseil à donner aux pouvoirs publics à propos de l’enseignement ?
Il faut leur rappeler – ce que nous faisons d’ailleurs, mais il faut être encore plus nombreux à le faire à tous les niveaux –, il faut leur rappeler que l’enseignement n’est pas seulement la vente d’un produit pour une profession, mais une formation utile pour toutes les professions. Et une formation exceptionnellement utile. Aussi, il ne faut pas choisir ce domaine pour faire des économies.
Faut-il que les professeurs, de temps en temps, sachent faire rire ?
S’ils ne le font pas malgré eux !
[1] . J. de Romilly, Les Grands Sophistes dans l’Athènes de Périclès, Paris, de Fallois, 1988 (p. 19 pour l’expression « professionnels de l’intelligence »).
[2] Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, Livre II. Texte établi et traduit par J. de Romilly, Paris, Les Belles Lettres, Collection des Universités de France (CUF), 1962, chap. XLI, § 1.
[3] J. de Romilly, Nous autres professeurs, Paris, 1969, et L’Enseignement en détresse, Paris, 1984 (ouvrages réimprimés en un volume sous le titre Écrits sur l’enseignement, Paris, de Fallois, 1991) ; Lettre aux parents sur les choix scolaires, Paris, de Fallois, 1994; Actualité de la démocratie athénienne, Paris, Bourin, 2006.
[4] Voir notamment J. de Romilly, Dans le jardin des mots, Paris, de Fallois, 2007.
[5] Voir l’article de M. Van Renterghem, « Homère et Shakespeare en banlieue », Le Monde, 16 février 2007.
[6] Sophocle, Tragédies. Texte établi par A. Dain et traduit par P.Mazon, Paris, Les Belles Lettres, Collection des Universités de France, 3vol., 1955-1960. Paul Mazon a encore édité et traduit, dans la CUF, les oeuvres d’Eschyle et d’Hésiode, ainsi que l’Iliade d’Homère. Louis Bodin, quant à lui, est l’auteur des Extraits des orateurs attiques, qui ont formé des générations d’élèves et d’étudiants (Paris, Classiques Hachette, 1910, nb. rééd.); il donna avec Paul Mazon les Extraits d’Aristophane et Ménandre, également dans les Classiques Hachette, et participa à l’édition de Platon (Gorgias, Ménon) et de Thucydide dans la CUF.
[7] P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, terminé par O. Masson, J.-L. Perpillou, J. Taillardat, sous la direction de M. Lejeune, Paris, Klincksieck, 1968-1980; nouv. éd. avec un Supplément, sous la direction de A. Blanc, C. de Lamberterie, J.-L. Perpillou, Paris, Klincksieck, 1999. Pour la CUF, Pierre Chantraine a édité des œuvres d’Arrien et de Xénophon et collaboré à l’Iliade de P. Mazon.
Dans la même chronique

Entretien tragique avec Christine Mauduit

Entretien rhétorique avec Stéphane Marchand, Pierre Ponchon et André Rehbinder
Dernières chroniques

