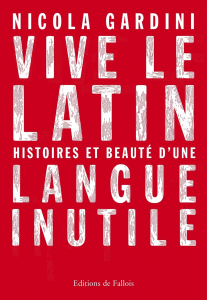
En exclusivité pour la Vie des Classiques, voici le compte rendu de Cecilia Suzzoni du livre de Nicola Gardini, Vive le latin. La version abrégée paraîtra dans le numéro de rentrée de la revue Esprit.
Nicola Gardini
Vive le latin
Histoires et beauté d’une langue inutile
Éditions de Fallois, 2018 pour la traduction française.
Compte-rendu Cecilia Suzzoni, professeur honoraire de chaire supérieure au lycée Henri IV, fondatrice de l'Association ALLE le latin dans les littératures européennes, membre du Directoire du Réseau Antiquité-Avenir.
Les bonnes nouvelles du latin nous sont venues ces derniers temps de la traduction d’un livre on ne peut moins académique ! Et c’est tant mieux ! Ce n’est pas un de ces manuels d’apprentissage du latin, comme il en fleurit beaucoup, non plus qu’un essai à proprement parler sur l’histoire de la littérature latine. Non, son auteur, un universitaire italien qui enseigne à l’Université d’Oxford, s’est tout simplement employé à trouver les mots pour dire d’où lui vient son amour du latin, un amour qu’il entend transmettre à la jeune génération, mais aussi bien à tous ceux qui partagent le souci « inutile » de préserver avec le latin « une éthique du langage et de la pensée ». Au fil d’un commentaire, qu’on pourrait presque dire « à sauts et à gambades », ce sont les « épisodes » de la vie du latin qui sont évoqués, c’est-à-dire, et nous sommes ici au cœur du sujet, « ce que le latin accomplit et obtient quand il sort de la langue de Cicéron ou de Virgile », ou de Lucrèce, ou de Tacite… Cet essai, sans aucune nostalgie naïvement passéiste, sans tomber dans le piège de l’appropriation anachronique d’un héritage européen dont la responsabilité nous incombe, mais sans concession aussi à l’égard de la vulgate anthropologique en cours, ose le pari de faire entendre l’efficace beauté du latin littéraire. Ce faisant, il illustre avec conviction et efficacité la définition que Julien Gracq aimait à donner du latin : « une langue entièrement filtrée par une littérature ».
La première originalité de cet essai, qui lui insuffle cette allure de causerie, si agréable au lecteur, est d’évoquer un amour du latin né quasiment dans l’enfance, ou pour le moins dès les premières années de collège, et qui gardera de cette heureuse familiarité précoce comme un « halo mystérieux ». On pense ici à ce que dit le poète Yves Bonnefoy dans l’Arrière –Pays de sa découverte, en classe de sixième, de cette langue mystérieuse, « langue plus avertie, parole de l’algèbre en exil ». Peut –être d’ailleurs le lecteur français devra se rappeler que le statut du latin en Italie n’a pas souffert, comme c’est le cas chez nous, d’une désaffection entretenue avec un zèle imprudent par les autorités éducatives elles-mêmes, fruit également de la pétrification du système classique français. Non seulement Nicola Gardini se souvient avec émotion de ses professeurs, les nomme, mais il souligne aussi le rôle qu’a joué sa « curiosité » toute personnelle, délestée de la férule des maîtres. Ainsi de sa découverte quasi clandestine, et d’autant plus émerveillée, du poète Catulle, dont la métrique avait été jugée trop difficile par son professeur…C’est d’ailleurs l’occasion, dans ce chapitre au libellé alléchant Mystère et merveille ( Catulle) de montrer, à l’aide de quelques exemples qui touchent aussi bien au lexique qu’à la morphologie et la syntaxe, comment apprentissage grammatical et commentaire littéraire peuvent, doivent aller de pair ; même émotion joyeuse à rappeler qu’ « A l’école c’était la fête quand le professeur donnait à traduire en classe un court extrait de César.. » ; autre coup de coeur, avec Lucrèce, dont la découverte comme « quelque chose de sacré » devait rester pour toujours dans sa mémoire inséparable des « premières impressions » liées au volume « acheté d’occasion » du De rerum natura (expérience proustienne s’il en est…).
C’est chaque fois, et d’abord, à l’aventure d’une langue dans le « laboratoire » d’un auteur que se montre attentive cette promenade dans la littérature latine, même si, après un élégant, rapide et pour autant éclairant rappel de la genèse de cette langue et de son « alphabet divin » ( Boccace) à la source des langues romanes, le fil chronologique est « tenu », depuis Ennius, l’inventeur d’un latin nourri du modèle grec, dont il s’émancipe déjà, jusqu’au latin chrétien des Pères de l’église. C’est qu’il s’agit de « ranimer l’émerveillement, premier moteur essentiel de la volonté de lire », et non pas de s’enliser dans une défense racornie ou paresseuse d’avantages que tout autre apprentissage linguistique serait alors en droit de revendiquer à l’identique ; une défense qui, quelle que soit sa légitimité, réduirait alors le latin à une « gymnastique de l’esprit ». Certes, le latin est pluriel : il y a « des latins », et « la langue change ». Deux constats dont auraient bien fait de s’inspirer depuis longtemps les responsables des programmes scolaires…Mais au-delà de la diversité des styles, ce que la réflexion de Nicola Gardini fait valoir, c’est la continuité d’une langue, devenue très tôt une langue littéraire, merveilleusement apte à dire la saveur concrète des choses – le texte du De agri cultura de Caton sur « la salaison du jambon » est une petite merveille ! - ; « la mesure de la réalité », à propos de César, dont il nous est rappelé opportunément qu’il écrivit aussi, dans le temps qu’il conduisait la guerre des Gaules, un traité linguistique sur l’analogie ; « le pouvoir de définir » ( Lucrèce), soit l’aptitude à dire avec les mêmes mots ( quaerit, convisens, conspicere, revisit, requirit ) l’investigation intellectuelle la plus abstraite, aussi bien que l’inquiétude déchirante- desiderium- de la « maman bovine » à la recherche de son veau qui ne ressemble à aucun autre . Et bien sûr, ces champions du latin que sont Virgile et Cicéron trouvent une place de choix dans cette marche vers une latinitas achevée. Langue de l’éros et du souvenir que le latin de Virgile, le plus grand (« Si une catastrophe devait se produire , l’Énéide serait le livre à sauver parce qu’il préfigure de nombreux autres livres et qu’il contient l’essentiel de l’Odyssée et de l’Iliade ») ; car, comme l’avait déjà pressenti Madame de Staël, avant Yves Bonnefoy, ce livre s’est fait le chantre d’un univers où « tout et tous se souviennent », et où l’ordo verborum, l’ordre des mots, fait résonner « le frisson de la syntaxe ». Langue tout à la fois d’une culture oratoire au service de la justice et de la liberté, que celle de Cicéron, qui, dans le même temps où il combat et meurt en militant pour l’idéal républicain, fait du latin, dans sa correspondance, la langue d’« une nouvelle subjectivité littéraire ». Nous dirions volontiers, pour notre part, invente l’individu moderne…
Chaque fois, qu’il s’agisse des « gros mots » de Catulle-propres à susciter la curiosité des adolescents…-, du « génie verbal » de Plaute, de celui de Térence ( « Que serait notre théâtre comique sans le latin ? »), l’accent est mis à juste titre sur la dimension écrite, forcément artificielle donc d’une langue littéraire qui, en cela véritable réserve de sens, a su embrasser toutes les disciplines. Chaque auteur produisant une avancée dans le perfectionnement et l’approfondissement des ressources de la langue, et faisant montre de la « la volonté personnelle d’aider la langue à couvrir des distances non encore parcourues ». Langue narrative et comme « romanesque » de Tite-Live, artiste de la période, riche d’un panel d’affects impressionnants, une œuvre lue passionnément par Machiavel deux siècles après que Pétrarque en aura reconstitué les fragments; langue diffractée de Tacite, dont la concision et la brusquerie obligent le lecteur à rétablir les chainons manquants, prompte à scruter les mécanismes du pouvoir en une véritable dramaturgie funèbre dont Barthes a pointé l’étonnant « baroquisme » ; langue de Juvénal, cette vox ferrea dont Les Châtiments de Victor Hugo se souviennent, féroce pour stigmatiser la corruption. À propos d’Ovide, Nicola Gardini a l’honnêteté de dire qu’il est revenu sur un premier jugement un peu facile - mais « l’école n’a guère servi le nom d’Ovide »- pour célébrer la virtuosité avec laquelle la langue de ce poète déraciné est apte à capter les glissements progressifs d’une identité altérée (voir notre commentaire de la dernière et belle traduction des Métamorphoses par Marie Cosnay dans la revue Esprit avril 2018). Quant à Pétrone et Apulée, qui ont en effet poussé très loin la « dérive inventive » de la langue, ils offrent leur verve bouffonne et subversive aux « transpositions visuelles » de Fellini et de Paolo Poli. Cette constante évolution de la langue reçoit avec le latin chrétien un infléchissement décisif : le chapitre Ronces, gouffres et souvenirs (St Augustin, St Jérôme) analyse cette transformation qui touche le lexique, la syntaxe, et aussi « la portée métaphorique de la langue » ; une langue qui, avec Augustin, se met au service d’une exploration abyssale – définitivement moderne, serait-on tenté de dire- des ténèbres de la mémoire.
Sans doute, pour notre part, aurions- nous davantage insisté sur les querelles déjà académiques qu’a connues la littérature latine ; en témoignent, entre autres, les sarcasmes dont le jeune Martial, un des « oubliés » de l’essai, accable les vieux auteurs qui raflent tout sans laisser leurs chances aux jeunes : « La gloire aux Anciens/Rien pour les vivants ! ». Souligné davantage aussi la puissance de « l’imagination désirante » propre à cette langue : les leçons de bonheur et de sagesse dispensées par Sénèque le Philosophe ( La sérénité de tout dire ), voisinent avec l’œuvre flamboyante de Sénèque le Tragique ( voir le choc, en ce mois de juillet 2018 au festival d’Avignon, de la mise en scène de son monstrueux Thyeste…) Mais cet essai, en cela jusqu’au bout fidèle à son parti pris littéraire, reste très conscient qu’à Rome, grande différence avec la Grèce, et pour le dire avec les mots de l’historien Jonh Scheid, « le développement culturel va être déterminé par la chose écrite pratiquement dès le départ »[1]. C’est peut-être là que se joue, à notre sens, les affinités profondes de la langue latine avec la langue française que nous avons longuement évoquées dans notre article sur Julien Gracq et le souci du latin[2] et dans le volume collectif Sans le latin…[3]
Certes, Vive le latin ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà sur cette langue, et ce n’était pas non plus son but d’écrire une énième histoire de la littérature latine. Encore une fois, son charme profond, efficace, réside dans la grande liberté et la ferveur avec lesquelles chaque chapitre, en faisant la part belle à des séquences de textes accompagnées de leur traduction et d’un riche et sensible commentaire, rend hommage à cette langue dont le romancier français Claude Simon a brillamment qualifié le statut redivivus[4]. Il faut enfin saluer la tranquille assurance avec laquelle Nicola Gardini rappelle, dans le sillage de Marc Fumaroli[5], ce que la culture européenne, son identité littéraire, d’hier à aujourd’hui, doit au latin, bien au- delà de la culture de la Renaissance « intimement latine ». Et que l’on nous comprenne bien : il ne s’agit évidemment pas de « domestiquer », ou de « s’approprier » indûment un patrimoine dont Chateaubriand se plaisait à dire qu’ayant rayonné partout, il appartient à tous ; mais enfin, s’il y a quelque chose qu’il serait aussi vain que grotesque de deseuropéaniser, c’est bien cette langue latine qui a tant voyagé, et que son nomadisme , comme se plaisaient à le dire Érasme et …Aimé Césaire, met à l’abri de toute préférence nationale, de toute crispation identitaire. Aussi bien, est-ce un grand plaisir de voir défiler dans cet essai les grands noms de ces génies-mères (Pétrarque, Dante, Montaigne, Shakespeare, Cervantès), tous compatriotes et contemporains via le substrat commun et nourricier de ce que George Steiner appelle « le véhicule latin »[6]. Un grand plaisir de voir notre collègue italien citer lui aussi ce mot de Nietzsche, si juste, pour qualifier le génie poétique d’une ode d’Horace : « Dans certaines langues, il n’est même pas possible de vouloir ce qui est réalisé ici ». C’est à Horace, « le plus français des poètes latins » - nous souscrivons volontiers à ce jugement ! – que Nicola Gardini consacre sa dernière promenade littéraire, sous l’égide du titre, heureusement festif, Encore sur le bonheur (Horace); ce poète aimé de Primo Levi, et dont l’Art poétique, bréviaire d’un rationalisme poétique souvent injustement et naïvement caricaturé, fait preuve d’une conscience linguistique étonnamment historique et moderne dans son éloge de l’usus, ultime critère de la langue : « Et quel sens de l’histoire quand il parle de la langue ! »
Cet essai arrive à point pour rappeler ce que, pour notre part, nous ne cessons de signaler : le danger que constitue pour l’École et pour les Études littéraires en général l’effacement d’une langue dont nous demandons qu’elle retrouve au sein du projet d’un tronc commun d’éducation européenne une place légitime, raisonnable et renouvelée. Le danger aussi qu’une approche devenue trop systématiquement anthropologique ou civilisationnelle conforte un clivage contre nature entre antiquisants et francisants ; le danger d’un enseignement de la littérature française découplé du rôle mémoriel et continuateur du latin. C’est dire si les derniers mots de l’ouvrage de Nicola Gardini « Reprenons tout à partir du latin » rencontrent la totale et joyeuse approbation des « apologistes étrangers » que nous sommes, attachés à promouvoir une langue latine toujours vivante d’avoir été et qui « en nous parvenant à travers le tamis des chefs d’œuvre semble n’avoir été parlée que par des écrivains »[7].
Cécilia Suzzoni
Professeur honoraire de chaire supérieure au lycée Henri IV, fondatrice de l’Association ALLE, le latin dans les littératures européennes, membre du Directoire du Réseau Antiquité-Avenir
[1] John Scheid, « Paroles tissées », dans Paroles romaines, sous la direction de Florence Dupont, Presses universitaires de Nancy, 1995, p. 83-95.
[2] Revue Esprit, janvier 2011, p.78-89.
[3] Sans le latin…Sous la direction de Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit, Fayard, 2012.
[4] Claude Simon, L’herbe, « Ces mots latins (…), à la façon de ces murs construits sans mortier, les mots se commandant les uns les autres , ajustés aussi par cette syntaxe impérieuse, inventée sans doute en prévision des mutilations futures, et à seule fin d’être reconstitués mille à deux mille ans plus tard , après avoir été dispersés, oubliés, enterrés, recouverts des ronces, submergés et redécouverts »
[5] Identité littéraire de l’Europe, sous la direction de Marc Fumaroli, Yves Bonnefoy, Harald Weinrich et Michel Zink. Paris PUF, Collection « Perspectives littéraires », Paris, 2000.
[6]George Steiner, Passions impunies « Il serait difficile d’interpréter avec cohérence la rhétorique des littératures européennes , les notions fondamentales du sublime, de la satire, du rire qu’elles incarnent et qu’elles expriment sans avoir nettement conscience du sous-entendu latin, de ces négociations ininterrompues , souvent quasi-inconscientes, soit d’intimité soit de distance , entre l’écrivain de langue vulgaire et son moule latin ».
[7] Julien Gracq et le souci du latin, article cité, p.81.