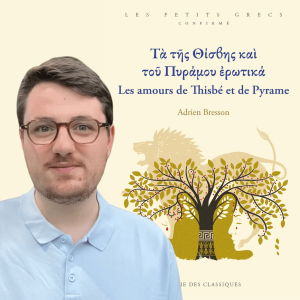
À l’occasion de la publication de Τὰ τῆς Θίσϐης καὶ τοῦ Πυράμου ἐρωτικά, dernier volume bilingue grec ancien-français de la collection Les Petits Grecs, Adrien Bresson nous fait l’honneur d’un entretien exclusif pour nous faire (re)découvrir les péripéties de Thisbé et de Pyrame, une odyssée éclatante où les périls du grand large se mêlent à la force de l’amour.
La Vie des Classiques : Comment vous présenter ?
Adrien Bresson : Simplement : je suis professeur agrégé de lettres classiques et docteur en langues et littératures latines et grecques. Je suis enseignant-chercheur (ATER) à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne et les travaux d’écriture auxquels je me livre pour La Vie des Classiques sont une continuation de mon métier. Il s’agit de transmettre, par un autre biais, à travers des matériaux qui sont par essence pédagogiques.
L.V.D.C. : Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre parcours ? Quelle a été votre formation intellectuelle ?
A. B. : Après une hypokhâgne et deux khâgnes au Lycée du Parc à Lyon, j’ai étudié à l’ENS de Lyon, où j’ai préparé l’agrégation de lettres classiques, avant d’écrire une thèse sur la poésie latine tardive, autour des auteurs du IVᵉ siècle de notre ère Ausone et Claudien, à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne, sous la direction de Florence Garambois-Vasquez. Si j’ai continué à pratiquer les langues anciennes et à me former dans ces différents établissements, il faut bien reconnaître que mon intérêt pour le latin et le grec remonte à la classe de 5ᵉ, lorsque Mme Maltère, qui était mon enseignante au collège Jean de la Fontaine de Saint-Germain-des-Fossés (03), m’a initié aux merveilles des langues anciennes en termes de littérature, de civilisation et de langue. Elle a donc été fondamentale dans mon parcours, comme l’ont été Fabienne Nicolet, au Lycée du Parc, qui m’a fait découvrir le roman grec, Christelle Laizé, grâce à qui j’ai lu Claudien, et Florence Garambois-Vasquez, sous la direction de laquelle je l’ai étudié, ainsi qu’Ausone, dont elle est spécialiste.
L.V.D.C. : Quel a été le premier texte latin et/ou grec que vous avez traduit/lu ? Quel souvenir en gardez-vous ?
A. B. : Je me souviens très bien que les premiers textes latins et grecs que j’ai traduits étaient en réalité en langue recomposée à des fins pédagogiques, comme le sont finalement les Petits Latins et les Petits Grecs, même si nous essayons d’écrire au plus près de la manière dont les Anciens considéraient leur propre langue. Je me souviens ainsi très bien du manuel Invitation au latin, qui me semble toujours aujourd’hui absolument excellent. Les premiers textes d’auteurs latins que j’ai traduits, en classe de 3ᵉ, en langue originale, étaient des poèmes des élégiaques. Mme Maltère – toujours elle – nous avait distribué un florilège de quatre ou cinq poèmes de Catulle, dont le fameux Odi et amo. Ce fut pour moi une vraie révélation. En ce qui concerne le grec, sous la houlette de M. Thomas au Lycée de Presles à Cusset (03), en classe de 1ᵉ, j’a traduit plusieurs textes de Lysias, notamment empruntés à son Sur l’Invalide. J’en garde un très bon souvenir parce que c’est un texte plaisant et efficace pour comprendre la rhétorique antique.
L.V.D.C. : Avez-vous pratiqué, et/ou pratiquez-vous encore, l’exercice formateur du « petit grec » ? Quels auteurs vous ont accompagné ?
A. B. : J’ai beaucoup pratiqué le petit grec – c’est-à-dire une lecture journalière bilingue et conjuguée d’un texte grec en langue originale avec la traduction en regard – lorsque j’étais en khâgne afin de développer des automatismes. J’ai fait la même chose l’année où j’ai préparé l’agrégation de lettres classiques, et on peut dire que je continue à le faire aujourd’hui, dans une certaine mesure, avec les Lauréats qui propose un texte original, en langue ancienne, dont l’ordre a été remanié pour correspondre à l’organisation de la phrase française. Le texte ancien est découpé phrase par phrase, indépendamment du mouvement des vers. Une traduction et un riche apparat de notes de vocabulaire, de traduction et de culture accompagnent le texte. Ainsi je m’intéresse quotidiennement à l’Assemblée des femmes d’Aristophane, et à la Médée de Sénèque, pour ce qui est du latin.
L.V.D.C. : Après deux volumes pour Les Petits Latins, De Bello deorum et Psyche et Cupido, vous relevez le défi d’écrire en grec ancien : est-ce différent d’écrire dans l’une ou dans l’autre langue ? Qu’est-ce qui a évolué dans votre manière d’aborder ce travail ?
A. B. : Lorsque la collection des Petits Grecs a été lancée en 2023, j’avais déjà écrit et publié De Bello deorum, et Laure de Chantal qui dirige les Petits Latins et les Petits Grecs m’a très vite dit, en parlant des Petits Grecs, « vous y viendrez », ce à quoi j’ai tout de suite acquiescé. Il était évident pour moi que je tenais à me confronter à l’exercice parce que j’aime bien la nouveauté et que je voulais relever le défi d’écrire en grec ancien. Au demeurant, si j’ai commencé le latin en classe de 5ᵉ, il m’a fallu attentre la 2ⁿᵈᵉ pour découvrir les charmes de la langue de Platon, je suis donc légèrement moins à l’aise en grec qu’en latin. J’ai pour coutume de dire que j’ai toujours trois ans de retard en grec, par rapport au latin. Ainsi, avant de consentir à écrire un Petit Grec, j’ai tenu à être pleinement certain de maîtriser activement l’ensemble de la grammaire grecque. C’est dans cette idée que j’ai accepté de réviser, avec Dorian Flores, le Grec ancien express, manuel de grec ancien de La Vie des Classiques. Les 120 exercices de grec ancien, qui viennent en appui du manuel, que nous avons co-écrit avec Dorian Flores, ont également été pensés en ce sens. En outre, je ne concevais pas d’animer Γράψωμεν, atelier d’écriture en grec ancien de La Vie des Classiques, sans m’être moi-même confronté à l’exercice. Quelle légitimité aurais-je, sinon ?
L.V.D.C. : Vous racontez, dans votre volume, les aventures de Thisbé et de Pyrame, deux des amants les plus connus de la mythologie gréco-romaine : comment est né ce projet éditorial ? Et pourquoi avoir choisi ces figures ?
A. B. : À l’origine, je voulais écrire un roman grec et c’est comme ça que j’ai présenté le sujet à Laure de Chantal. J’adore les romans grecs, qui me font beaucoup penser aux séries grand public à rebondissements successifs. Le rythme y est cadencé, avec de multiples péripéties, à couper le souffle, mais tout se termine toujours bien : rien de mieux pour un optimiste. On sait qu’avant Ovide, poète latin du Iᵉʳ siècle de notre ère, un ouvrage – si ce n’est plusieurs – aurait abordé l’histoire de Thisbé et de Pyrame. Mais, comme beaucoup d’œuvres antiques, il ne nous est pas parvenu. Il y a une telle variabilité des contenus mythologiques dans l’Antiquité, en fonction des lieux et des temps où ils sont abordés, que j’ai pris le parti d’écrire une version joyeuse de l’histoire des deux amants, à la manière d’un roman grec, en essayant d’imaginer ce qu’aurait pu être le livre perdu de Thsibé et de Pyrame. Ils peuvent ainsi être vus sous un autre jour.
L.V.D.C. : Quelles ont été les différentes étapes dans l’écriture du volume Τὰ τῆς Θίσϐης καὶ τοῦ Πυράμου ἐρωτικά ? Avez-vous rencontré des difficultés ?
A. B. : Je procède toujours de la même manière, comme j’ai incité les étudiants à le faire dans le cadre de Γράψωμεν : un synopsis général de l’ouvrage, assez précis, puis je rédige les chapitres un par un, en commençant par le français, pour avoir une trame, puis le grec ensuite. J’amende ensuite les deux langues en même temps, conjointement, jusqu’à arriver à un résultat qui me convient. Lorsque l’écriture d’un chapitre est terminée, je rédige un enrichissement culturel, un enrichissement grammatical et j’indique le vocabulaire correspondant. À la fin du processus, il est important de bien se faire relire par plusieurs personnes différentes. Le dialogue est une richesse et permet d’éviter des erreurs, que l’on finit par ne plus voir à force de se lire et de se relire soi-même. C’est peut-être là la plus grande difficulté : être constamment objectif sur son travail.
L.V.D.C. : Le mythe classique de Thisbé et de Pyrame est marqué par une dimension tragique très forte. Pourquoi avez-vous choisi de lui offrir une issue différente, « joyeuse et mystérieuse » ?
A. B. : Ce que j’aime, dans la littérature antique, c’est la capacité des Anciens à faire traverser au lecteur toute la palette des passions, du rire aux larmes, en passant par la peur, le doute, le désir, … L’idée, avec ce nouveau volume de la collection, était d’illustrer à quel point rien n’est pleinement manichéen. La littérature est un reflet de la variabilité du quotidien, au cours duquel les bons jours succèdent aux mauvais. Ainsi, les amants malheureux ont pu être heureux et éprouver bien d’autres sentiments que je vous propose de découvrir en me lisant.
L.V.D.C. : L’amour entre Thisbé et Pyrame traverse de nombreuses épreuves dans cette nouvelle version. Que dit-il, selon vous, de la vision antique de l’amour face à l’adversité ?
A. B. : Il n’y a pas de version unitaire de l’amour dans l’Antiquité. Tout l’objet du Banquet de Platon est d’ailleurs d’essayer de comprendre ce qu’est l’amour, tant dans sa dimension physique que dans son approche plus intellective. Toutefois, que l’on songe à l’amour de Pénélope pour Ulysse, à celui du poète Properce pour sa muse littéraire Cynthie – quand bien même elle serait uniquement un être de papier –, il apparaît une capacité certaine des Anciens à faire face, à défendre leur identité, leurs choix et leurs convictions. Il y a donc une tendance fondamentale à la résistance, ce qui est d’ailleurs constitutif de tout enseignant de langues anciennes. Face à tous ceux qui considèrent le latin et le grec comme une variable d’ajustement, il nous faut quotidiennement résister à toutes les épreuves pour continuer à enseigner des langues et des cultures dont nous sommes des passionnés. L’histoire de Thisbé et de Pyrame, telle que je l’aborde, est métaphorique : elle encourage à ne pas baisser les bras et à résister face à l’adversité, aux épreuves, ou encore à l’obscurantisme.
L.V.D.C. : Votre ouvrage peut notamment être utilisé par les enseignants de grec ancien du secondaire français : avec quels niveaux Τὰ τῆς Θίσϐης καὶ τοῦ Πυράμου ἐρωτικά peut-il être utilisé, et dans quels objets d’étude s’insère-t-il ?
A. B. : Le volume Τὰ τῆς Θίσϐης καὶ τοῦ Πυράμου ἐρωτικά est étiqueté « confirmé », en termes de niveau, mais il est en réalité un entre-deux. Les phrases sont plutôt limpides et ne sont généralement pas alambiquées afin de permettre une lecture et une compréhension fluides. Les principales difficultés sont donc grammaticales, de manière sporadique et elles font généralement l’objet d’une explication particulière, au cours du volume. Je pense que l’ouvrage peut être abordé dans le cadre d’une lecture cursive à compter de la classe de 3ᵉ à travers des objets d’étude tels que « le monde méditerranéen », puisque les deux amants parcourent l’ensemble de ce territoire, ou encore « la Grèce dans son unité et sa diversité ». Au lycée, en 2ⁿᵈᵉ, l’axe « figures héroïques » semble bien choisi pour étudier mon œuvre, de même que « récits et témoignages » en 1ᵉ. Les deux amants sont indéniablement des héros du quotidien, ce dont ils témoignent dans l’ouvrage que j’ai composé.
L.V.D.C. : Quels sont les prérequis grammaticaux et lexicaux à maîtriser pour se lancer dans la lecture ?
A. B. : Dans l’idéal, il faut être familier des trois premières déclinaisons, du présent et de l’aoriste de l’indicatif. Ensuite, tout est expliqué. Du point de vue du lexique, hormis les mots extrêmement courants qu’apprend l’helléniste dès les premières semaines de son parcours en grec ancien, tout est indiqué. L’ouvrage est donc très abordable et propose une progressivité dans la lecture, le niveau s’intensifiant petit à petit, graduellement.
L.V.D.C. : Et comment l’utiliser dans le supérieur, en classes préparatoires ou à l’université ?
A. B. : Dans le supérieur, il y a plusieurs usages possibles : soit en lecture cursive, pour le plaisir, en complément des cours et pour avoir une approche différente, à la fois plus souple et plus divertissante ; soit en cours, en proposant des extraits choisis, voire une lecture suivie en classe. J’ai moi-même déjà donné le premier chapitre de Τὰ τῆς Θίσϐης καὶ τοῦ Πυράμου ἐρωτικά à traduire, à mes étudiants, dans le cadre d’un examen. Les spécialistes des langues anciennes se reconnaîtront plutôt dans la première approche que je propose, les non-spécialistes dans la seconde. Cet ouvrage peut aussi être un point de départ pour initier des étudiants à l’écriture en grec ancien, dans un premier temps sur le principe d’un atelier d’écriture, avant de se confronter à l’exercice canonique du thème.