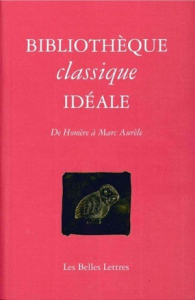
Continuons à redécouvrir Cicéron avec, aujourd'hui, un extrait de la Bibliothèque classique idéale !
De l’amitié est une des dernières oeuvres de Cicéron, écrite en 44 avant J.-C., juste après la mort de César, pendant ces dernières années de sa vie où Cicéron composa de nombreux traités philosophiques. Dans cet ouvrage, Cicéron rapporte une conversation sur l’amitié qui s’est tenue plus de quatre-vingt ans auparavant, en 129 avant J.-C., entre Lélius et ses gendres Scévola et Fannius. Lélius, homme politique admiré pour sa modération et son désintéressement, était célèbre pour l’amitié qui le liait à Scipion Émilien, dit l’Africain, qui détruisit Carthage en 146 avant J.-C. Par l’intermédiaire de ces personnages historiques, Cicéron désire certainement témoigner de l’amitié qui le lia toute sa vie à l’érudit et collectionneur d’art Atticus. C’est d’ailleurs Atticus lui-même qui avait suggéré à Cicéron d’écrire un essai sur le sujet.
Quoi de plus agréable que d’avoir quelqu’un à qui nous osons tout confier comme à nous-mêmes ?
LELIUS. — Pour ma part j’accepterais sans difficulté si j’avais confiance en mes forces. Car c’est un beau sujet et nous avons, comme a dit Fannius[1], tout loisir. Mais suis-je homme à le faire ? Quelle est ma compétence ? Les savants ont l’habitude, les savants grecs, de se faire poser des questions qu’ils traitent immédiatement, si courts soient les délais qu’on leur impose. Grosse affaire, et qui exige un entraînement peu ordinaire. Donc, pour ce qui est de traiter de l’amitié, adressez-vous, s’il vous plaît, à ceux qui se disent spécialistes ; moi je ne peux que vous exhorter à préférer l’amitié à tous les biens ; car rien n’est aussi conforme à la nature, rien ne convient si bien au bonheur comme au malheur.
Mon sentiment est d’abord que l’amitié ne peut exister que chez des hommes de bien. Je ne tranche pas ici dans le vif, comme ceux qui traitent ces questions avec plus de finesse : ils ont raison peut-être, mais ils ne songent pas assez aux besoins de tous les jours. ils disent en effet qu’il n’est d’homme de bien que le sage. Soit. Mais ils entendent par là une sagesse qu’aucun mortel n’a pu atteindre encore. Pour nous, c’est la pratique et la vie de tous les jours que nous devons envisager, et non pas fictions et ambitions. Jamais je ne dirai que Caius Fabricius, Manius Curius, Tibérius Coruncanius, sages aux yeux de nos ancêtres, répondaient à la définition que ces gens-là donnent du sage. Qu’ils gardent donc pour eux le titre de sagesse, avec l’envie qu’il inspire et son obscurité ; qu’ils nous accordent que nos compatriotes furent des hommes de bien. Ils ne le feront même pas : ils soutiendront qu’on ne peut l’accorder qu’au sage. Agissons donc, comme on dit, avec notre gros bon sens. Tous ceux qui se conduisent, qui vivent de telle façon qu’on leur reconnaît bonne foi, intégrité, sens de l’équité, générosité, qui, sans avoir ni cupidité, ni passion, ni folle hardiesse, possèdent une grande fermeté de caractère, comme les personnages que je viens de nommer, tous ceux-là ont été considérés comme des hommes de bien et nous devons aussi, à mon sens, les appeler ainsi, puisqu’ils suivent la nature, autant que l’homme peut le faire, et qu’elle est le meilleur guide vers le bonheur.
Je crois voir en effet que nous sommes tels par nature que tous les hommes ont entre eux un lien de société et qu’il se raffermit dans la mesure où ils sont plus proches les uns des autres. Ainsi préfèrent-ils leurs concitoyens aux étrangers, les membres de leur famille aux autres : entre parents en effet existe une amitié créée par la nature. Elle manque pourtant de solidité. Car l’avantage de l’amitié sur la parenté, c’est que tout sentiment peut disparaître de la parenté, mais non de l’amitié ; s’il n’y paraît plus aucun sentiment, l’amitié perd son nom, la parenté subsiste. La puissance de l’amitié apparaît parfaitement si l’on voit bien qu’en elle le lien tissé par la nature même dans la masse infinie des êtres humains se resserre et se réduit au point que l’affection n’y réunit jamais que deux personnes ou guère plus. Car l’amitié ne peut être qu’une entente totale et absolue, accompagnée d’un sentiment d’affection, et je crois bien que, la sagesse exceptée, l’homme n’a rien reçu de meilleur de la part des dieux. Les uns préfèrent la richesse, d’autres la santé, d’autres encore la puissance, d’autres les honneurs, beaucoup même les plaisirs. Ce dernier choix est digne des bêtes, mais les biens cités avant lui sont fragiles et incertains, dépendant moins de notre volonté que des caprices du hasard. Il en est encore qui voient dans la vertu le souverain bien : à merveille certes, mais c’est la vertu précisément qui crée l’amitié et la maintient, et sans vertu, toute amitié est impossible.
À condition de définir ici la verte d’après les habitudes de la vie courante et de notre langue, de ne pas se laisser entraîner par le prestige du mots, comme font certains savants, de compter comme hommes de bien ceux que l’on considère comme tels, les Paul Emile, Caton, Galus, Scipion, Philus. Ils suffisent, à la vie de tous les jours et laissons de côté ceux qui ne se rencontrent jamais nulle part.
Donc, quand elle lie de tels hommes, l’amitié offre des avantages si grands que je peux à peine déterminer leur importance. D’abord, comme dit Ennius, comment peut-elle être « vivable la vie » qui ne trouve pas l’apaisement dans les sentiments partagés avec un ami ? Quoi de plus agréable que d’avoir quelqu’un à qui nous osons tout confier comme à nous-mêmes ? Quel profit tirerions-nom du bonheur si nous n’avions personne qui pût s’en réjouir aussi bien que nous ? Et il serait difficile de souffrir l’adversité sans un compagnon capable d’en souffrir encore plus que nous. Enfin tous les biens que l’homme recherche ne présentent guère chacun de son côté qu’un avantage particulier : la richesse procure des moyens d’action ; les ressources, de la considération ; les honneurs, des louanges ; les plaisirs, de l’agrément ; la santé, l’absence de douleur et la pleine disposition de nos forces physiques. Mais l’amitié renferme des biens innombrables !
Où que nous allions, elle est à notre disposition ; il n’est point de lieu où elle n’ait sa place, de circonstance où elle gène, où elle pèse ; ainsi l’eau et le feu, comme on dit, ne sont pas plus souvent utiles que l’amitié. Et je ne parle pas ici de l’amitié vulgaire et ordinaire, qui a pourtant elle aussi son charme et ses avantages ; je parle de l’amitié vraie, de l’amitié parfaite, telle que l’ont connue les rares personnages que l’on cite. Car le bonheur devient plus brillant, grâce à l’amitié, et le malheur, qu’elle partage et répartit, plus léger. L’amitié présente donc des avantages particulièrement nombreux et importants, mais elle les surpasse tous à elle seule, en inspirant un doux espoir qui illumine l’avenir et en ne laissant les âmes ni s’affaiblir ni succomber. Car celui qui a devant les yeux un ami véritable a devant soi comme sa propre image idéale. Dès lors les absents deviennent présents, les pauvres riches, les faibles forts et, ce qui est plus difficile à dire, les morts sont vivants : tant ils inspirent d’estime, de souvenirs, de regrets à leurs amis. Ainsi les uns semblent avoir trouvé le bonheur dans la mort et les autres vivre une vie digne d’éloges.
Par ailleurs, si l’on supprime dans la nature le lien que créent les sentiments, ni maison ni ville ne pourra rester debout, l’agriculture même n’existera plus. Si cela n’est pas clair, on peut découvrir la puissance de l’amitié et de la concorde en songeant aux dissensions et aux discordes. Quelle famille en effet est assez ferme, quelle cité assez stable pour empêcher haines et désaccords de les détruire de fond en comble ? Voilà qui permet de juger quel bien l’amitié représente.
Il est même un savant d’Agrigente qui proclamait, dit-on, dans des poèmes écrits en grec, que tout ce que le monde et l’univers entier renferment d’êtres fixes ou mobiles doit la cohésion de ses éléments à l’amitié, leur dislocation à la discorde. Vérité que comprennent les mortels en tout cas et qu’ils prouvent par leur attitude. Ainsi lorsqu’une personne remplit ses obligations envers son ami en s’exposant au danger ou en s’y associant, qui peut refuser de lui attribuer les plus grands éloges ? Quels cris d’enthousiasme a soulevés récemment sur tous les gradins la dernière pièce de mon hôte et ami Marcus Pacuvius, quand il montrait, devant le roi qui ignorait lequel d’entre eux était Oreste, Pylade en train de dire qu’il était Oreste, pour se faire exécuter à la place de son ami, tandis qu’Oreste, conformément à la vérité, répétait sans cesse que c’était lui, Oreste. On se levait pour applaudir cette fiction : que n’aurait-on pas fait en présence de la réalité ? La nature humaine, d’elle-même, révélait nettement son essence : des hommes incapables d’un tel acte en reconnaissaient la valeur chez autrui.
Voilà qui suffit, je crois, pour exprimer mes sentiments sur l’amitié. S’il reste quelque chose à dire, – et je crois qu’il reste beaucoup –, demandez-le, s’il vous plaît, à ceux qui traitent ces sujets.
FANNIUS . — Non, à toi plutôt. Je l’ai certes demandé bien souvent à ces gens-là aussi, et je les ai écoutés, sans regret d’ailleurs ; mais ton exposé est d’une autre façon.
SCEVOLA. — Tu le dirais bien plus, Fannius, si tu avais assisté récemment, dans les jardins de Scipion, aux discussions sur l’organisation de l’État. Quel avocat la justice a trouvé en lui alors, contre le discours si soigné de Philus !
FANNIUS . — Bien sûr, sujet facile pour un homme si juste, que la justice à défendre.
SCEVOLA . — Et l’amitié donc ? N’est-ce pas un sujet facile pour qui a gagné une si grande gloire en la cultivant avec tant de fidélité, de fermeté, de justice.
LELIUS . — C’est me faire violence. Peu importe en effet la nature de la contrainte que vous exercez sur moi : il y a contrainte. Quand mes gendres expriment un désir, et en particulier si leur but est honnête, il est déjà difficile de s’y opposer, mais surtout il ne serait même pas équitable de le faire.
Bien souvent donc, quand je réfléchie à l’amitié, il me semble que le problème essentiel est de savoir si ce sont la
faiblesse et le besoin qui poussent l’homme à rechercher l’amitié, l’espoir qu’un échange de services rendus et reçus lui permettra d’obtenir d’autrui, puis de lui rendre à son tour, ce qu’il serait incapable d’obtenir à lui seul, ou bien si ce n’est pas plutôt là une simple propriété de l’amitié dont la cause est ailleurs, plus profonde, plus belle, issue plus directement de la nature même. Car l’amour, qui donne à l’amitié son nom, est le premier élan qui pousse à la sympathie. Quant au profit, il arrive souvent qu’on en retire même de personnes envers lesquelles on affiche une considération qui simule l’amitié, des égards dus aux circonstances. Or dans l’amitié il n’est rien de feint, rien de simulé : elle n’est que vérité et sincérité. C’est donc la nature, à mon avis, plutôt que l’indigence, qui est à la source de l’amitié, une inclination de l’âme accompagnée d’un certain sentiment d’amour, plutôt que le calcul du profit qu’on en retirera.
LELIUS . — Oui, écoutez, vous que j’estime tant, les idées que nous échangions souvent, Scipion et moi, au sujet de l’amitié.
Malgré ce que je viens de dire, il pensait que rien n’est plus difficile que de faire durer une amitié jusqu’au dernier jour de la vie. Car il arrive souvent que les intérêts des deux amis ne coïncident plus ou bien que leurs positions politiques ne s’accordent plus ; souvent encore les caractères se modifient, disait-il, tantôt sous l’effet du malheur, tantôt sous le poids de l’âge. Et il prenait comme exemple l’évolution semblable qui fait qu’au début de notre vie les affections si vives de notre enfance sont souvent abandonnées en même temps que la toge prétexte ; et si elles durent jusqu’à l’adolescence, elles sont brisées parfois par les rivalités que soulève soit un projet de mariage, soit quelque avantage que les deux amis ne peuvent obtenir en même temps. Quant à ceux qui persistent plus longtemps encore dans leur amitié, ils la voient souvent chanceler quand ils se trouvent en compétition pour quelque magistrature. Car il n’est pire fléau de l’amitié que le désir de s’enrichir, chez la plupart des hommes, que la lutte pour les magistratures et pour la gloire chez les meilleurs ; elle engendre souvent les plus vives inimitiés entre les amis les plus intimes. Il naît encore de profonds désaccords, et le plus souvent à juste titre, quand on demande à un ami ce qu’on n’est pas en droit de lui demander, comme de servir une passion ou d’aider à une injustice. Ceux qui refusent se conduisent fort bien, mais ils sont accusés de trahison envers les droits de l’amitié par ceux auxquels ils ne veulent pas obéir ; et ceux qui osent demander n’importe quoi à un ami avouent par leur demande même qu’ils sont prêts à tout faire pour aider un ami. Leurs récriminations étouffent en général les relations les mieux établies et même engendrent des haines éternelles. Voilà les fatalités, pour ainsi dire, qui menacent les amitiés, si nombreuses que, pour échapper à toutes, la sagesse ne suffit pas, d’après Scipion, il faut encore de la chance.
De l’amitié, 17-35
[1] Fannius, Curius et Coruncanius se distinguèrent par leur bravoure. Fannius et Curius combattirent Pyrrhus et Coruncanius les Étrusques. Ils vécurent au IIIe siècle avant J.-C.