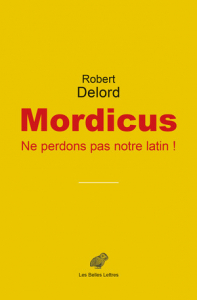
Voici un extrait de Mordicus. Ne perdons pas notre latin ! publié tout récemment par Robert Delord aux éditions Les Belles Lettres :
Loin de moi l’idée de jouer les laudator(es) temporis acti, d’après la belle expression du regretté Lucien Jerphagnon 1, mais, si l’enseignement du latin est unique et irremplaçable, c’est à n’en pas douter parce qu’il est à bien des égards à contrecourant de notre époque et de notre société, et tout à fait intempestif.
Ni passéiste, ni avant-gardiste, ni soumis aux aléas des programmes et méthodes scolaires, ni figé dans le marbre, l’enseignement du latin constitue dans la scolarité d’un élève, le dernier observatoire hors du temps qui lui permet d’étudier en diachronie langue, histoire et civilisations. Le cours de latin se présente comme un antidote à cette fuite en avant de la société moderne qui a également gagné l’école. Il est à la fois un éloge de la lenteur dans un monde trop pressé, une ouverture culturelle dans une époque de repli sur soi généralisé et une ode à la connaissance gratuite dans une société obnubilée par la rentabilité et les compétences néomanagériales.
Dans notre société du zapping et de l’obsolescence programmée, à l’heure où ce ne sont plus les consuls romains qui donnent leurs noms aux années mais la dernière génération de smartphones frappés d’une pomme, consacrer du temps à l’étude de langues mortes, réputées difficiles et s’arrêter pour dialoguer avec les auteurs, les hommes et les femmes du passé représente, en soi, un pied-de-nez au système tout entier. L’étude du latin est un apprentissage au long cours, une pause unique dans la course des professeurs sans cesse en train de hâter leurs élèves pour boucler des programmes scolaires toujours renouvelés, pour couvrir absolument un objet d’étude entre deux périodes de vacances scolaires.
Cela tient tout d’abord au fait que, dans la plupart des établissements, le professeur de latin, au collège comme au lycée, suit ses élèves sur trois ans de la 5e à la 3e, puis de la seconde à la terminale. Ces trois années permettent à l’enseignant non seulement de bien mieux connaître ses élèves, ce qui est un avantage non négligeable, spécialement à l’âge de l’adolescence, pour suivre leur évolution et leurs progrès sur le long terme. Il peut ainsi, sur les trois années, moduler le rythme des apprentissages pour l’adapter au mieux au niveau de la classe.
Cette fréquentation suivie entre professeur et étudiants fait naître une grande complicité, permet d’instaurer un véritable suivi pédagogique et de lutter contre le phénomène d’anonymat des élèves parfois ressenti en conseil de classe. Les élèves latinistes ont en effet l’impression d’avoir « un prof à eux ». À cette connivence intellectuelle, il faut encore ajouter les inoubliables moments partagés lors des voyages scolaires en Italie ou ailleurs. Tout cela explique certainement pourquoi le professeur de latin revient régulièrement dans les témoignages de personnes, arrivées à l’âge adulte, évoquant les enseignants qui ont le plus marqué leur scolarité.
La deuxième raison tient dans l’objet même de l’enseignement du latin, le texte littéraire, et l’activité de traduction qui a complètement disparu de l’enseignement des langues en France, à l’exception de celui des langues anciennes. En effet, rendre fidèlement et dans un bon français la pensée d’un auteur ayant vécu il y a deux mille ans nécessite plus de temps qu’apprendre à demander son chemin, commander à manger ou essayer de savoir dans quelle pièce de la maison se trouve Brian.
Ainsi, le professeur de latin, même si cela est fortement déconseillé par l’Institution, passe parfois une séance entière avec ses élèves pour traduire seulement deux ou trois phrases à la syntaxe un peu coriace. Et il ne faut pas croire que cela tourne forcément à la séance de torture pour les élèves. Au contraire, si le travail est guidé habilement par le professeur, les élèves en tirent une accoutumance au temps long ainsi que l’incomparable satisfaction intellectuelle d’être « venus à bout » du texte, de l’avoir « épuisé », de s’en être rendus maîtres plutôt que de l’avoir subi passivement. La traduction des textes antiques est en fait l’exact opposé du concept d’efficience qui consiste à produire le maximum de résultats avec le minimum d’efforts. Traduire un texte antique, c’est justement fournir un maximum d’efforts pour parvenir à un résultat généralement assez peu spectaculaire.
Pour expliquer le travail de la traduction à mes élèves, j’utilise la métaphore de la sculpture. Le texte à traduire se présente d’abord comme un gros bloc de marbre lisse qui semble ne présenter aucune prise. Il faut d’abord commencer par le dégrossir lentement pour élaborer une ébauche. On passe seulement ensuite à la véritable étape de traduction en ciselant la pierre avec délicatesse et en respectant les veines du marbre entre lesquelles il faut savoir lire. Une fois la forme générale de l’œuvre dégagée avec maintes précautions, il faut encore en affiner les contours puis la polir patiemment pour en faire ressortir les détails et y ajouter l’éclat de la traduction proprement littéraire. Pas de requête instantanée, donc, pour accéder au secret du texte latin qui réclame une longue enquête, une quête patiente.
Rebelle marginal et marginalisé, le prof de lettres classiques pourrait finalement faire aujourd’hui sienne la devise des punks des années 1970, « No future ! », dénonçant un système obsédé par la vitesse, privilégiant l’immédiateté et le « tout tout de suite » dans lequel le futur n’a plus vraiment de place ni de valeur. La notion de temps long est aujourd’hui trop souvent ignorée quand elle n’est pas décriée par ceux-là mêmes qui devraient la défendre encore à l’école. Cette prise en compte du temps long est pourtant ce qui permettrait aux citoyens et encore plus aux hommes et femmes politiques de prendre des décisions qui visent au-delà du « court-termisme » de leurs mandats et arrangements locaux ou nationaux.