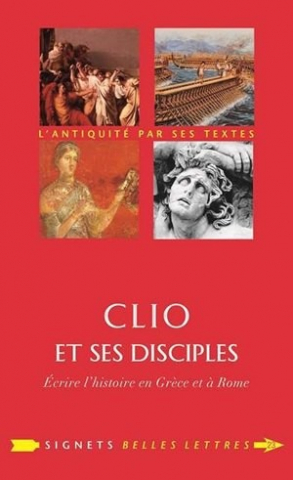
Amis des Classiques, nous sommes tous tristes de la mort de Jean d'Ormesson. Pour lui rendre hommage, voici l'entretien qu'il avait accordé à Marie Ledentu, Laure de Chantal et Gérard Salamon pour le Signet Clio et ses disciples. Ecrire l'histoire dans l'Antiquité (Les Belles Lettres, 2014).
Vous êtes un lecteur de textes historiques. Est-ce pour vous une lecture de détente ou lisez-vous pour vous informer ? Que recherchez-vous dans la lecture d’un texte d’historiographie ?
Jean d’Ormesson. – Vous m’interrogez, mais je ne suis pas un spécialiste : je me considère plutôt comme un amateur. J’ai retrouvé dans votre recueil des historiens que je connaissais (Thucydide, Tacite, Suétone…) ; j’en ai découvert d’autres, par exemple Zosime, Silius Italicus, Velleius Paterculus dont les noms me sont familiers, mais dont les œuvres me le sont moins… Je pense que les lecteurs qui auront en main votre livre évolueront aussi entre connaissance et découvertes en particulier grâce aux rencontres entre les époques et les genres que favorise le classement thématique que vous avez adopté.
On associe l’écriture de l’histoire grecque et romaine à quelques grands auteurs, mais il y en a d’autres moins connus, que vous nous faites découvrir et qui s’inscrivent dans une tradition et participent à celle-ci.
Pour répondre à votre question, ce que je recherche dans les textes anciens, c’est qu’ils me paraissent indispensables pour comprendre l’avenir. Ce qui nous intéresse tous en effet, c’est le futur, ce qui nous attend. Je connais évidemment la thèse de Paul Valéry pour qui l’histoire n’apprend rien sur l’avenir ; il n’en reste pas moins qu’elle fait marcher un certain nombre de mécanismes qui sont utiles pour nous y retrouver. Il me semble que s’il est impossible de connaître cet avenir de manière anticipée, on peut néanmoins s’y préparer par la connaissance du passé. Aussi me semble-t-il que l’abandon des études classiques, un des drames majeurs de l’enseignement d’aujourd’hui selon moi, risque de compromettre, en nous coupant de nos racines, cet accès à la connaissance.
Je me suis occupé pendant de longues années des sciences humaines à l’UNESCO : j’ai été secrétaire général adjoint du conseil international de la philosophie et des sciences humaines puis secrétaire général puis président. Dans cette fonction, j’ai succédé à un grand historien de Rome, Ronald Syme, homme que j’ai beaucoup admiré. Dans ces missions, j’ai pu observer qu’il s’est développé autour des sciences humaines une certaine culture ; mais elle ne doit pas nous dispenser de la connaissance des grands textes classiques. Personnellement, je reviens beaucoup à la lecture de ces textes et je m’éloigne un peu des sciences humaines. Ainsi, je relis actuellement, ou plutôt je lis (même si j’en avais une idée), les œuvres complètes de Tacite. Ce sont des textes admirables.
Il faut les lire d’ailleurs comme les lisait Montaigne ; ils nous apprennent quelque chose sur nous. On comprend bien pourquoi l’histoire grecque et romaine a été si importante pendant des siècles et des siècles ; je dirais que c’est une espèce d’archétype de l’histoire universelle et que l’histoire universelle est comme une extension, au sens presque marxiste du terme, de l’histoire grecque et romaine.
Je pense pour finir que lire l’histoire écrite par les Anciens donne plus de plaisir, plus de savoir, plus de capacités pour comprendre le passé et plus largement la vie.
Ce que vous nous dites, c’est que dans l’histoire ancienne il y a des leçons pour le présent ?
Sûrement ! On voit bien que nous nous plaignons souvent de l’époque dans laquelle nous vivons et l’actualité nous y invite. Mais, quand on lit les Histoires de Tacite, on se dit que c’était une époque absolument effroyable : je songe aux quatre empereurs de l’année 69, Galba, Othon, Vitellius… et Vespasien ; heureusement qu’il est arrivé après ! Finalement, c’était pire alors qu’aujourd’hui. Une telle lecture peut nous inviter au scepticisme sur l’histoire ; à tout le moins, elle nous amène à relativiser nos propres malheurs.
Vous nous avez dit que vous lisiez Tacite. Est-ce que vous voyez des convergences ou des divergences entre la manière dont les Anciens écrivaient l’histoire et la manière dont l’écrivent les historiens modernes ?
Je pense que les historiens anciens sont des maîtres incomparables. Peut-être y a-t-il eu des historiens modernes dignes de ces grands modèles : j’ai personnellement beaucoup d’admiration pour Michelet, Gibbon, Braudel, Le Goff et tant d’autres. Mais dans l’ensemble, les historiens d’aujourd’hui ne dépassent pas les Anciens. Je ne crois pas qu’en histoire du moins nous ayons fait d’énormes progrès. Il y en a eu sans doute sur l’acribie, la vérification des sources, l’objectivité. Mais sur la capacité à faire voir et vivre le passé, à traduire dans les mots ce qui a été vécu, il me semble que l’historiographie ancienne reste une référence. Avec les historiens, nous nous promenons un peu dans des lieux et des théâtres divers, sur le Forum et à Athènes. C’est ce qu’il y a de si intéressant pour nous quand on va par exemple dans ces villes berceaux de la civilisation : il faut avoir à la main les œuvres des historiens grecs et latins ; on comprend alors d’où nous venons.
Y a-t-il des sujets, des titres, des textes qui vous ont intrigué, qui ont davantage retenu votre attention que d’autres dans ce parcours que nous avons essayé de reconstituer ?
Je dirais d’abord que le découpage thématique que vous avez adopté est très intéressant et contribue au plaisir de la lecture. C’est la première fois que je vois l’histoire présentée ainsi. Je pense à votre premier chapitre intitulé « L’histoire et ses lecteurs » : vous avez eu raison d’introduire d’emblée la figure du lecteur dans l’écriture de l’histoire, car il n’y a pas d’histoire, au sens de Geschichte, sans lecteur.
J’ai été également frappé par le chapitre « Histoire et poésie ». Tous les historiens grecs et latins ont été des écrivains : c’est une leçon qui n’a pas été perdue tout à fait puisque Michelet c’est un peu la même chose que Tacite. Mais certains furent même des poètes comme Silius Italicus ou Lucain. On tire de la lecture de leurs œuvres une extraordinaire jouissance esthétique. C’est une lecture qui vous transporte.
Que faut-il donc selon vous pour faire une bonne histoire, pour être un bon historien ?
Pour moi, un historien doit d’abord être un écrivain et sur ce point les historiens anciens nous donnent, dans leurs œuvres, des leçons de style. Les romanciers auraient avantage à lire ces historiens avant de se mettre au travail : j’ai relu avec admiration l’Iliade et l’Odyssée et plus récemment l’Énéide – dans la nouvelle traduction de Paul Veyne aux Belles Lettres : c’est un formidable roman. Car il faut savoir recréer le passé et pour cela il faut de l’imagination. On peut d’ailleurs se demander si le talent de l’historien n’en vient pas à transformer un peu l’histoire elle-même, voire à la modifier : « C’est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l’empire[1]. »
Mais en même temps il y a, je crois, chez Tacite cette formule pour définir son projet d’historien : sine ira et studio « sans colère et sans parti pris ». Elle nous rappelle que la première loi de l’histoire est l’objectivité. D’ailleurs on voit très bien déjà chez les historiens grecs et latins la présence d’une critique des sources.
Dans notre recueil, avez-vous reconnu une identité d’historiens ou plusieurs ?
Pour définir l’historien ancien, on s’en tient souvent à la trilogie en « T », à Thucydide, Tite-Live, Tacite. Mais il y en a d’autres moins connus, voire ignorés, que vous nous rappelez. En vous lisant, il y a de nombreuses questions qui viennent à l’esprit et notamment celle-ci : est-ce qu’il n’y a pas à côté de Thucydide, Tite-Live, Tacite, Suétone des auteurs qui pourraient rivaliser avec eux et qui ont moins été favorisés par l’histoire ? Est-ce que l’histoire a toujours été juste avec eux ? Le regard que vous portez et que nous portons sur les grands historiens n’est-il pas tributaire d’une certaine tradition ? J’imagine qu’en vous lisant on peut vraiment se poser cette question. Il y a un de vos chapitres qui s’appelle « La grande histoire ». Mais est-elle écrite à jamais ? Des personnages et des auteurs y figurent-ils qui ne devraient pas y être et d’autres qui n’y sont pas et qui devraient y être ? On a aussi perdu beaucoup d’historiens ; même chez Tacite et Tite-Live il y a des trous énormes. Nous sommes tributaires de la tradition manuscrite. Est-ce que l’appréciation que nous avons des historiens serait modifiée si nous y avions le reste de leur œuvre ? Très certainement.
À Rome, César et Auguste ont écrit l’histoire dans leurs actes, mais aussi leur histoire dans leurs œuvres. D’après vous, est-ce qu’un homme d’État peut être un historien, est-ce qu’il doit être un historien ?
Je dirais d’abord que les hommes d’État français par le passé étaient souvent formés à l’École normale supérieure. Aujourd’hui les hommes et les femmes politiques sortent plutôt de l’ENA, ce sont des technocrates. Il faudrait qu’ils lisent l’histoire politique racontée par Thucydide ou Tacite ; elle leur serait plus utile que beaucoup de livres techniques.
Les hommes d’État d’aujourd’hui seraient-ils capables d’écrire l’histoire ? Il y en a un qui l’a écrite, c’est de Gaulle, mais c’était il y a longtemps. Il y a des rapports évidents entre l’écrivain et le pouvoir, aussi bien dans l’Antiquité qu’aujourd’hui. De cela il reste quelque chose : on voit que tout homme politique se dit que pour arriver, il lui faut écrire un livre ! C’est à peu près tout ce qui est resté de la pratique ancienne.
Pouvoir et histoire, pouvoir et littérature, pouvoir et poésie étaient inséparables dans l’Antiquité et devraient l’être encore. On voit bien chez de Gaulle la présence de la poésie. Je vais vous donner un exemple : dans le fameux discours de Londres, le 18 juin, il lance un appel célèbre et il y a une phrase qui est restée dans toutes les mémoires : « La France a perdu une bataille, elle n’a pas perdu la guerre. » Qui a écrit cette phrase ? C’est de Gaulle, mais il l’a prise chez Milton. C’est une phrase du Paradis perdu, traduite par Chateaubriand, que de Gaulle avait lu. Cela prouve que poésie et histoire sont liées : c’est la même chose ou presque.
Les historiens grecs et romains, quand ils écrivaient l’histoire, le faisaient souvent quand ils étaient retirés des affaires publiques, soit par les hasards de la vie, soit par des contraintes extérieures. Est-ce que vous considérez qu’il y a dans une vie ou dans une carrière des moments plus propices à l’écriture de l’histoire, au travail de réflexion sur l’histoire ?
On voit bien, surtout aujourd’hui où les problèmes sont tellement difficiles, les communications tellement rapides, où vous êtes constamment informé de ce qui se passe dans le monde, que l’on est littéralement enfoui sous les événements. Dans ce contexte, un homme politique ne peut écrire, et surtout se consacrer à l’écriture de l’histoire, que s’il est battu, à la retraite, ou malade. Mais en réalité, c’était déjà le cas dans l’Antiquité : pouvoir et histoire sont inséparables, mais l’exercice du pouvoir est incompatible avec l’écriture de l’histoire. Il me semble que César écrivait quand il était au pouvoir, mais ce qu’il écrivait n’était pas de l’histoire.
Pour finir cet entretien, nous voudrions vous soumettre une question plus personnelle. Thucydide voulait écrire avec la guerre du Péloponnèse un ktéma eis aei, « un acquis pour toujours ». Quel est votre rapport avec la postérité, à vous dont les œuvres vont bientôt rejoindre la collection de la Pléiade ?
Mon rapport à la postérité, c’est la crainte et le tremblement ! Je dirais que l’entrée dans la Pléiade m’a fait plaisir. Ce n’est pas du tout une garantie pour l’avenir, mais un instrument pour l’avenir. On m’a donné un laissez-passer : on n’aura pas à chercher après ma mort des textes qui ont disparu. Mais qui décide de l’avenir d’une œuvre ? On le voit très bien dans votre livre. Qui décide que Tacite est Tacite, que Thucydide est un grand auteur ? Est-ce que ce sont les Académies, les Universités ? Non, ce sont les lecteurs. Mais ce ne sont pas les lecteurs d’aujourd’hui, influencés par les médias, par la mode, et c’était le cas dans le passé ; il y avait déjà des modes auxquelles cédaient les contemporains. C’est le public à venir qui décide. Il y a une formule magnifique d’Homère « l’avenir est sur les genoux des dieux ». Eh bien, la postérité est sur les genoux des dieux, et les dieux, c’est le public de demain. Nous revenons à la question du début : est-ce que l’histoire est tout à fait juste ? C’est ce qu’il y a de plus juste possible. Et quand on lit Thucydide, Tacite, Tite-Live, on se dit que le jugement de la postérité est assez juste.
[1] François René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.
Dans la même chronique

Entretien tragique avec Christine Mauduit

Entretien rhétorique avec Stéphane Marchand, Pierre Ponchon et André Rehbinder
Dernières chroniques

La Note Antique – La lyre d'Hermès
