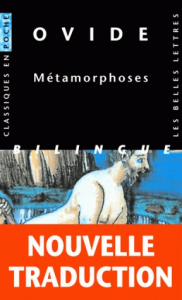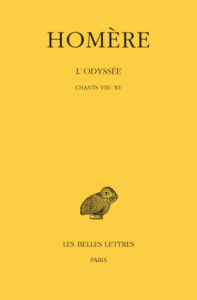Silius Italicus, La Guerre punique, XIII, 579-601, texte établi et traduit par P. Miniconi et G. Devallet, CUF, 1979
Quel immense rassemblement de tous les monstres parqués dedans ces salles gîte ici et terrifie les mânes en mêlant leurs cris sourds ! Le Chagrin qui ronge, et la Maigreur qui suit les maladies funestes, et l’Affliction qui se nourrit de larmes, et la Pâleur privée de sang, et les Soucis et les Traîtrises, et, d’un côté, la plaintive Vieillesse, de l’autre, l’Envie qui s’étreint la gorge à deux mains, et, mal hideux qui peut conduire au crime, la Misère, et l’Erreur à la marche incertaine, et la Discorde, qui prend plaisir à mélanger le ciel aux eaux ; là siègent Briarée qui, de ses cent bras, ouvre à l’ordinaire les portes de Dis, et le Sphinx, écartant ses lèvres de femme imprégnées de sang, et Scylla, et les Centaures farouches et les ombres des géants. Quand Cerbère, que voici, a rompu ses chaînes et parcourt le Tartare, Allecto elle-même non plus que Mégère enflée de fureur n’osent approcher le fauve qui, une fois brisés les mille anneaux qui l’enchaînaient, aboir et enroule autour de ses flancs sa queue de vipère.
À droite, étendant la chevelure de ses branches touffues, se dresse un if immense, arrosé par l’eau du Cocyte qui en fait croître le feuillage. Là, des oiseaux sinistres, le vautour nourri de cadavres, et de nombreux hiboux et la Strige au plumage éclaboussé de sang, et les Harpyes, font leur nid, et leur rassemblement peuple tout le feuillage ; l’arbre retentit de leurs sifflements déchaînés.
Ovide, Métamorphoses, VIII, 152-175, texte établi par Georges Lafaye, traduit par Olivier Sers, Classiques en poche, 2009
Dès que sa flotte aborde au pays des Curètes,
Minos par cent taureaux remercie Jupiter
Et accroche au palais les dépouilles conquises.
L’opprobre de sa race a crû. Un monstre hybride
De sa mère publie le bestial adultère.
Minos veut éloigner sa honte de chez lui
En l’enfermant dans un ténébreux labyrinthe.
C’est Dédale, architecte fameux, qui s’en charge,
Faisant en trompe l’oeil, pour mieux brouiller les pistes,
Sinuer les détours de voies multipliées.
Comme joue en Phrygie le Méandre limpide,
Fluant et refluant dans son cours ambigu,
S’élançant vers son eau qu’il voit courir à lui
Et épuise, incertaine, à aller vers sa source
Ou descendre à la mer, sur mille voies Dédale
Répand l’erreur. À peine a-t-il pu retrouver
L’issue du bâtiment, tant tout y est trompeur.
On y loge le monstre ensemble homme et taureau.
Deux fois déjà il s’est repu du sang attique
Tiré au sort tous les neuf ans. À la troisième
Il meurt. Thésée, aidé d’une vierge, renroule
Son fil, et refranchit (nul ne le fit jamais)
L’issue, puis aussitôt enlève Ariane et cingle
Vers Dia, où, cruel, il la laisse à la rive.
Sénèque, Hercule Furieux, 782-812, texte établi et traduit par François-Régis Chaumartin, CUF, (1996) 2008
Puis se montre la demeure de l’avide Dis : là terrifie les ombres le chien cruel du Styx, qui, secouant sa triple tête avec un bruit énorme, garde le royaume. Des couleuvres lèchent sa tête, éclaboussée de sanie, sa crinière est hérissée de vipères, sa queue tortueuse siffle, long dragon. Sa rage répond à son aspect : dès qu’il a perçu des mouvements de pieds, il dresse ses poils, hérissés de serpents qui s’agitent, et il cherche à saisir, de son oreille dressée, le bruit émis, accoutumé qu’il est à entendre même les ombres. Lorsque [Hercule], le fils de Jupiter, se fut posté tout près de l’antre, le chien s’assit indécis, et tous deux furent saisis de frayeur. Voici que, d’un aboiement puissant, il terrifie ces lieux muets ; les serpents sifflent, menaçants, partout sur ses flancs. Le fracas de ce cri redoutable, lancé par sa triple gueule, épouvante jusqu’aux ombres heureuses. Alors lui-même détache de son épaule gauche la tête de Cléones à la gueule farouche, il la lui présente et se protège de cet immense bouclier ; portant de sa main droite victorieuse sa grande massue, il la fait tourner d’un côté puis de l’autre de manière à frapper sans arrêt, il redouble ses coups. Dompté, le chien atténua ses menaces, baissa toutes ses têtes, épuisé, et quitta totalement l’antre. Pris l’un et l’autre de panique, les deux souverains, assis sur leur trône, ordonnent d’emmener l’animal. Moi aussi, ils m’ont donné en présent à Alcide pour répondre à sa demande. Alors, caressant de sa main les énormes cous du monstre, il les attache avec une chaîne d’acier ; oubliant ce qu’il est, le chien, gardien toujours en éveil du sombre royaume, baisse peureusement les oreilles, se laisse emmener, se reconnaît un maître ; museau bas, soumis, il frappe ses deux flancs avec sa queue porteuse de serpents.
Homère, Odyssée, XII, 234-259, texte établi et traduit par Victor Bérard, CUF, 1924
Nous entrons dans la passe et voguons angoissés. Nous avons d’un côté la divine Charybde, et, de l’autre, Scylla. Quand Charybde vomit, toute la mer bouillonne et retentit comme un bassin sur un grand feu : l’écume en rejaillit jusqu’au haut des écueils et les couvre tous deux. Quand Charybde engloutit à nouveau l’onde amère, on la voit, dans son trou, bouillonner tout entière ; le rocher du pourtour mugit terriblement ; tout en bas, apparaît un fond de sables bleus… Ah ! la terreur qui prit et fit verdir mes gens !
Mais, tandis que nos yeux regardaient vers Charybde, d’où nous craignions la mort, Scylla nous enlevait dans le creux du navire six compagnons, les meilleurs bras et les plus forts ; me retournant pour voir le croiseur et mes gens, je n’aperçois les autres qu’emportés en plein ciel, pieds et mains battant l’air, et criant, m’appelant ! et répétant mon nom, pour la dernière fois : quel effroi dans leur coeur ! Sur un cap avancé, quand, au bout de sa gaule, le pêcheur a lancé vers les petits poissons l’appât trompeur et la corne du boeuf champêtre, on le voit brusquement rejeter hors de l’eau sa prise frétillante. Ils frétillaient ainsi, hissés contre les pierres, et Scylla, sur le seuil de l’antre, les mangeait. Ils m’appelaient encore ; ils me tendaient les mains en cette lutte atroce !… Non ! jamais, de mes yeux, je ne vis telle horreur, à travers tous les maux que m’a valus sur mer la recherche des passes !
Platon, Phèdre, 229e, Texte établi par C. Moreschini et traduit par P. Vicaire, CUF, (1985) 2002
PHÈDRE – Mais par Zeus dis-moi, Socrate : tu crois, toi, que cette fable est vraie ?
SOCRATE – Si j’en doutais, comme les savants, je ne ferais rien d’original. Et je donnerais aussitôt une belle explication scientifique : je dirais qu’un vent boréal l’a fait tomber au bas des rochers voisins tandis qu’elle jouait avec Pharmacée ; qu’elle est morte ainsi, et que la légende est née de son enlèvement par Borée. Pour ma part, mon cher Phèdre, j’estime qu’en général les explications de cet ordre ont de l’agrément, mais il y faut trop de talent, trop de travail, et l’on y sacrifie son bonheur, pour cette simple cause qu’on est ensuite obligé de rectifier l’image des hippocentaures, et puis celle de la Chimère – sans compter le flot des créatures de ce genre, les Gorgones, les pégases, et toute la multitude des monstres aux formes extravagantes. Si l’on est sceptique et si l’on réduit chacun de ces êtres à la mesure du vraisemblable, la pratique de cette science un peu grossière demandera beaucoup de temps. Moi, je n’ai pas de temps à donner à ces choses-là et en voici la raison, mon ami : je ne suis pas encore capable, comme le veut l’inscription de Delphes, de me connaître moi-même ; je trouve donc ridicule, quand je suis encore dans l’ignorance sur ce point, d’examiner ce qui m’est étranger. Aussi, je laisse de côté ces fables, je m’en rapporte là-dessus à la tradition, et comme je le disais à l’instant ce n’est pas elles que j’examine, c’est moi-même : suis-je un animal plus complexe et plus fumant d’orgueil que Typhon ? suis-je une créature plus paisible et plus simples, qui participe naturellement à une destinée divine et reste étrangère à ces fumées ?