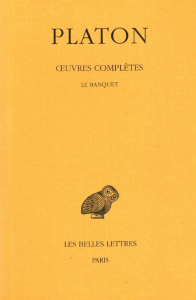Les deux Éros
L’amour est un dieu, pour les Grecs comme pour les Latins. Dans la Théogonie, le récit de la naissance du monde, Hésiode affirme même qu’il est l’un des premiers. Il y a Abîme, le chaos créateur, puis la terre, la matière dont toutes les choses vont naître. Vient ensuite « Amour, le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir ». Le dieu, auquel Hésiode ne donne aucune descendance, est la force qui contraint les éléments à s’unir. Gare à ceux qui procréent sans amour, ou pire, seuls : leur descendance est monstrueuse. S’il faut être deux, au moins, pour s’accoupler, Amour lui-même est double, car à l’énergie sans visage des débuts s’ajoute bientôt un nouvel Amour, le compagnon d’Aphrodite, déesse du plaisir et de la beauté. Il se nomme Éros pour les Grecs et Cupidon pour les Latins. Sous ces deux noms, il est représenté tantôt sous l’apparence d’un enfant, tantôt sous les traits d’un jeune adolescent à la beauté grave. Son lignage est ambigu : est-il né sans père, comme le suggère Hésiode, ou bien est-il le fruit adultérin de Vénus et de Mars ? Les philosophes quant à eux, sont perplexes : à côté de l’amour sensuel, condamnable et bas, se tient l’amour intellectuel, le fameux « amour platonique », désir qui conduit les âmes jusqu’aux plus hautes sphères de la philosophie. La division entre amour sacré et amour profane connaît par la suite une grande fortune dans la spiritualité chrétienne, attachée à la théologie du Dieu d’Amour. Grecs, Latins, païens, philosophes et chrétiens, tous sacrifient à l’autel de l’amour.
Amour sacré et Amour profane
Platon, Œuvres complètes. Tome IV, 2e partie : Le Banquet, 180d-182a. Notice de Léon Robin. Texte établi et traduit par Paul Vicaire avec le concours de Jean Laborderie. Les Belles Lettres, 4e tirage (1989), 2008.
« Nous savons tous qu’il n’y a pas, sans Amour, d’Aphrodite. Si donc il n’y avait qu’une Aphrodite, il n’y aurait qu’un Amour. Mais comme elle est double, il y a de même, nécessairement, deux Amours. Comment nier qu’il existe deux déesses ? L’une, la plus ancienne sans doute, n’a pas de mère : c’est la fille du Ciel, et nous l’appelons Uranienne, « la Céleste » ; l’autre, la plus jeune, est fille de Zeus et de Dioné, nous l’appelons Pandémienne, la « Populaire ». Dès lors, nécessairement, l’Amour qui sert l’une doit s’appeler Populaire, et celui qui sert l’autre, Céleste. Il faut sans doute louer tous les dieux ; mais cela étant admis, quel domaine revient à chacun des deux Amours ? C’est ce qu’on doit essayer de dire. Toute pratique se caractérise en ceci : par elle-même, quand elle a lieu, elle n’est ni belle ni laide. Ainsi ce que maintenant nous faisons, boire, chanter, causer, rien de tout cela n’est beau par soi-même ; mais, dans la pratique, à telle manière correspond tel résultat, car en suivant les règles du beau et de la rectitude une pratique devient belle, sans rectitude au contraire, elle devient laide. Il en est de même de l’acte d’aimer, et tout amour n’est pas beau, ni digne d’éloge ; l’est seulement celui qui porte à aimer bien.
« Or celui qui relève de l’Aphrodite Populaire est véritablement populaire et opère au hasard : c’est celui des hommes vulgaires. D’abord l’amour de ces gens-là ne va pas moins aux femmes qu’aux garçons ; ensuite au corps de ceux qu’ils aiment plutôt qu’à l’âme, enfin aux plus sots qu’ils puissent trouver : ils n’ont en vue que d’arriver à leurs fins, sans nul souci de la manière – belle, ou non. D’où vient que dans la pratique ils rencontrent au hasard soit le bien, soit également son contraire. Cet Amour-là, en effet, se rattache à la déesse qui de beaucoup est des deux la plus jeune, et qui par son origine participe de la femelle comme du mâle. L’autre Amour, lui, participe de l’Aphrodite Céleste ; celle-ci, tout d’abord, est étrangère à l’élément féminin[1] et participe seulement du sexe masculin ; ensuite elle est la plus ancienne, et ignore l’impulsion brutale. De là vient que se tournent vers le sexe mâle ceux que cet Amour inspire : ils chérissent ainsi le sexe qui par nature est le plus et le plus intelligent. Et l’on peut reconnaître, jusque dans ce penchant à aimer les garçons, ceux qui sont purement poussés par cet amour, car ils n’aiment pas les garçons avant qu’ils commencent à faire preuve d’intelligence. Or, cela n’arrive que vers le temps où la barbe leur pousse. Ils sont prêts, je crois, en commençant de les aimer à partir de cet âge, à rester liés avec eux toute la vie, à partager leur existence, au lieu d’abuser de la crédulité d’un jeune sot, de se moquer de lui, et de s’en aller courir après un autre. Il faudrait même une loi qui interdise d’aimer les enfants : ainsi on ne gaspillerait pas tant de soins pour un résultat imprévisible. Car on ne peut prévoir ce que deviendra un enfant, qu’il s’agisse de vice ou de vertu, et tant au moral qu’au physique. Les hommes de bien, sans doute, s’imposent d’eux-mêmes de bon gré cette loi. Mais il faudrait aussi que les amants vulgaires dont nous parlons subissent une contrainte de même ordre, et semblable à celle, que nous leur imposons dans la mesure du possible, de ne pas aimer les femmes de condition libre. Ce sont eux en effet qui ont discrédité l’Amour, et donné à certains l’audace de dire qu’il est honteux de céder à un amant. Si l’on dit cela, c’est qu’on observe le manque de tact et d’honnêteté de ces amants-là, alors que nul acte au monde ne mérite d’être blâmé quand la convenance et la loi sont respectées.
Apulée, Apologie, XII. Texte établi et traduit par P. Vallette. Les Belles Lettres, 4e tirage, 2002.
Et je ne parle pas de cette haute et divine pensée de Platon[2], qu’à peu d’exceptions près, les âmes pieuses connaissent, mais que tous les profanes ignorent : c’est à savoir qu’il y a deux déesses Vénus, dont chacune préside à un genre d’amour, et règne sur des amants distincts. L’une est la Vénus populaire : agitée d’un amour vulgaire, elle incite, impérieuse, aux dérèglements de la passion l’esprit non seulement des humains, mais des animaux domestiques et sauvages, subjugue les créatures par sa violence effrénée et brutale, et tient leurs corps asservis et captifs dans ses embrassements. L’autre, la Vénus céleste, est celle de l’amour noble ; elle ne veille que sur les hommes, et encore sur un petit nombre ; elle n’a ni aiguillons ni charmes pour faire tomber ses fidèles en de honteux égarements. Car son amour n’a rien de voluptueux ni de lascif : sans parure, au contraire, et plein de gravité, c’est sur la beauté morale qu’il compte pour incliner ses amants à la vertu et, si parfois il éveille de l’intérêt pour un beau corps, il en écarte tout manque de respect ; car si la beauté corporelle est digne d’être aimée, c’est dans la mesure où elle rappelle aux âmes, qui sont d’essence divine, la beauté qu’elles ont jadis contemplée, vraie et pure, au séjour des dieux. Aussi, et bien qu’Afranius[3], avec beaucoup d’élégance, ait écrit : « L’amour est pour le sage ; aux autres, le désir ».
[1]. Dans Hésiode, Aphrodite fille d’Ouranos n’a pas de mère.
[2]. Allusion au mythe célèbre dans lequel Platon oppose l’une à l’autre l’Aphrodite ----, et l’Aphrodite ---- (Banquet, p. 180c sq.).
[3]. Auteur de togatae vers la fin du iid siècle av. J.-C.