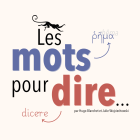À l’occasion de la parution de L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l'école d'un humaniste érudit dans la collection « Les Belles Lettres / essais » aux éditions Les Belles Lettres, le philologue Luigi-Alberto Sanchi nous fait l'honneur d'un entretien exclusif pour explorer la pensée et l’héritage de cet humaniste majeur.
La Vie des Classiques : Comment vous présenter en quelques mots ?
Luigi-Alberto Sanchi : Je suis un chercheur spécialisé dans l'histoire de la philologie classique et je m'occupe en particulier de l'époque de la Renaissance en France. Parallèlement, je tente de m'investir pour favoriser le développement en France d'une culture littéraire démocratique de haut niveau, à base latine et grecque, en suivant l'exemple de mes chers humanistes.
L.V.D.C. : Quels sont les êtres, de chair ou de papier, qui ont rythmé et déterminé votre parcours intellectuel ?
L.-A. S. : La première est Maria Augusta Pecchia, qui fut mon professeur de Lettres (latines et italiennes) dans les trois années du Lycée, en Italie. Députée durant deux législatures, elle m'a montré le lien profond entre littérature (poésie, rhétorique, fiction...), histoire et vie politique. Le mieux connu en France est Luciano Canfora, qui fut d'abord un être de papier car je ne l'ai pas eu comme professeur à l'université ; il a changé à jamais ma vision de l'Antiquité et de sa réception, pour ne rien dire de son acuité dans l'analyse du monde contemporain, et j’ai l’immense chance de le connaître personnellement. Je souhaite également nommer le poète Gianni D'Elia, traduit en français, que j'ai connu en 1989 est qui est désormais un grand ami. L'écouter quand il me lit ses nouvelles créations, ses procédés poétiques, le lien de ses merveilleux vers avec sa vie quotidienne et sa perception des événements du monde est pour moi une nourriture irremplaçable et un privilège inouï.
L.V.D.C. : Quel est le premier texte antique auquel vous avez été confronté ? Quelle a été votre réaction ?
L.-A. S. : À la maison, et bien avant d’étudier le grec, c’est un recueil de poèmes de Sappho, qui m’ont immédiatement enchanté ; à l’école, je crois que ce sont des poèmes de Catulle, auteur que l'on ne peut qu'aimer, comme sa devancière grecque, en raison de sa beauté et de ses accents sincères.
L.V.D.C. : Vous avez fait une partie de vos études en Italie et une autre en France : quels sont les différences entres les deux systèmes d'enseignement ?
L.-A. S. : Les différences sont énormes actuellement, elles l'étaient moins il y a une cinquantaine d'années, avant que l'école française ne soit submergée par une odieuse vague de réformes démagogiques – donc contraires à la démocratie et aux intérêts du peuple français – que des associations tentent en vain de combattre. Une excellente introduction au système scolaire italien a été fournie par Jean-Louis Poirier dans son ouvrage Enseigner la philosophie. L'exemple italien (Ed. Conférence, 2011), qui va bien au-delà de la seule philosophie, apprise en Italie de manière historique, contrairement à l'enseignement philosophique français. En général, on peut affirmer que, jusqu'à récemment, les notions, les connaissances, les faits importants demeurent au centre de l'apprentissage, et non les méthodes. Au contraire, dès le collège les jeunes Italiens sont invités à explorer, à découvrir, à rechercher par eux-mêmes les méthodes, à partir d'une masse abondante de connaissances, présentées par l'enseignant et lues dans les manuels (qui sont en général excellents). Il y a un programme national issu de la loi, certes, mais l'élève n'y est pas soumis en premier, car le but de l'école est d'acquérir une bonne culture générale, sans limite, et non d'étudier quelques oeuvres au programme. Bref, ceux qui ont la chance d'aller au lycée (seul le collège est formellement obligatoire) sont déjà des jeunes chercheurs en herbe et, à l'université, ils progressent encore davantage. J'aimerais beaucoup que la France s'inspire de quelques aspects de l'exemple italien – ce que recommande d'ailleurs Jean-Louis Poirier, doyen de l'inspection générale de philosophie – et revienne à un enseignement substantiel, où le latin, langue et littérature, aurait le rôle pivot qui lui revient.
L.V.D.C. : Vous venez de publier, avec Romain Menini, L’Antiquité selon Guillaume Budé aux éditions Les Belles Lettres : comment est né ce projet ? Et comment s’inscrit-il dans vos recherches ? Pourquoi un livre à quatre mains ?
L.-A. S. : Ce projet est né il y a fort longtemps (2011 ? 2012 ?) de l'envie d'écrire une monographie sur Budé en tant que grand connaisseur de l'Antiquité. Je l'ai soumis aux Belles Lettres début 2017, promettant le manuscrit pour décembre... hélas, je n'arrivais pas à trouver le juste ton pour m'adresser à un public que je ne connaissais pas, étant trop habitué à celui, très restreint, des spécialistes du XVIᵉ siècle ! J'ai alors songé à mon cher ami Romain Menini, qui a coorganisé avec Christine Bénévent et moi-même le colloque de mai 2018 sur l'oeuvre de Budé. Non seulement j'admire le brio de la prose de Romain, mais il est lui aussi très intéressé par l'humanisme de Budé et il le connaît fort bien, car Rabelais – auteur cher à Romain – en dépend largement. C'est ainsi qu'au fin de quelques années nous avons conçu et écrit ensemble les chapitres de ce volume. Romain Menini est donc essentiel pour l'existence de notre livre. L'enjeu de notre affaire était double : d'une part, montrer aux antiquisants et au public des Belles Lettres toute l'étendue des lectures antiques réalisées par un génie comme Budé ; d'autre part, sortir de la vision des humanistes comme simples « transmetteurs » des auteurs anciens. Des intellectuels comme Budé ont pratiqué une philologie encyclopédique, englobante, substantielle (Homère, Virgile, Cicéron et Platon, mais aussi Vitruve, Athénée, Galien, Grégoire de Nazianze... sans oublier le Digeste et la Bible), et ils l'ont fait en songeant à l'avenir de la France – rappelons que Budé a oeuvré à la création de chaires de « lecteurs du roi », embryon de l'actuel Collège de France.
L.V.D.C. : S’agit-il d’une biographie ?
L.-A. S. : Non, plutôt d'une présentation de la richesse de l'oeuvre de Budé et de l'utilité qu'elle peut avoir aujourd'hui.
L.V.D.C. : À qui s’adresse ce livre et faut-il être soi-même, à l’instar du sous-titre, un humaniste érudit, pour l’apprécier ?
L.-A. S. : Ce livre s'adresse à tout public curieux, cultivé. Il entend montrer ce qu'était concrètement un humaniste érudit de la trempe de Guillaume Budé, mais il n'est pas interdit de rêver qu'il fasse des émules !
L.V.D.C. : Si certains connaissent son nom, rares sont ceux qui connaissent la vie de Guillaume Budé et encore moins ses œuvres : pourquoi donc, à votre avis ? Est-ce le propre des traducteurs que de tomber dans l’oubli ? Ou du moins de s’effacer ?
L.-A. S. : Comme l'a dit l'un de mes maîtres, Budé a eu « le mauvais goût » d'écrire en latin ! Seuls deux de ses écrits, somme toute mineurs comparés à l'ensemble, furent rédigés en français. Budé écrivait aussi en grec. Dans les deux langues anciennes, il pratiquait une prose ardue, truffée de mots et de tours rares. Même Érasme se plaignait de la difficulté de lire les livres de Budé... Bref, il faut des éditions modernes, traduites et annotées, et cela manque encore beaucoup aujourd'hui, à la différence de contemporains de Budé comme Érasme ou Thomas More, qui disposent depuis des décennies d'une armée de savants aguerris qui ont édité et traduit pratiquement tout. Pour Budé, on est bien moins nombreux... et il n'est pas le seul grand esprit français dans cette triste condition. Pour résumer, je dirais qu'il faudrait valoriser le XVIᵉ siècle français comme un « siècle des Lumières », mais s'exprimant surtout en latin. Il y a beaucoup de monde derrière Rabelais, Montaigne et la Pléiade ! Il faudrait que les étudiants de Lettres classiques s'intéressent davantage à la Renaissance française, que leurs professeurs leur en parlent – certains collègues le font et je leur suis très reconnaissant.
L.V.D.C. : Retournons la question : pourquoi le découvrir aujourd’hui?
L.-A. S. : Parce que Budé nous montre avec maestria beaucoup de facettes de l'Antiquité actuellement marginales dans les études de Lettres classiques, mais aussi de philosophie et d'histoire. Il en résulte une vision beaucoup plus riche et large, réhabilitant les périodes et les aires négligées, comme l'Antiquité tardive, la philosophie en latin ou la Méditerranée orientale et chrétienne, ces derniers domaines étant trop souvent l'apanage de traditions universitaires certes de très haut niveau, mais inévitablement impliquées au plan religieux. Budé était bon catholique, mais n'hésitait pas à mettre les pieds dans le plat, pour ainsi dire, au nom de la vérité historique et philologique... et de la joie de la découvrir.
L.V.D.C. : Qu’est-ce que « la fabuleuse histoire du million de sesterces » ?
C'est l'un des points saillants de sa monographie sur L'As romain et ses fractions (De Asse et partibus ejus). Budé est, semble-t-il, le premier à avoir démontré comment les Latins indiquaient le chiffre d'un million de sesterces, à savoir decies sestertium, sous-entendant « cent mille », donc ils disaient « dix foix (cent mille) sesterces ». Cela lui permit de révéler tout un pan de l'économie antique, car les sources emploient très souvent cette mystérieuse expression, s'agissant de sommes importantes – folies de riches, budget de l'armée romaine et semblables.
L.V.D.C. : Qu’est-ce qui vous fascine chez Guillaume Budé ?
L.-A. S. : Sa capacité à apprendre et à lire les textes les plus disparates pour mieux connaître l'Antiquité classique et chrétienne (mais aussi judaïque, égyptienne, perse...).
L.V.D.C. : Pour finir, une question pour le traducteur que vous êtes, en hommage également à votre langue maternelle : l’adage traduttore, traditore vous semble-t-il exact ?
L.-A. S. : Oui ! Seul l'accès à la langue originale nous met vraiment en contact avec la richesse de l'esprit d'un auteur. Lire Homère ou Sappho en grec, c'est une tout autre chose ! Cependant, la traduction, avec texte en regard, permet d'ouvrir une fenêtre sur le monde, donc c'est un moindre mal. Et j'aime traduire en langue française ; c'est une langue qui a une souplesse, une clarté et une élégance inégalables.
Dans la même chronique

Entretien claudien avec Bertrand Roussel
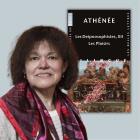
Entretien symposiaque avec Anne-Marie Ozanam
Dernières chroniques

Albums – Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino