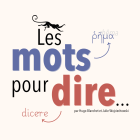Si les sociétés antiques constituent bien cet « espace alternatif » provoquant un dépaysement absolu, il arrive parfois au lecteur curieux de tomber sur un texte qui semble faire écho aux préoccupations les plus actuelles. Ce sont ces textes et les perspectives qu’ils ouvrent sur notre époque que cette chronique entend explorer : avec cette conviction que l’intérêt présenté par l’Antiquité ne saurait se réduire ni à « un roman des origines » ni à un humanisme intemporel qui resterait insensible aux mutations des sociétés.
L’élection de Donald Trump a eu une conséquence inattendue : le brusque intérêt de la presse française pour un mouvement féministe sud-coréen, baptisé 4B, et qui existait déjà depuis une douzaine d’années. Cette soudaine curiosité médiatique est due au fait que, suite au retour du plus célèbre des misogynes, quelques activistes états-uniennes ont jugé opportun d’emboîter le pas de leurs sœurs coréennes – et si la Corée est bien éloignée de nous, on sait la fascination exercée sur les journalistes par tout ce qui se passe outre-Atlantique... Les quatre principaux engagements des adeptes de ce mouvement radical (engagements correspondant aux quatre B coréens) peuvent se résumer dans le refus de toute relation avec les hommes (amicale, conjugale ou sexuelle) et dans le renoncement à la maternité. Ce programme extrémiste traduit la résistance de certaines femmes aux pressions d’une société qui continue de les assigner à un rôle d’épouse et de mère où elles ne trouvent plus matière à s’épanouir : le fait est que le taux de natalité de la Corée du Sud est le plus bas du monde.
Ces injonctions sociales traditionnelles ne sont pas sans rappeler la condition féminine au temps de Périclès. Dans l’Athènes antique, les femmes restent en effet vouées aux tâches domestiques, plus ou moins cantonnées dans ce fameux gynécée où elles règnent sur leur maisonnée. Xénophon, dans son Économique, présente ainsi la répartition de l’espace et des tâches entre les deux sexes : « La divinité a directement adapté, selon moi (c’est Ischomaque qui parle), la nature de la femme aux soins et aux travaux de l’intérieur, et celle de l’homme à ceux du dehors[1] ». C’est ainsi que privées de tout droit civique, les Athéniennes n’apparaissent en public que pour quelques fêtes religieuses, et les jeunes filles n’ont guère leur mot à dire sur le choix de leur futur mari[2]. Le mariage est conçu essentiellement comme une transaction où le montant de la dot et l’intérêt familial l’emportent largement sur les inclinations des futurs époux, dans un contexte social qui oriente plutôt vers les garçons la sexualité masculine. Aux femmes, on demande essentiellement d’assurer une descendance, et de respecter la vertu qui leur est dévolue : la sôphrosunè, c’est-à-dire la retenue. Ainsi à la fin de l’oraison funèbre où il célèbre la grandeur de la cité athénienne, Périclès, évoquant « les vertus féminines », promet la gloire aux veuves dont les mérites ou les torts feront le moins parler d’elles parmi les hommes[3]. Programme couronné de succès : demandez à une personne cultivée de citer le nom d’une Athénienne de l’Antiquité, on aura bien de la peine à vous répondre. (Les plus érudits finiront par énoncer – et l’on ne peut guère en exiger davantage – les deux noms de Xanthippe, l’épouse de Socrate, connue pour son caractère acariâtre[4], et Aspasie, la compagne étrangère de Périclès, réputée plutôt brillante et cultivée). Tout semble ainsi concourir, dans la cité, à invisibiliser le genre féminin, qui n’a laissé de fait aucun écrit ni fondé, à plus forte raison, de mouvement 4B…[5]
Est-ce à dire que le « deuxième sexe » est totalement banni de l’horizon culturel athénien ? Eh bien non ! Par un contraste saisissant en effet, si l’on se tourne vers le théâtre, l’on voit surgir nombre d’héroïnes remarquables, dont les noms cette fois-ci viennent immédiatement à l’esprit : Antigone, Électre, Médée, Lysistrata, Andromaque, Alceste etc. – autant de femmes « puissantes » (au sens où l’entend Marie NDiaye) capables de tenir tête aux hommes et dignes de provoquer la réaction rageuse de Créon, représentant de ce qu’on appelle aujourd’hui le patriarcat, face aux arguments d’Antigone : « moi vivant, ce n’est pas une femme qui commandera[6].» De même les chœurs tragiques mettent en jeu, dans leur grande majorité, des personnages féminins. En fait, tout se passe comme si le répertoire dramatique, écrit et joué par des hommes, visait à rendre justice à la parole des femmes étouffée dans le reste de la cité. Voici par exemple comment Euripide, par la bouche de Médée, dénonce, à travers la condition matrimoniale, le sort qui leur est réservé :
De tout ce qui a la vie et la pensée, nous les femmes sommes la créature la plus malheureuse. D'abord il nous faut, par un excès de dépenses, acheter un époux et donner un maître à notre corps : ce mal-ci est encore plus douloureux que l’autre. Et avec cela, cette question : est-il mauvais, est-il bon? Car quitter leur époux ruine la réputation des femmes, et elles ne peuvent pas le répudier. Pour celle qui arrive dans des habitudes et des lois nouvelles, il faut être un devin, quand on ne l’a pas appris dans sa famille, pour en user au mieux avec l'homme dont on partage la couche. Si nous réussissons dans cette tâche et que notre époux vive avec nous sans porter de force le joug, notre vie est enviable ; sinon, il nous faut mourir[7]. (...)
On peut certes tenter de relativiser la force de ces propos en les replaçant dans leur contexte tragique : Médée vient d’être abandonnée par Jason, devenu pour elle le pire des hommes, et commence sans doute à ourdir ses desseins meurtriers. Mais ce passage fonctionne aussi selon la logique théâtrale de la tirade : c’est-à-dire qu’il acquiert une sorte d’autonomie par laquelle, indépendamment de l’intrigue, l’acteur semble directement parler au spectateur en faisant éclater le cadre spatial et temporel de la fiction. Et manifestement ici ce n’est plus la magicienne de Colchide qui s’adresse au chœur des Corinthiennes, mais une Athénienne qui dénonce, devant un public qui sait parfaitement à quoi elle fait référence[8], la condition faite aux femmes de sa cité. La dénonciation de l’inexpérience des jeunes épouses – dans tous les domaines – préfigure ainsi la réponse que fait Ischomaque à Socrate : « Eh ! Socrate, comment aurais-je pu la recevoir instruite, elle qui n’avait pas encore quinze ans quand elle vint chez moi, et qu’on avait fait vivre précédemment en prenant grand soin qu’elle en vît le moins possible, en entendît le moins possible et posât le moins de questions possible ?[9] »Mais là où Xénophon semble présenter comme un modèle « l’éducation » féminine fort conservatrice proposée par son personnage, Euripide, lui, épouse le point de vue de la femme. La violence des termes, qui vont jusqu’à assimiler le mariage à la mort, n’en est que plus remarquable. Et si le texte concède, malgré tout, qu’on peut même rencontrer des ménages heureux, il n’est absolument pas question ici de maternité ni, a fortiori, de l’épanouissement ou de la consolation qu’elle est censée procurer. (Certes c’est Médée, future infanticide, qui parle, mais tout au long de la pièce elle assure aimer sa progéniture…) On devra se contenter, pour clore la tirade, de cette considération que ne renieraient point les militantes 4B : je préférerais lutter trois fois sous un bouclier que d’enfanter une seule !
Soyons francs : ce qui retient le plus l’attention dans les engagements du mouvement coréen, ce n’est pas tant le refus de la maternité que celui des relations hétérosexuelles : et l’on songe tout de suite à Lysistrata – au point que, si l’on en croit France-Info du 18 novembre dernier, certaines militantes américaines auraient songé à rebaptiser du nom de l’héroïne d’Aristophane le mouvement coréen. Or, si ces deux révoltes féminines ont en commun de prôner l’abstinence sexuelle, il serait hasardeux de pousser plus loin l’analogie, pour plusieurs raisons. D’abord les activistes 4B renoncent aux codes physiques et vestimentaires de la féminité traditionnelle, alors que les Athéniennes regroupées autour de Lysistrata font exactement le contraire, et cherchent à aguicher leurs hommes par les tenues les plus érotiques possibles. Elles-mêmes, du reste, sont loin d’être insensibles aux appels de la chair, et leur meneuse doit mettre en œuvre toute son énergie pour les empêcher de retourner vers leurs maris, qui eux aussi n’en peuvent plus[10] : si bien que la pièce, dans ses aspects les plus grotesques et les plus provocateurs, peut aussi se voir comme une joyeuse célébration du désir sexuel, dans la droite ligne des processions du kômos à l’origine du genre comique. Mais surtout, la grève du sexe des Athéniennes n’est qu’un moyen temporaire imaginé par Lysistrata pour pousser les hommes à conclure la paix : elle n’a rien à voir avec le vœu perpétuel de chasteté qui semble être le choix des militantes 4B. Comme l’a montré Nicole Loraux, il ne s’agit pas d’écarter la déesse de l’Amour mais de jouer sur sa complémentarité avec la protectrice de l’Acropole : « user d’Athéna au service d’Aphrodite, d’Aphrodite au service d’Athéna », pour une finalité qui est à l’exact opposé de celle du mouvement coréen : « car ce que les femmes cherchent au moyen de la sécession, c’est bien à rétablir la conjonction normale des sexes, en d’autres termes le fonctionnement de cette institution civique menacée : le mariage[11]. » … Ce qui se produira à la fin du spectacle, consacrant la vraie problématique de la pièce, une vingtaine d’années avant L’Assemblée des femmes : le droit d’ingérence de l’autre sexe dans les affaires de la cité.
Si l’on cherche un refus féministe de la sexualité dans le théâtre grec, il faut se tourner plutôt vers une autre œuvre, encore plus ancienne : Les Suppliantes d’Eschyle. Rappelons-en l’argument : les cinquante Danaïdes fuient Égypte sous la conduite de leur père pour échapper au mariage avec leurs cousins. Accueillies à Argos par le roi Pélasgos, elles lui demandent asile – c’est le thème central de la pièce – et obtiendront finalement gain de cause. Or que fuient les Danaïdes ? Si au début de la pièce on peut avoir l’impression qu’elles cherchent à échapper au caractère incestueux de l’union qui leur est proposée, les termes employés s’élargissent très vite à la « race » masculine, systématiquement associée à la notion d’ubris (l’orgueil démesuré et la violence qu’il entraîne)[12]. Leur fuite prend ainsi la dimension d’une révolte contre toute soumission sexuelle : « Que la longue semence d’une auguste mère échappe aux lits des hommes, sans mariage et sans domination! » Dès leurs premiers discours, elles invoquent par ces mots Artémis, déesse protectrice des femmes : outre le double paradoxe d’associer le mot semence (sperma) au mot mère et d’attribuer ce dernier à une déesse vierge, les alphas privatifs des termes grecs (agamon, non mariée, adamaton : indomptable) disent assez leur obsession de la virginité, réaffirmée tout au long de l’œuvre : « puissé-je ne jamais être soumise au pouvoir des mâles[13] » reprend ainsi le chœur plus loin dans ses plaintes. Cette horreur de la sexualité connaîtra un dénouement tragique, puisque les Danaïdes finiront par assassiner leurs maris, ce qui constituait très probablement l’objet d’une pièce aujourd’hui perdue venant parachever la trilogie inaugurée par Les Suppliantes.
*
Même s’il ne faut pas sous-estimer la part imaginaire de tous ces discours prêtés aux femmes par des hommes[14] (mais Flaubert n’est-t-il pas parvenu à entrer dans le psychisme féminin en évoquant l’expérience matrimoniale de Madame Bovary ?), on ne peut que reconnaître l’homologie de leurs contenus avec les revendications du mouvement 4B et, au-delà, avec nombre de thèmes féministes actuels : la dénonciation du pouvoir accaparé par les hommes, l’aliénation qu’entraîne la condition de femme mariée avec les charges qu’elle induit, la revendication de la maîtrise du corps féminin, dégagé de sa soumission au bon vouloir des mâles. Une dernière remarque : le mouvement 4B se développe dans des pays qui, sans doute loin d’être parfaits, laissent néanmoins la liberté de mouvement et d’expression. Mais il en est d’autres où l’oppression des femmes est encore bien pire : en Afghanistan par exemple, elles sont privées d’éducation, ne peuvent plus travailler à l’extérieur, ni sortir (évidemment voilées) sans être accompagnées de l’homme qui leur sert de chaperon ; on leur interdit depuis peu de s’adresser la parole lors des lectures du Coran et, fin décembre, une ultime loi vient d’ordonner de murer les fenêtres de tous les lieux d’où l’on pourrait les apercevoir. Comment dire l’horreur du sort qui leur est réservé, et l’étendue de leur misère ? Nous viennent à l’esprit, traversant l’épaisseur des siècles, les mots terribles de Médée : de tout ce qui a la vie et la pensée, nous les femmes sommes la créature la plus malheureuse...
J.-P. P.
[1] Xénophon, Économique VII, 22. À noter qu’à la même époque Platon exprime, quand il conçoit sa cité idéale, un point de vue totalement opposé : « Les aptitudes naturelles sont également réparties entre les deux sexes, et il est conforme à la nature que la femme, aussi bien que l’homme, participe à tous les emplois, encore qu’en tous elle soit plus faible que l’homme. » République. V, 455d.
[2] Hérodote mentionne ainsi un certain Callias qui se rendit célèbre [ἐφανερώθη] chez les Grecs non seulement par ses victoires olympiques et ses dépenses somptuaires, mais aussi en laissant choisir à ses trois filles, richement dotées, leur futur époux ! (Hérodote, Enquête, VI, 122, cité par Robert Flacelière dans La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès, Hachette, 1959)
[3] Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, II, 45, traduction Jacqueline de Romilly, Les Belles Lettres, 1967 (il faut entendre par « les hommes » [ἄρσεσι] le sexe masculin).
[4] cf. La Vie des Classiques, Chroniques anachroniques, Scène de ménage chez les Socrate, 16 mars 2020.
[5] Sur ce thème, voir plus précisément Nicole Loraux, Le nom athénien, in Les enfants d’Athéna, (Maspero, 1981) :« Ainsi, toutes les instances imaginaires de la cité s’accordent à réduire tendanciellement la place faite à la femme dans la polis : la langue lui refuse un nom, les institutions la cantonnent dans la maternité, les représentations officielles lui retireraient volontiers jusqu’au titre de mère ».
[6] Sophocle, Antigone, vers 525.
[7] Euripide, Médée, vers 230-243
[8] La plupart des spécialistes s’accordent à penser aujourd’hui que des femmes assistaient aux représentations théâtrales, rattachées aux fêtes religieuses des Lénéennes et surtout des Grandes Dionysies.
[9] Xénophon, Économique VII, 5.
[10] Pour les tenues aguichantes : v. 43-54 et 149-152 ; pour l’appétit sexuel des femmes: v. 120-143 et 716-763.
[11] Nicole Loraux, « L’Acropole comique », in Les enfants d’Athéna, op. cit.
[12] Sur ce sujet voir l’article d’Edmond Lévy : « Inceste, mariage et sexualité dans Les Suppliantes » consultable sur le portail Persée. Pour les références à l’ubris : Cf. v. 31, 80, 103, 426, 487 (dans la bouche du roi), 528, 880-881.
[13] Les Suppliantes, vers 151-153 et 392-393.
[14] Voir sur cette question l’introduction de Jean Alaux aux Suppliantes (Les Belles Lettres, coll. Classiques en poche) ainsi que sur La vie des Classiques, les deux chroniques Anthrogyne et androcène consacrées à L’Assemblée des femmes et à Lysistrata.
Dans la même chronique

Grand écart – Des fruits, des feuilles, et du temps qui passe

Grand écart – Pindare et les J.O.
Dernières chroniques

Albums – Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino