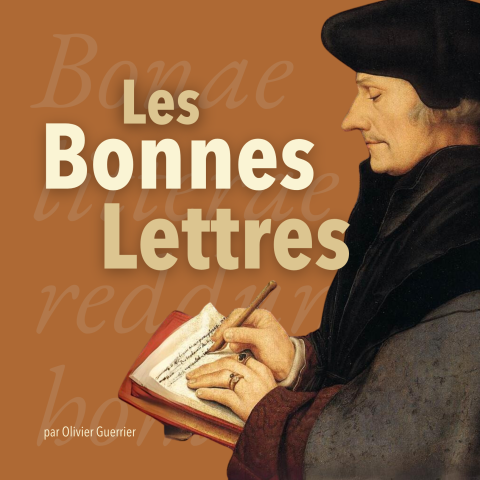
« Bonae litterae reddunt homines » (« Les bonnes lettres rendent les hommes humains ») écrit Érasme dans la Querela pacis (La Complainte de la paix) de 1517. Ces « bonnes lettres », parfois alors appelées « lettres humaines » et distinguées des « lettres saintes », expriment un idéal encyclopédique, moral et « anthropologique » voire politique spécifique, avant celui des « Belles-Lettres » qui triomphera à l’Âge classique, bien avant celui des « droits de l’homme » ou de l’« humanitaire » d’aujourd’hui. Celui-ci se fonde sur la triade, cardinale dans l’humanisme historique, du studium (étude), de la charitas (charité et compassion) et de l’unitas hominum (unité et concorde du genre humain).
Cette chronique d'Olivier Guerrier entend mettre en relief certains des contenus, des messages et des auteurs principaux de l'humanisme, comme leurs prolongements dans la culture ultérieure.
Proche de la Déclamation, mais ajoutant à celle-ci une dimension explicitement encomiastique, l’éloge paradoxal chemine parallèlement à elle dans l’Antiquité, et connaît un regain d’intérêt semblable au sien à la Renaissance. Genre écrit dans le but de louer un objet trivial, une personne ou un défaut, à des fins comiques ou satiriques, il fleurit particulièrement au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec pour exemple prestigieux l’Éloge d’Hélène de Gorgias, qui établit l’innocence du personnage et cherche à convaincre l’auditoire de cesser de la blâmer pour la Guerre de Troie. Plusieurs des principales pièces antiques sont mentionnées dans la lettre à Thomas More qui ouvre l’Éloge de la folie d’Érasme (Μωρίας ἐγκώμιον ou Stultitiæ laus, Paris, 1511) :
Polycrate a composé l’éloge de Busiris et Isocrate l’a réfuté ; Glaucon a célébré l’injustice ; Favorinus, Thersite et la fièvre quarte ; Synésius, la calvitie ; Lucien, la mouche et le pique-assiette.
On voit que, du texte de Polycrate de Samos (538 à 522 av. J.-C.) à celui de Lucien de Samosate (v. 120 – v. 180), c’est un corpus qui relève d’une « sophistique de la séduction », selon l’expression de Patrick Dandrey[1], qui est passé en revue, et où sont pris pour objets des personnages, valeurs, attitudes, aspects physiques ou encore des animaux, tous habituellement tournés en dérision ou blâmés.
La Renaissance se plaît ainsi au serio ludere, mélange de gravité et de jeu, qui marque les œuvres propres à la « seconde sophistique » qu’elle redécouvre. Mais, en plus de s’inscrire désormais sous un support imprimé et édité, sa littérature accuse ou modifie les traits de l’éloge paradoxal à la mode antique. Chez Érasme, ainsi, le dispositif énonciatif, selon lequel « la parole est à la folie », brouille les contours d’un message dû à Moria et non l’auteur lui-même, ce qui rend incertaine la « sagesse » qu’il contient. L’ouvrage, illustré par des gravures sur bois par Hans Holbein l'Aîné, reparaît à Bâle en 1514, et remporte un grand succès dans toute l’Europe. Exercice d’éloquence pour les rhéteurs, de style pour les poètes, l’éloge paradoxal gagne aussi d’autres genres plus ou moins accrédités, ou en constitution à l’époque. C’est ainsi que, sans qu’il y soit explicitement désigné comme tel, on le retrouve dans les chapitres 3, 4 et 5 du Tiers Livre de Rabelais (1546), où il accompagne l’entrée en scène de Panurge, insistant entre autres sur la provocante dilapidation et expansion qui caractérisent le protagoniste, anticipant peut-être même sur certaines théories économiques[2]. Ailleurs, dans le chapitre « De l’expérience » des Essais de Montaigne (III. 13), le « je » donne la parole à son « esprit », lequel s’adresse à son « imagination », pour la soulager de « toute peine et contestation », mais non sans avoir indiqué d’emblée du premier : « S'il persuadait comme il prêche, il me secourrait heureusement ». Consolation et « exercice » mental donc apparemment un peu désespérés, qui se résolvent en un « éloge de la gravelle ». Comme chez Érasme, la complexité du dispositif de parole empêche de stabiliser le sens et l’enjeu d’un tel passage.
On se doute que l’éloge paradoxal est loin de disparaître après la Renaissance. À l’époque suivante, certains des plus célèbres exemples s’en trouvent cette fois au Théâtre, dans le Dom Juan de Molière, qui s’ouvre sur une louange du tabac par le valet Sganarelle (Acte I Scène 1), avant que le maître n’apparaisse pour célébrer l’inconstance amoureuse (Acte I Scène 2), puis dans le dernier acte l’hypocrisie (Acte V Scène 2). On voit combien il n’est plus question de badinerie dans l’attaque que mène par ce biais Molière contre l’austérité et la tartufferie religieuses. Si l’on croirait aisément à un épuisement ensuite d’un genre appartenant à ce que R. Barthes qualifie d’« ancienne rhétorique », on a pu montrer[3] qu’on le retrouvait encore ponctuellement dans certaines œuvres contemporaines comme Fragments de Lichtenberg de Pierre Senges, et son apologie du bossu, ou dans L’Auteur et Moi d’Éric Chevillard, avec sa vitupération du chou-fleur et son éloge de la fourmi.
[1] L'éloge paradoxal de Gorgias à Molière, Paris, PUF, 1997, Introduction.
[2] Voir Terence Cave, Pré-histoires II – Langues étrangères et troubles économiques au XVIe siècle, Genève, Droz, 2001, p. 149 sq.
[3] Voir Christelle Reggiani, « L’éloge paradoxal dans la littérature française contemporaine », Recherches & travaux 99 | 2021, https://journals.openedition.org/recherchestravaux/4245.
Dans la même chronique
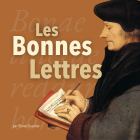
Les Bonnes Lettres – L'humanisme sans frontières : Janus Lascaris
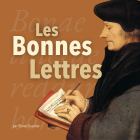
Les Bonnes Lettres – Les genres de l'humanisme : La Déclamation
Dernières chroniques

Albums – Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino
