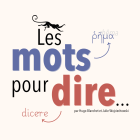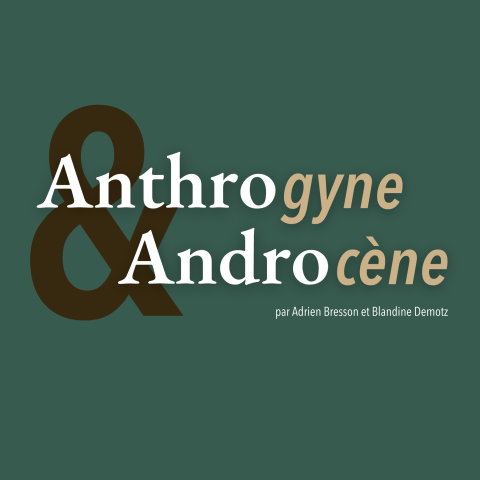
Le grec ancien a deux mots, bien distincts, pour distinguer l'être humain (anthropos) et l'homme, conçu comme être masculin (andros). La femme (gunè) est donc un anthropos au même titre que l'andros. Pour autant, les civilisations anciennes, dans leurs mythes notamment, ne manquent pas de mettre en scène des entités détachées de tout genre, ou au contraire aux genres pluriels, parfois androgynes, ou au-delà. Sont-elles alors à percevoir comme anthrogynes, dépassant le stade de la masculinité et faisant route vers l'humain, au sein même de sociétés androcènes, et donc patriarcales ? En étudiant les rapports de genre parmi les textes et les représentations anciennes, de l'Antiquité à sa réception contemporaine, Adrien Bresson et Blandine Demotz invitent à repenser les représentations stéréotypées du masculin, du féminin et du neutre.
Comme nous l’expliquions dans les précédentes chroniques, qui tâchaient de mettre en lumière l’aspect genré du mythe de la gigantomachie, il est difficile d’inscrire une telle lecture dans le temps long précisément parce que les sources dont nous disposons quant à la narration du mythe de la gigantomachie sont assez fragmentaires. En réalité, ce mythe est particulièrement ancien et il est abordé de longue date dans l’Antiquité depuis la Théogonie du poète grec Hésiode au VIIIe siècle avant notre ère. Toutefois, ce qui est particulièrement marquant au sujet de ce mythe, c’est qu’avant que le Pseudo-Apollodore, compilateur grec de mythes du Ier ou du IIe siècle de notre ère, n’en formalise le récit dans sa Bibliothèque, et que Claudien, poète latin du IVe siècle de notre ère, ne consacre un poème entier au mythe, il n’était que brièvement mentionné, en quelques lignes éclatées et fragmentaires : aucune trace de texte relatant l’historique complet du mythe, avant ces écrits, ne nous est parvenue. Ainsi, un ou deux vers pouvaient se référer au mythe dans un poème lyrique ou dans une tragédie, sans que les auteurs s’attardent sur le récit du mythe dans sa totalité. Il semble donc difficile, même si nous essaierons de le faire, d’identifier une dimension univoque au discours genré tel qu’il peut être observé chez plusieurs auteurs. C’est d’ailleurs pourquoi le personnage de Minerve/Athéna est pour le moment laissé de côté, dans le cadre de notre analyse, car tous les auteurs ne la font pas figurer dans la narration qu’ils proposent du mythe. Malgré tout, la dimension genrée du discours sur le mythe que nous avons pu conduire dans la précédente chronique, notamment au sujet de Terra, ne manque pas de se poursuivre chez le Pseudo-Apollodore puisque la seule force de défense dont est capable la Terre dans ce récit mythique est liée à sa qualité de femme et consiste en l’enfantement, comme on peut le constater au début de la narration :
Γῆ δὲ περὶ Τιτάνων ἀγανακτοῦσα γεννᾷ Γίγαντας ἐξ Οὐρανοῦ.
La Terre, irritée du malheur des Titans, eut d'Uranus les Géants.
Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, I, 6, 1,
éd. et trad. Paul Schubert, Paris, L’Aire, 1991.
Il apparaît que le seul mode de défense dont puisse être capable la Terre est sa capacité à enfanter des êtres à même d’œuvrer pour sa cause, ce qui illustre en sous-texte, si l’on observe précisément la dimension genrée que peut prendre le mythe, le fait que le féminin n’est pas considéré comme étant à même de se défendre directement, même si la génération mise en place par la Terre est clairement une arme. Il est présenté comme étant à même d’engendrer des moyens de sa défense, mais sans aller au front.
Dans une conception similaire de celle avancée par le Pseudo-Apollodore, il apparaît que le rôle de génération associé au féminin soit constitutif de la manière dont est envisagé le mythe de la gigantomachie jusqu’au Moyen Âge, notamment dans l’Ecloga Theoduli, sorte de dialogue composé par Théodule au sujet duquel nous n’avons que très peu d’informations. Le mythe de la gigantomachie est ainsi mentionné aux v. 85-86 :
Surrexere uiri, terras genitrice creati,
pellere caelicolas fuit omnibus una uoluntas.
Les hommes, créés par la terre génitrice, surgirent ; tous voulurent unanimement renverser les habitants du ciel.
Théodule, Ecloga e Codicibus Parisinis et Marbugensi uno,
New-York, Beck, 2015 (trad. personnelle).
Remarquons que, dans cette version du mythe, les Géants sont devenus des hommes (uiri) : ils semblent considérés comme étant les seuls à même de mener la lutte qui est attendue d’eux. En outre, comme on le retrouve avec la manière dont elle est nommée (genitrice), il est frappant qu’encore une fois la Terre soit essentiellement rattachée à sa position de génitrice. Elle est ainsi singularisée comme n’étant pas à même d’assurer en son nom sa propre défense, dépendant d’individus présentés comme des hommes par Théodule. Le fait que Théodule présente, dans son récit gigantomachique, non des Géants mais des hommes doit également nous encourager à nous interroger sur le genre des Géants et les implications qui sont rattachées à une telle perception dans l’approche que les différents auteurs peuvent avoir du mythe, que nous analyserons dans une prochaine chronique.
Adrien Bresson et Blandine Demotz
Dans la même chronique

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (4) : Des Géants genrés

Dernières chroniques

Albums – Helvetius