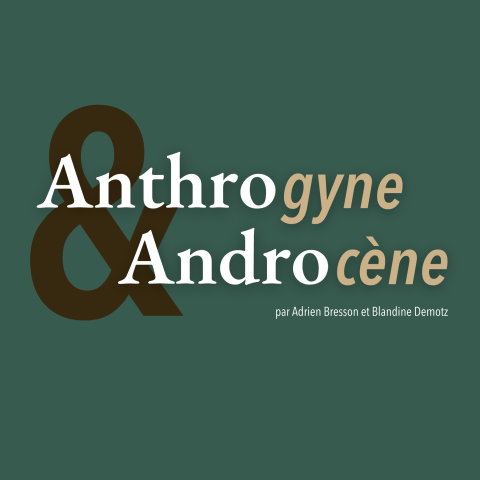
Le grec ancien a deux mots, bien distincts, pour distinguer l'être humain (anthropos) et l'homme, conçu comme être masculin (andros). La femme (gunè) est donc un anthropos au même titre que l'andros. Pour autant, les civilisations anciennes, dans leurs mythes notamment, ne manquent pas de mettre en scène des entités détachées de tout genre, ou au contraire aux genres pluriels, parfois androgynes, ou au-delà. Sont-elles alors à percevoir comme anthrogynes, dépassant le stade de la masculinité et faisant route vers l'humain, au sein même de sociétés androcènes, et donc patriarcales ? En étudiant les rapports de genre parmi les textes et les représentations anciennes, de l'Antiquité à sa réception contemporaine, Adrien Bresson et Blandine Demotz invitent à repenser les représentations stéréotypées du masculin, du féminin et du neutre.
Les Géants sont des protagonistes du mythe de la gigantomachie, auquel ils donnent leur nom. Comme nous l’avons vu dans la précédente chronique, Théodule qui reprend au Moyen Âge le mythe dans ses Ecloga, n’hésite pas à faire des Géants des hommes au sens d’individus masculins. Pourtant, la tradition mythographique de l’Antiquité ne semble pas situer les Géants dans une position genrée de prime abord, alors même que ces personnages ne sont pas véritablement détachés de certains stéréotypes de genre. Il est a priori possible de penser que les Géants ne sont pas présentés comme des hommes chez les auteurs de l’Antiquité : ils ne sont pas qualifiés par des adjectifs signifiant « à la manière d’hommes » ou encore par des compléments du nom signifiant « d’hommes ». Malgré tout, il semble indubitable que le comportement qui leur est associé est caractéristique des stéréotypes de genre masculin. En conséquence, il n’est pas étonnant qu’ils soient devenus des hommes dans les Ecloga Theoduli, mais encore qu’ils soient envoyés au combat, qui est dans l’ensemble, une affaire généralement réservée aux hommes dans l’Antiquité. Observons à cet égard la manière dont les Géants agissent pendant les combats dans la Gigantomachie de Claudien, afin d’interroger la dimension genrée de leur action :
Hic rotat Haemonium praeduris uiribus Oeten,
hic iuga conixus manibus Pangaea coruscat,
hunc armat glacialis Athos, hoc Ossa mouente
tollitur […].
L’un fait tourner, avec vigueur et force, l’Oeta hémonien ; par l’effort de ses mains, l’autre brandit le sommet du Pangée ; l’Athos glacé arme cet autre, un tel ébranle et soulève l’Ossa, […].
Claudien, Gigantomachie, v. 66-69,
éd. et trad. Jean-Louis Charlet,
CUF, Les Belles Lettres, 2018.
Outre le fait que ce sont des pronoms démonstratifs masculins qui sont employés en latin (hic et hunc) pour désigner les Géants, remarquons que les différentes actions de ces derniers sont le produit d’une force brute : les personnages s’emparent d’éléments naturels – en l’occurrences divers monts de Grèce – et les détruisent afin de s’en servir comme armes. Nous rencontrons ici deux stéréotypes de genre tout à fait caractéristiques des sociétés antiques, car la force physique est associée au genre masculin, de la même manière que le combat. En conséquence, même s’ils ne sont pas présentés en tant qu’hommes, les Géants sont associés au genre masculin dans le cadre des actions qu’ils accomplissent et à travers la manière dont ils se comportent. De fait, les créatures mythologiques qu’ils sont ne paraissent nullement situées hors-genre. Si nous songeons à l’iconographie, notamment la céramique[1], ou encore la statuaire[2], les Géants sont figurés sous des traits masculins. Le genre est ainsi un prisme d’analyse également fonctionnel dans le cadre des mythes puisque les Anciens semblent assigner un genre aux créatures qui ont part aux récits diffusés, comme nous pourrons l’observer dans une prochaine chronique avec un autre personnage caractéristique du mythe de la gigantomachie : Typhon.
Adrien Bresson et Blandine Demotz
[1] Voir par exemple « Dionysos combattant le Géant Eurytos durant la Gigantomachie », détail d'un pélikè attique à figures rouges, v. 460 av. J.-C. Provenance : Nola.
[2] Voir la manière dont les Géants sont figurés, tels des hommes, sur le Grand autel de Pergame conservé au Pergamonmuseum à Berlin.
Dans la même chronique

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (3) : Stéréotypes et histoire du mythe

Dernières chroniques

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi
