
Cette semaine, La Vie des Classiques vous propose de (re)découvrir une figure majeure de la littérature antique : Lucien de Samosate, “un des plus beaux esprits de son siècle”. Puisées dans les arcanes du site, voici pour vous quelques belles et bonnes pages...
L’Histoire véritable que nous propose le philosophe Lucien de Samosate, au IIe siècle ap. J.-C., est un texte proprement extravagant, qu’il présente lui-même comme une parodie des récits de voyage – dont le prototype est l’Odyssée. Mais l’écrivain rationaliste tient d’emblée à se démarquer du substrat mythique souvent attaché à ce type de narration, en assumant personnellement le caractère imaginaire des histoires qu’il raconte : « Ne voulant pas être le seul privé de la liberté de raconter des fables, comme je n’avais rien de vrai à rapporter, car il ne m’était rien arrivé de mémorable, j’ai pris le parti du mensonge, mais d’une manière beaucoup plus honnête que les autres ; quand bien même je ne dis vrai que sur un point, à savoir que je mens, je crois ainsi échapper aux reproches d’autrui en reconnaissant moi-même que je ne dis rien de vrai »[1] On peut donc considérer ce récit, dont le titre constitue une antiphrase ironique, comme un des premiers romans. Le début de ces aventures voit le héros arriver dans la lune, à la suite d’une tempête qui emporte son bateau dans les airs. Parmi les curiosités stupéfiantes qu’il a l’occasion de découvrir dans notre satellite – hommes qui naissent de testicules plantés en terre, grenouilles qui volent, yeux amovibles, etc. – l’une peut retenir plus particulièrement l’attention d’un lecteur contemporain :
« J’observai aussi une autre merveille dans le palais royal : un très grand miroir se trouve au-dessus d’un puits peu profond. Si on descend dans le puits, on entend tout ce qui se dit chez nous sur la terre ; si on tourne les yeux vers le miroir, on voit toutes les villes, tous les peuples, comme si on se tenait parmi eux. J’observai alors ma famille et toute ma patrie ; quant à savoir si eux me voyaient, je ne puis le dire de façon sûre. Celui qui ne me croit pas, si un jour lui aussi parvient jusque-là, saura que je dis vrai. »[2]
Pour le lecteur moderne, ce lieu d’où l’on peut entendre et voir n’importe quel point de l’univers évoque irrésistiblement l’Aleph de Borges. Dans la nouvelle de l’écrivain argentin, ce foyer magique n’est pas situé dans la lune, mais sous la salle à manger d’une maison de Buenos Aires. « La cave, guère plus large que l’escalier, ressemblait beaucoup à un puits ». C’est dans ce lieu souterrain que le narrateur va découvrir la petite sphère aux couleurs chatoyantes que son ami lui a présentée comme un des points de l’espace qui contient tous les points. On doit reconnaître que dans le texte de Borges l’évocation des effets de l’Aleph est infiniment plus puissante que celle du miroir de Lucien : elle se développe sur une longue énumération poétique qui se caractérise par son hétérogénéité, l’alternance des vues d’ensemble et des observations de détail, l’émotion transmise aux lecteurs par quelques adjectifs bien choisis, la dimension temporelle subtilement suggérée, et pour finir la mise en abyme vertigineuse d’un spectacle qui s’inclut lui-même dans un dédoublement spéculaire : Je vis de convexes déserts équatoriaux et chacun de leurs grains de sable, je vis à Inverness une femme que je n’oublierai pas, je vis la violente chevelure, le corps altier, (…) je vis un cercle de terre desséchée sur un trottoir, là où auparavant il y avait eu un arbre, (…) je vis l’Aleph sous tous les angles, je vis sur l’Aleph la terre, et sur la terre de nouveau l’Aleph et sur l’Aleph la terre, je vis mon visage et mes viscères (…).[3]
Borges donne lui-même ses sources dans un ultime artifice de son récit, en suggérant que ce qu’il vient de décrire n’est qu’un faux Aleph ; parmi la liste de ceux-ci on trouve sans surprise « le miroir que Lucien de Samosate put examiner sur la lune ». Le véritable Aleph, selon un personnage de la nouvelle, se trouverait dans une colonne de la mosquée de Amr, au Caire. Et le texte ajoute ceci : « Les précédents (outre qu’ils ont le défaut de ne pas exister) sont de simples instruments d’optique. »
On voit s’esquisser ici une distinction fondamentale : d’un côté un simple foyer où convergerait l’univers, mais sans que le spectateur n’outrepasse son rôle de pur témoin. On observe ainsi que le narrateur de l’Histoire véritable, bien qu’il voie et entende ses proches, n’entre pas en conversation avec eux, et ne sait pas s’ils le voient. De l’autre quelque chose de beaucoup plus troublant, et dont l’écriture frémissante de Borges nous donne une idée, lorsqu’il évoque avec tant de bonheur et d’effroi l’Aleph de Buenos Aires : celui d’un point qui nous permettrait de vivre l’univers, en cumulant d’un seul coup toutes les émotions possibles de l’expérience humaine… Car derrière ces fables, ce qui est en jeu ici, c’est un vieux rêve de l’humanité : le pouvoir d’ubiquité. Or ce rêve, la technique moderne semble l’avoir mis à notre portée : avec toutes les inventions commençant par le préfixe grec télé, nous franchissons les distances et, instantanément, avons accès à n’importe quel lieu où nous ne sommes pas. Mieux : avec les nouvelles générations de téléphones portables, nos Alephs technologiques sont devenus individuels et portatifs…
Sommes-nous donc arrivés à ce stade suprême de la connaissance et de l’expérience qui nous rendraient omniprésents et nous donneraient de prendre part à toutes les formes d’existence ? Ce n’est pas si simple. Car ces appareils sophistiqués n’abolissent pas la distance, comme on le dit parfois un peu rapidement : ils la traversent – ce qui n’est pas la même chose – et d’une certaine manière, en nous frustrant d’une présence réelle, l’exacerbent. Commentant les téléphonages donnés à Albertine, Proust fait cette réflexion : « La voix de l’être cher s’adresse à nous. C’est lui, c’est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais comme elle est loin ! Que de fois je n’ai pu l’écouter sans angoisse… » Georges Poulet, qui cite cette phrase, commente : « Ce que fait donc apparaître l’illusoire miracle de la conversation téléphonique (et de son analogue exact, le souvenir) c’est une présence à la fois retrouvée et perdue. »[4] Qu’on ne s’y trompe pas : les logiciels modernes qui permettent de voir l’interlocuteur ne changent rien à ce sentiment d’éloignement comme accentué par les effets sensibles de la voix et de l’image. L’écran qui équipe tous ces appareils porte bien son nom.
Mais cette absence est double. Car, pendant que je converse à distance avec l’amie ou que je regarde un reportage sur un pays lointain, je ne suis plus tout à fait où je suis. Tout usager des transports en commun a assisté bien des fois à ces coups de téléphone par lesquels un passager, comme assigné à son appareil, informe son interlocuteur de sa position, imitant ces bateaux au long cours perdus dans l’immensité des mers : comme s’il cherchait à se rassurer et à se prouver qu’il existe encore, même s’il n’est justement plus, au moment où il parle, qu’une voix suspendue dans l’espace… Car être partout, c’est aussi être nulle part. Les lieux souterrains où Lucien et Borges placent leur trouvaille sont significatifs : si les deux auteurs les situent avec précision, c’est pour mieux suggérer comment, une fois descendu dans ces puits peu profonds, tout repère spatial perd son sens.
Nos techniques modernes de l’ubiquité ne comblent pas notre existence ; elles la vident plutôt, nous empêchant d’agripper l’instant et le lieu où nous nous tenons – plus proches en cela du narrateur un peu blasé de Lucien que de l’expérience ineffable rapportée par Borges. Regardez cet adolescent penché sur son smartphone, et qui fait défiler fébrilement les images, coupé de tout ce qui l’entoure : il est ailleurs. Il n’est nulle part. Il est dans la lune.
J.-P. P.
[1] Lucien, Histoire véritable, Ch.4
[2] Ibidem, Ch.26
[3] Borges, L’Aleph (éd. Gallimard)
[4] Georges Poulet : L’espace proustien (éd. Gallimard)
Dans la même chronique
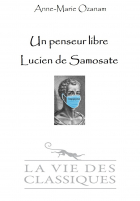
[SACRÉ LUCIEN !] Anne-Marie Ozanam - Un penseur libre, Lucien de Samosate

[SACRÉ LUCIEN !] Chroniques anachroniques — La croisière s’amuse
Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon
