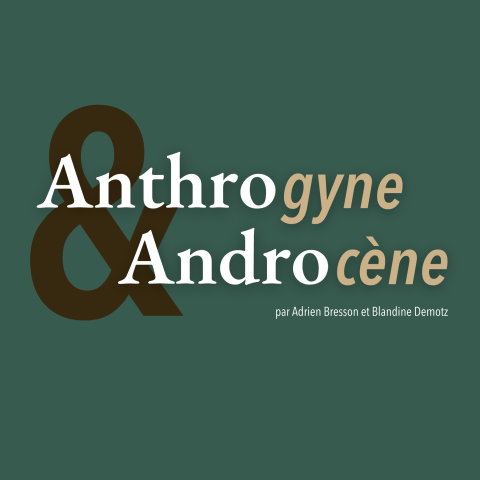
Le grec ancien a deux mots, bien distincts, pour distinguer l'être humain (anthropos) et l'homme, conçu comme être masculin (andros). La femme (gunè) est donc un anthropos au même titre que l'andros. Pour autant, les civilisations anciennes, dans leurs mythes notamment, ne manquent pas de mettre en scène des entités détachées de tout genre, ou au contraire aux genres pluriels, parfois androgynes, ou au-delà. Sont-elles alors à percevoir comme anthrogynes, dépassant le stade de la masculinité et faisant route vers l'humain, au sein même de sociétés androcènes, et donc patriarcales ? En étudiant les rapports de genre parmi les textes et les représentations anciennes, de l'Antiquité à sa réception contemporaine, Adrien Bresson et Blandine Demotz invitent à repenser les représentations stéréotypées du masculin, du féminin et du neutre.
Celui qui est communément présenté comme l’ennemi final de l’épisode gigantomachique est Typhon. Il est la dernière progéniture engendrée par la Terre – ce qui est est, comme nous l’avons vu, son moyen de défense privilégié – et la description qui est faite de lui le rend tout à fait redoutable. Typhon est un monstre – c’est-à-dire un prodige au sens étymologique –, ce qui signifie qu’il n’a théoriquement pas de genre. Il est une créature baroque d’assemblage hétéroclite. Pourtant, à observer la description qu’en donne Hésiode, poète grec du VIIIe siècle avant notre ère, dans sa Théogonie, il ne semble pas qu’il soit tout à fait présenté comme étant une créature hors genre, ou en tout cas non genrée. Ainsi, pour le présenter, Hésiode écrit :
Αὐτὰρ ἐπεὶ Τιτῆνας ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐξέλασεν Ζεύς,
ὁπλότατον τέκε παῖδα Τυφωέα Γαῖα πελώρη
Ταρτάρου ἐν φιλότητι διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην·
οὗ χεῖρες μὲν ἔασιν ἐπ᾽ ἰσχύι, ἔργματ᾽ ἔχουσαι,
καὶ πόδες ἀκάματοι κρατεροῦ θεοῦ· ἐκ δέ οἱ ὤμων
ἣν ἑκατὸν κεφαλαὶ ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος,
γλώσσῃσιν δνοφερῇσι λελιχμότες, ἐκ δέ οἱ ὄσσων
θεσπεσίῃς κεφαλῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσι πῦρ ἀμάρυσσεν·
πασέων δ᾽ ἐκ κεφαλέων πῦρ καίετο δερκομένοιο·
φωναὶ δ᾽ ἐν πάσῃσιν ἔσαν δεινῇς κεφαλῇσι
παντοίην ὄπ᾽ ἰεῖσαι ἀθέσφατον· ἄλλοτε μὲν γὰρ
φθέγγονθ᾽ ὥστε θεοῖσι συνιέμεν, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ταύρου ἐριβρύχεω, μένος ἀσχέτου, ὄσσαν ἀγαύρου,
ἄλλοτε δ᾽ αὖτε λέοντος ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντος,
ἄλλοτε δ᾽ αὖ σκυλάκεσσιν ἐοικότα, θαύματ᾽ ἀκοῦσαι,
ἄλλοτε δ᾽ αὖ ῥοίζεσχ᾽, ὑπὸ δ᾽ ἤχεεν οὔρεα μακρά.
Lorsque Zeus eut chassé du ciel les Titans, la vaste Terre, s'unissant au Tartare, grâce à Aphrodite à la parure d'or, engendra Typhon, le dernier de ses enfants : les vigoureuses mains de ce dieu puissant travaillaient sans relâche et ses pieds étaient infatigables ; sur ses épaules se dressaient les cent têtes d'un horrible dragon, et chacune dardait une langue noire ; des yeux qui armaient ces monstrueuses têtes, jaillissait une flamme étincelante à travers leurs sourcils ; toutes, hideuses à voir, proféraient mille sons inexplicables et quelquefois si aigus que les dieux même pouvaient les entendre, tantôt la mugissante voix d'un taureau sauvage et indompté, tantôt le rugissement d'un lion au cœur farouche, souvent, ô prodige ! les aboiements des chiens ou des clameurs perçantes dont retentissaient les hautes montagnes.
Hésiode, Théogonie, v. 820-835,
éd. et trad. Paul Mazon,
Paris, Les Belles Lettres, CUF, 1928.
Le texte grec dit que la Terre τέκε παῖδα, « engendra un enfant ». Le mot παῖδα est épicène, il peut être genré au masculin et au féminin. Ici, l’absence d’article ne nous dit pas ce qu’il en est et, en conséquence, la créature semble originellement jouir d’une nature hors genre. Cela dit, la description qui est donnée de Typhon s’inscrit dans des stéréotypes du genre masculin. Ainsi, les mains sont décrites comme étant ἐπ᾽ ἰσχύι, c’est-à-dire « vigoureuses ». La force physique, la puissance, la résistance ou encore la violence sont des sèmes qui peuvent être rattachés à ce terme et qui rappellent une existence toute masculine dans la littérature de l’époque. Le terme ἰσχύς, quand il signifie la « vigueur », la « force physique », est habituellement rattaché à des individus de genre masculin, comme il en va des animaux qui constituent l’assemblage du corps de Typhon : un dragon, un taureau sauvage et indompté, un lion et des chiens[1]. Cela est d’autant plus marquant que le terme employé pour désigner le lion est λέοντος, un mot essentiellement masculin, si bien que le grec utilise un mot différent pour désigner la lionne, λέαινα, qui n’est pas présent dans le texte. Signalons que les σκυλάκεσσιν sont néanmoins employés sans distinction de genre alors qu’il peut s’agir d’un mot aussi bien masculin que féminin. Il y a cependant indéniablement, par les stéréotypes convoqués, les images figurées ou encore les termes employés, une volonté de rattacher Typhon aux stéréotypes de genre masculin et ce dès les premières traces du mythe que l’on peut retrouver parmi les civilisations gréco-romaines, notamment chez Hésiode, qui est d’ailleurs le premier et le seul, parmi les écrits qui nous sont parvenus, à donner une description si étoffée du monstre. Puisqu’il est un personnage destructeur, c’est la masculinité qui lui est rattachée, parce que, comme nous avons commencé à l’entrevoir au fil des différentes chroniques, les créatures ou les éléments ne semblent pas véritablement pouvoir exister hors du prisme du genre.
Adrien Bresson et Blandine Demotz
[1] Typhon est d’ailleurs généralement représenté sous des traits masculins sur la céramique. Voir « Zeus lancer un coup de foudre à Typhon représenté sur un vase athénien, vers 490 J.-C ». La carrure et la taille des bras de Typhon ne laissent aucun doute quant à son genre en comparaison des représentations qui sont faites des hommes à l’époque
Dans la même chronique

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (4) : Des Géants genrés

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (3) : Stéréotypes et histoire du mythe
Dernières chroniques

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi
