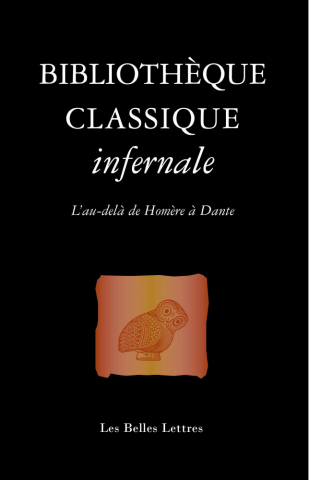
(Article initialement publié sur Le Blog des Belles Lettres)
La bibliothèque classique infernale : l’au-delà d’Homère à Dante
Hier comme aujourd’hui, qui ne voudrait pas savoir ce qui se passe « après » ?
À cette interrogation, les réponses des Grecs et des Romains, dans leur forme comme dans leur fonds, sont multiples. C’est une des grandes sagesses des Anciens que d’admettre qu’en matière de théories il y a la place pour plusieurs vérités, et pour un nombre encore plus important d’erreurs indispensables. Pas de croisade ni de guerre sainte dans l’Antiquité : à côté des ombres du royaume des morts cohabitent,non sans mal il est vrai, la foi en la survie de l’âme, à sa transmigration dans un autre corps (la métempsycose est la croyance la plus répandue dans l’Antiquité), le matérialisme enseignant le retour au néant, le doute et l’espoir d’une résurrection. […]
Différence essentielle avec ce que la tradition chrétienne nous fait appeler « Enfer », tout le monde est appelé au domaine des ombres dans l’Antiquité. Les meilleurs ont droit aux champs Élysées, les pires, des dieux comme des hommes, au Tartare, la plupart au pré des asphodèles, les fleurs des fantômes. Pour décider de leur sort, trois juges, Minos, Éaque et Rhadamante. Quel que soit le lieu, tous regrettent la lumière. Autre différence radicale, il n’y a guère de salut (à part pour les adorateurs d’Orphée) dans la culture antique.
D’Hadès il ne faut rien espérer, à part sortir de son royaume : quelques dieux et héros n’y sont-ils pas parvenus ? Parmi eux Orphée, bien sûr, mais sans son Eurydice. Rien ne vaut la vie murmurent nombre d’auteurs de l’Antiquité. »
Extrait de l’avant-propos de Laure de Chantal
Laure de Chantal, directrice aux Belles Lettres de la collection « Signets », créatrice du site La Vie des Classiques, et auteur de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, invite le lecteur à parcourir de nouveaux chefs-d’œuvres de la littérature antique. Cette bibliothèque idéale des Enfers grécoromains rassemble plus de trente textes d’Homère à Dante. Vous y croiserez Claudien, Properce, Platon ou Nonnos, et leurs textes célèbres ou plus obscurs, vous cheminerez parmi les lamelles d’or orphiques et les fèves de Pythagore, à la rencontre de fantômes qu’un peu de sang, de lait et de miel pouvait jadis faire revenir du royaume des ombres…
EXTRAIT
Rien ne vaut la vie, voici la terrible vérité que Plutarque rappelle à sa femme en deuil de leur petite fille. Vous avez choisi de lire, et nous vous en remercions, les mots justes du philosophe. Les voici donc, dans cet extrait de Consolation à sa femme, aussi poignant que digne.
« Plutarque à sa femme : salut.
Le courrier que tu m’avais expédié pour m’apprendre la mort de notre enfant m’a manqué,vraisemblablement, sur la route d’Athènes ; mais, lorsque je fus arrivé à Tanagra, j’ai appris la nouvelle par ma petite-fille. Je suppose donc que la cérémonie des funérailles est maintenant terminée, et terminée, je le souhaite, de façon à te faire, pour le présent et pour l’avenir, le moins de peine possible. Peut-être as-tu encore quelque projet que tu n’as pas exécuté, attendant d’avoir là-dessus mon avis, et dont il te semble que la réalisation doive soulager ta douleur : fais-le, en évitant seulement toute recherche exagérée et toute superstition ; ces défauts, d’ailleurs, personne n’en est plus éloigné que toi.
Je ne demande qu’une chose, ma chère femme, c’est que dans la souffrance, nous gardions, toi et moi, notre sérénité. Pour m apart, je sais et je mesure toute l’étendue de notre perte ; mais si je te trouve abandonnée à une douleur excessive, j’en serai plus peiné encore que du malheur même qui nous est arrivé. Et, pourtant, je ne suis « ni de chêne ni de pierre », tu le sais bien, toi avec qui j’ai partagé l’éducation de tant d’enfants, tous élevés par nos soins dans notre maison ; je sais également quelle joie extraordinaire cela avait été, pour toi, d’avoir une fille, que tu désirais après la naissance de quatre garçons, et pour moi, d’avoir l’occasion de lui donner ton nom. Un charme tout particulier s’attache, en outre, à l’amour que l’on porte aux enfants d’un âge si tendre : la joie qu’ils nous donnent est si pure et si libre de toute colère et de tout reproche ! La nature avait donné à notre fille une amabilité et une douceur merveilleuses ; sa manière de répondre à notre tendresse et son empressement à faire plaisir nous ravissaient tout à la fois et nous révélaient la bonté de son caractère ; ainsi elle demandait à sa nourrice de présenter et de donner le sein, non seulement aux autres enfants, mais encore aux objets personnels et aux jouets qu’elle aimait ; comme si elle invitait par bonté, à sa table particulière, en quelque sorte, les choses qui lui donnaient du plaisir, pour leur communiquer ce qu’elle avait de bon et partager avec elles ce qu’elle avait de plus agréable.
Je ne vois pas, ma chère femme, pourquoi ces traits et tant d’autres qui nous charmaient de son vivant susciteraient en nous aujourd’hui l’affliction et le trouble, quand nous venons à y penser. Je craindrais bien plutôt, au contraire, qu’avec la douleur le souvenir ne s’en effaçât en nous. […] Mais, comme cette enfant fut pour nous durant sa vie l’être, de tous, que nous aimions le plus à choyer, à contempler et à entendre, de même son souvenir doit habiter en nous, nous accompagner dans la vie en nous donnant de la joie, bien plus, et je dirais même cent fois plus, que de la peine, si les discours que nous avons tenus souvent à d’autres doivent, comme il est naturel, nous servir à nous-mêmes dans l’occasion ; il ne faut pas que nous restions abattus et renfermés sur nous-mêmes, opposant aux joies du passé des souffrances cent fois plus nombreuses. […]
Ce n’est pas seulement « dans les fêtes bachiques » qu’une femme honnête doit demeurer sans souillure ; elle doit savoir que, dans le deuil, il ne faut pas moins modérer le trouble et l’agitation de la douleur ; cette modération ne combat pas, comme le pense le vulgaire, l’amour maternel, mais l’intempérance de l’âme. Nous satisfaisons à l’amour envers nos enfants par les regrets, par les honneurs que nous rendons à nos disparus, par le souvenir que nous conservons d’eux ; mais ce désir insatiable de pleurer qui nous incite à pousser des gémissements et à nous frapper la poitrine n’est pas moins honteux que l’intempérance dans les plaisirs, encore qu’il trouve une manière d’excuse dans le fait que cette honte-là s’accompagne de chagrin et d’amertume au lieu de jouissance. […]
Pour nous, ma chère femme, nous n’avons jamais eu à nous quereller de la sorte et je pense bien que nous n’aurons jamais à le faire. La modestie de ta toilette et l’absence de luxe dans ta façon de vivre ont frappé tous les philosophes sans exception qui ont vécu dans notre société et dans notre intimité ; et il n’est aucun de nos concitoyens à qui tu n’offres, dans les cérémonies religieuses, les sacrifices ou au théâtre, le spectacle de ta simplicité. D’ailleurs, tu as déjà montré une grande constance en des occasions semblables à celles d’aujourd’hui, lorsque tu as perdu l’aîné de nos fils et une seconde fois encore lorsque Chaeron, cet aimable enfant, nous quitta. Je m’en souviens ; je revenais d’un voyage en mer avec des hôtes quand on m’annonça la mort de l’enfant ; ils entrèrent en même temps que les autres personnes dans notre maison ; voyant quelle tranquillité et quel calme y régnaient, ils crurent (comme ils l’ont raconté plus tard à d’autres gens) qu’aucun malheur n’était arrivé et que c’était simplement un faux bruit qui avait circulé ; tant tu avais, sans te troubler, maintenu ta maison en ordre en des circonstances qui rendent le plus grand désordre bien pardonnable ; et pourtant tu avais nourri toi-même l’enfant au sein, et tu avais dû subir une intervention chirurgicale à la suite d’une contusion à cet organe. Voilà bien les sentiments d’un cœur courageux et aimant. Au contraire, la plupart des mères, nous le voyons, attendent que leurs petits aient été lavés et arrangés par des étrangères, pour les prendre dans leurs bras comme des jouets ; après cela, s’ils viennent à mourir, elles s’abandonnent à un deuil aussi futile que déplaisant. Ce n’est pas l’affection – qui est une chose raisonnable et belle –, mais le mélange d’une sensibilité naturelle plutôt faible avec une forte disposition aux idées fausses, qui fait naître ces deuils sauvages, frénétiques et sans remède. »
Traduction de Jean Hani. L’intégralité de l’extrait est à lire pages 352 à 361 de la Bibliothèque classique infernale.
Dans la même chronique

[SACRÉ LUCIEN !] Grand Écart — Lucien et l’iPhone
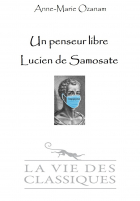
[SACRÉ LUCIEN !] Anne-Marie Ozanam - Un penseur libre, Lucien de Samosate
Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon
