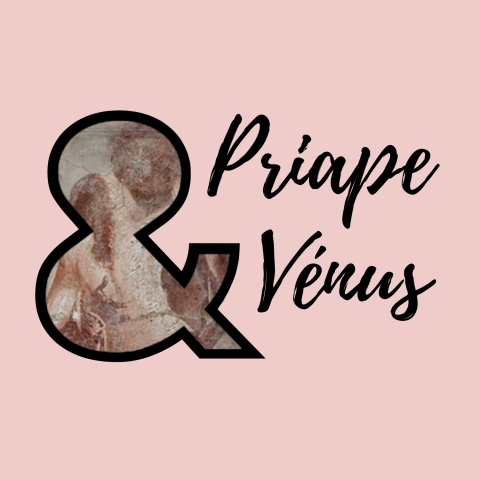
Jeune femme passionnée par la Rome antique, j’ai développé, au cours de mes études et au fil de diverses conférences et lectures, un intérêt grandissant pour la sexualité des Romains. Comment le sexe était-il perçu, pratiqué ou évoqué par nos ancêtres ? Voilà l’objectif de cette chronique qui tentera d’expliquer le présent par le passé.
Les plantes et le langage érotique entretiennent d’étroites relations. Mais au-delà d’être à l’origine de métaphores et autres allusions sexuelles, certaines ont pour vocation de faire naître l’amour, ou, plus précisément, de stimuler le désir sexuel. Ces plantes sont alors qualifiées d’aphrodisiaques. Un aphrodisiaque est par définition une substance, naturelle ou chimique, qui stimule le désir sexuel. Il peut également servir à augmenter les performances sexuelles. En grec, ἀφροδισιακός désigne « ce qui concerne les plaisir de l’amour ». Ces substances sont nommées d’après la déesse de l’amour, Aphrodite.
Je ne vais bien sûr pas vous présenter l’ensemble des produits aphrodisiaques dans cette chronique. Je vais me concentrer sur une plante en particulier : la roquette. La roquette est une plante annuelle hérissée à la base dont les tiges font entre vingt et soixante centimètres de haut. Ses feuilles, au goût poivré et amer, sont consommées depuis l’Antiquité, et ses graines peuvent également être utilisées pour obtenir de l’huile végétale.
Du latin eruca, la roquette tire son nom de la chenille homonyme. En effet, la tige velue de la roquette rappelle le corps d’une chenille. On peut également rapprocher eruca du verbe erodere « ronger » qui rappelle alors le goût de la plante. En grec ancien, roquette se dit εὔζωμον (littéralement, qui fait un bon jus), ce qui semble faire référence à son usage alimentaire. La roquette n’est pas uniquement un aliment, mais aussi un médicament.
Les vertus aphrodisiaques de la roquettes sont évoquées par plusieurs auteurs. Pline l’Ancien écrit dans son Histoire naturelle (XIX, 44) que la roquette excite à l’amour :
« La roquette et le cresson viennent très facilement ou en été ou en hiver; la roquette surtout brave les froid.; douée de propriétés différentes de celles de la laitue, elle excite à l'amour; aussi est-on dans l'habitude de mêler ces deux plantes dans les mets, afin qu'un excès de chaleur se trouve compensé par un excès de froid. »
Le médecin grec du IVᵉ siècle Oribase évoque également, dans ses Collections médicales, les effets aphrodisiaques de la roquette, et propose la même solution que Pline pour en annuler les effets indésirés :
1. Θερμαίνει σαφῶς τοῦτο τὸ λάχανον, ὥστε οὐδὲ μόνον ἐσθίειν αὐτὸ ῥᾴδιον ἄνευ μίξεως τοῖς φύλλοις τῆς θριδακίνης. 2. Ἀλλὰ καὶ σπέρμα γεννᾶν πεπίστευται καὶ τὰς πρὸς συνουσίαν ὁρμὰς ἐπεγείρειν.
« 1. Ce légume échauffe manifestement, aussi n'est-il pas facile de le manger seul sans le mêler aux feuilles de laitue. 2. On admet encore qu'il engendre du sperme et qu'il excite les désirs vénériens[1]. »
Dans l’Art d’aimer, Ovide présente différents végétaux susceptible d’améliorer la libido. Il évoque alors une « herbe amoureuse qui croît dans nos jardins[2] ». Cette herba salax est la roquette. Le poète mentionne aussi la roquette dans les Remèdes à l’amour :
« Pour remplir tous les devoirs d’un médecin, je vais aller jusqu’à t’indiquer les mets à éviter et à rechercher. L’oignon, qu’il soit daunien, qu’il soit expédié des rivages de Lybie ou vienne de Mégare, l’oignon est toujours mauvais pour toi. De même, il est bon d’éviter les roquettes, cet aphrodisiaque et tout ce qui porte nos sens aux plaisirs de l’amour[3]. »
L’auteur latin Columelle (Iᵉʳ siècle) évoque également la fonction aphrodisiaque de la roquette dans son traité De l'Agriculture (X, 369) :
« Mais le temps est venu de couper les primeurs, d'arracher les thyrses de la laitue de Tartessus et de Paphos, de lier en bottes le persil et le poireau aux feuilles effilées. Déjà se montre dans les jardins féconds la roquette aphrodisiaque (…). »
Dans ses Epigrammes (III, 75), Martial s’en prend à un dénommé Lupercus qui, souffrant d’impuissance, aurait tout mis en œuvre pour retrouver sa vigueur, notamment consommer de la roquette :
Stare, Luperce, tibi iam pridem mentula desit,
luctaris demens tu tamen arrigere.
Sed nihil erucae faciunt bulbique salaces,
inproba nec prosunt iam satureia tibi.
Coepisti puras opibus corrumpere buccas :
sic quoque non uiuit sollicitata Venus.
Mirari satis hoc quisquam uel credere possit,
quod non stat, magno stare, Luperce, tibi ?
« Il y a bien longtemps, Lupercus, que ta bite ne s’est plus dressée,
mais tu te bats comme un fou pour bander.
Rien n’y fait, pourtant, ni roquette, ni oignons lascifs,
et la sarriette lubrique n’a plus d’effet sur toi.
Tu as commencé à corrompre des bouches pures avec de l’argent,
et même excité de la sorte, ton membre ne prend pas vie.
Peut-on s’étonner assez, peut-on croire seulement,
que ce qui ne monte pas, Lupercus, fasse monter en flèche tes dépenses ?[4] »
La roquette est donc une plante dont la consommation favoriserait le désir sexuel. Les textes de Pline et Oribase montrent cette croyance, et les astuces mises en place afin de contourner les effets non désirés. Si l’aspect aphrodisiaque de la plante ne fait plus aucun doute, son lien avec une divinité n’a pas encore été explicité. Nous allons pour cela retourner dans l’œuvre de Columelle qui fait mention de la relation entre la roquette et un dieu :
« Semez aussi la violette pâlissant sur le sol, le violier dont les rameaux s'empourprent d'or, et la rose qu'embellit l'excès de sa pudeur. N'oubliez pas le panax au suc médicinal, le glaucium dont le jus est salutaire, et les pavots qui enchaînent le sommeil fugitif; non plus que les semences aphrodisiaques du bulbe de Mégare, qui enflamme les hommes et anime les jeunes filles, et ces plantes que le Gétule cueille sèches sous ses gazons, la roquette que l'on sème près de la statue du fécond Priape, pour exciter au culte de Vénus les maris indolents.[5] »
La roquette est ainsi associée à Priape. Ce dernier est un dieu ithyphallique (qui a le pénis en érection), un dieu de la fertilité, protecteur des jardins et des troupeaux. Les Romains plaçaient souvent dans des jardins des statues en bois du dieu qui servaient notamment d’épouvantail ou de protection contre les voleurs. C’est un dieu à la sexualité exacerbée. Il est donc peu surprenant qu’une herbe aphrodisiaque lui soit associée.
Fresque de Priape, Maison des Vettii, Pompéi
La roquette est également mentionnée dans deux poèmes des Priapées[6] (ensemble de poèmes licencieux sur le dieu Priape) :
« Toi, fille, dont le teint n'est pas plus clair que celui d'un Maure, mais plus maladif que celui de tous les mignons, toi qui es plus courte que le Pygmée qu'effraye la grue, plus hirsute et plus poilue que les ours, plus large que les braies des Mèdes ou des Indiens, tu restes ici : tu ferais bien mieux de partir ailleurs ! En vérité, bien que je semble suffisamment équipé, j'ai besoin de dix bottes de roquette pour frotter les fosses de ton sexe et râper les vermisseaux grouillants de ton con. » (46)
« (…) Je ne crois pas que quiconque vienne pour mes gourdes pleines de graines, pour mon basilic ou pour mes concombres étalés sur le sol, ou pour voler mes laitues pommées, mes oignons piquants et mon ail, pas plus que pour emporter, de nuit, la roquette aphrodisiaque et la menthe odorante en même temps que la rue médicinale. Toutes ces choses-là, même si nous les avons dans note enclos, les jardins voisins ne les produisent pas moins, Pourtant vous les négligez, ignobles voleurs, et vous venez dans le jardin dont je m'occupe ! Aucun doute: vous vous précipitez tous vers un châtiment bien visible, et c'est précisément ce dont nous vous menaçons qui vous attire ! » (51, v. 17-28)
La roquette semble être semée à un endroit propice, les jardins où sont élevées des statues du dieu Priape. Il ne faut pas oublier que Priape symbolise également la fécondité du sol. On peut également supposer que l’on plaçait l’herbe aphrodisiaque auprès de Priape dans l’espoir que l’excitation sexuelle du dieu soit transmise à la plante. Les effets aphrodisiaques de la roquette semblent pouvoir être provoqué de différentes manière : soit par ingestion, soit par contact avec la peau (a priori du sexe), ce qui semble plus rare.
La croyance que la roquette excite le désir sexuel a perduré au Moyen-Âge. Il était ainsi défendu aux moines de la cultiver et de la manger puisqu’elle prédisposerait au désir charnel. On a cependant continué de la consommer, et la roquette est aujourd’hui un indispensable de nos assiettes (notamment en salade). Et encore maintenant, il n’est pas rare d’entendre parler des pseudo-vertus aphrodisiaques de cette plante. Bien que ces effets restent à démontrer pourquoi ne pas tenter sa chance avant un rendez-vous ? Ou, pour les plus prudent, prévoir un peu de laitue pour l’accompagner.
[1] Oribase, Collections médicales, II, 13, trad. Dr. Bussemaker et Daremberg, Imprimerie nationale, 1851-1876.
[2] Ovide, Art d’aimer, II, 432.
[3] Ovide, Les remèdes à l’amour, v. 795-797.
[4] Martial, Epigrammes, III, 75, éd. et trad. Sophie Malick-Prunier, Les Belles Lettres, 2021.
[5] Columelle, De l'Agriculture, X, 108, trad. Eugène De Saint-Denis, Les Belles Lettres, 1969.
[6] Priapées, éd. et trad. Louis Callebat), Les Belles Lettres, 2012.
Dans la même chronique

Priape & Vénus – Le speculum

Priape & Vénus – Les sex-toys
Dernières chroniques


