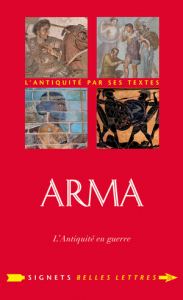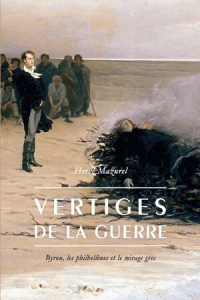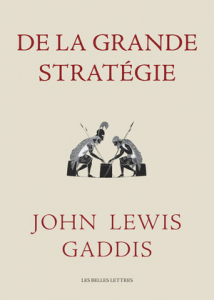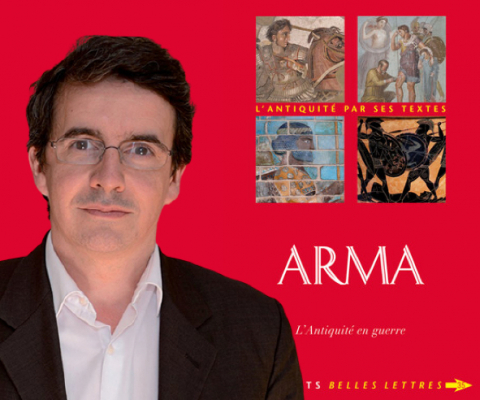
Historien spécialisé dans l’histoire sociale et culturelle de la Première Guerre mondiale, Bruno Cabanes est titulaire de la chaire Donald G. and Mary A. Dunn d’histoire de la guerre à l’Ohio State University après avoir enseigné à la Yale University. Ancien élève de l’École normale supérieure, il a consacré sa thèse de doctorat à la démobilisation des soldats français : La Victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français (1918-1920) (Paris, Seuil, 2004, rééd. « Points Histoire », 2014). Bruno Cabanes est l’auteur de nombreux ouvrages sur la Première Guerre mondiale et la sortie de guerre et a dirigé un imposant volume collectif intitulé Une histoire de la guerre. Du XIXe siècle à nos jours (Paris, Seuil, 2018).
Isabelle Warin & Estelle Debouy. – Vous êtes historien spécialiste de l’histoire contemporaine, mais quels liens entretenez-vous avec les mondes grec et romain de l’Antiquité ?
Bruno Cabanes. – L’Antiquité grecque reste un peu, pour moi, le pays de mon enfance, la destination de nos étés en famille, où nous accompagnions mon père, épigraphiste, dans ses travaux de recherche. Le souvenir de ces séjours en Grèce m’a sans doute, finalement, plus influencé que je ne l’ai longtemps cru. Par cette fréquentation précoce des paysages méditerranéens, la recherche historique m’est apparue absolument indissociable des sensations multiples, parfum entêtant des oliveraies, lumière aveuglante, chaleur étouffante de midi, qui assaillent les voyageurs comme les archéologues. J’ai retrouvé cette évidence, bien plus tard, en visitant des champs de bataille, de Verdun à Peleliu : des paysages évidemment remodelés par le temps, modifiés par notre regard si différent de celui des combattants, mais porteurs de tellement de traces, parfois infimes, de leur passé de violence.
Il y eut aussi, dans cette formation inconsciente de l’enfance, le spectacle de la pratique quasi artisanale de l’épigraphie : la pierre gravée qu’il fallait d’abord nettoyer, sur laquelle on appliquait le papier d’estampage, que l’on frappait ensuite à coups réguliers avec une brosse pour en chasser les bulles d’air, et que l’on décollait délicatement pour déchiffrer les inscriptions venues, comme par magie, s’y imprimer. Cette technique m’a appris, je crois, par quels parcours complexes on parvient peu à peu à restituer, pour peu qu’on conserve à ce terme sa part d’incertitude, les traces du passé. Et pas le passé idéal du monde des cités, cette « trop parfaite statue taillée dans un marbre trop blanc » comme l’écrit Marguerite Yourcenar dans En pèlerin et en étranger[1] lorsqu’elle parle de l’Athènes du Ve siècle, mais le monde de l’ethnos, dans les marges montagneuses de la Grèce : l’Épire, une région encore marquée – je parle de la fin des années 1970 – par les vestiges de l’Empire ottoman, avec ses sites difficilement accessibles, envahis par les troupeaux de moutons plutôt que par les touristes, ses routes tortueuses qui nous rendaient malades en voiture. C’est enfin en me rendant en Albanie, quelques années plus tard, également pour y découvrir des sites archéologiques, que j’ai compris que l’Antiquité n’était pas, au sens propre, un passé aboli – si tant est qu’il puisse l’être totalement – mais un passé profondément investi d’enjeux idéologiques, autour notamment de la question de l’autochtonie des populations illyriennes.
Et puis, au fil des années, l’Antiquité a été associée aux cours de langues anciennes au lycée, au « petit latin » de la khâgne, à la redoutable traduction d’Homère à l’oral du concours de la rue d’Ulm. Une Antiquité que j’ai retrouvée ensuite en lisant les poètes anglais de la Grande Guerre ou en m’intéressant aux soldats australiens et néo-zélandais qui se battaient à Gallipoli, à quelques kilomètres de Troie à vol d’oiseau. Et même en venant m’installer aux États-Unis, il y a un peu plus de quinze ans, depuis les fraternités du campus de Yale en forme de temples jusqu’aux noms de nombreuses villes du Midwest : Akron ou Athens dans l’Ohio, Argos, Crete ou Delphi dans l’Indiana... C’est mon ami Bernard Chambaz qui le souligne dans Dernières nouvelles du martin-pêcheur : les États-Unis, l’un de ses arrière-pays à lui, le romancier des traversées et des passages, sont intimement liés aux mythes antiques[2]. Sur l’autre rive de l’Atlantique, l’Antiquité continue de cheminer en nous.
IW&ED. – Les batailles de l’Antiquité exercent encore aujourd’hui une réelle fascination. Est-ce qu’il y a une bataille ou bien un texte portant sur un fait militaire qui aurait retenu votre attention ? Et pourquoi ?
BC. – Qu’est-ce qui nous fascine dans les batailles de l’Antiquité ? Leur dramaturgie, les émotions guerrières, en premier lieu, évidemment, celles d’Achille[3], le choc des armes dont l’écho est encore perceptible grâce aux auteurs antiques – sans doute tout cela à la fois ? Songez à la puissance d’évocation de la bataille de Salamine dans Les Perses d’Eschyle : « Les coques se renversent ; la mer disparaît sous un amas d’épaves, de cadavres sanglants ; rivages, écueils, sont chargés de morts, et une fuite désordonnée emporte à toutes rames ce qui reste des vaisseaux barbares – tandis que les Grecs, comme s’il s’agissait de thons, de poissons vidés du filet, frappent, assomment, avec des débris de rames, des fragments d’épaves ! » On se croirait dans la grande scène de la pêche aux thons dans Stromboli (1950) de Roberto Rossellini. « Une plainte mêlée de sanglots règne sur la mer au large, jusqu’à l’heure où la nuit au sombre visage vient tout arrêter. » Il est évident que nous n’entretenons plus avec la littérature et l’imaginaire antiques le même rapport que celui des volontaires philhellènes des années 1820, magnifiquement étudiés par Hervé Mazurel[4]. Pourtant quel enchantement.
Parmi tous les textes qui me reviennent en mémoire, la description du bouclier d’Achille au chant XVIII de l’Iliade, la narration de l’hubris de Xerxès – qui transforme la mer en terre ferme en attachant ensemble ses bateaux pour traverser l’Hellespont puis regarde son armée « défiler pendant sept jours et sept nuits », selon Hérodote –, ou l’évocation des fleuves de sang de la bataille de Cannes (Tite-Live, au livre XXII de son Histoire romaine) par exemple, je dois avouer qu’il est impossible de faire un choix. Dès lors, s’il fallait néanmoins distinguer un texte auquel je continue à me référer régulièrement, je pense que ce serait l’oraison funèbre de Périclès, au livre II de La Guerre du Péloponnèse de Thucydide, parce qu’elle esquisse l’image d’une sorte d’Athènes imaginaire à destination des Athéniens du Ve siècle et du début du IVe siècle (sur laquelle Nicole Loraux a écrit des pages inoubliables[5]), parce qu’elle pose la question centrale du rapport entre guerre, citoyenneté et démocratie (un problème sur lequel les historiens américains ont beaucoup réfléchi récemment, depuis les engagements en Irak et en Afghanistan), et parce qu’elle invente une manière de commémorer collectivement les morts : une thématique évidemment très présente au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1914-1918, cette commémoration passe par deux lieux de mémoire principaux : la tombe du soldat inconnu, qui incarne le deuil de masse et le focalise dans un espace mémorial central, et le monument aux morts, véritable « espace transitionnel » (Donald Winnicott) pour toutes les familles qui doivent faire leur deuil en l’absence des corps[6].
IW&ED. – Les auteurs grecs et latins ont alimenté une véritable réflexion sur la guerre et la paix. Le basculement de la guerre à la paix, que vous avez abordé dans vos travaux, est également au cœur des discussions antiques. Ainsi, Cicéron écrit « que les armes le cèdent à la toge » (cedant arma togae) (Des devoirs, XXII, 77). Cette expression latine est d’ailleurs symbolique de ce passage de l’une à l’autre. Quelles réflexions cela vous inspire-t-il ?
BC. – Cette expression de Cicéron, telle que je la comprends, désigne la reprise en main progressive de l’espace public par la politique et l’effacement des hommes de guerre. Dans la Rome antique, on le sait, la fermeture des portes du temple de Janus marquait le passage de la guerre à la paix. C’était aussi un rituel qui visait à contenir la violence de la guerre à l’extérieur de la cité. On peut le rapprocher d’autres rituels destinés à purifier les combattants du contact avec le sang versé. Les lendemains de la Première Guerre mondiale ne connaissent plus, à l’inverse, de coupure nette entre guerre et paix. Sans doute le prix de la mort de masse fut-il trop lourd : trop de familles étaient endeuillées, des régions entières avaient été dévastées par les combats. On ne pouvait plus imaginer la paix comme auparavant.
Les historiens en ont pris acte, assez tardivement d’ailleurs, en substituant le concept de « sortie de guerre », qui traduit un mouvement complexe, fait d’une alternance de périodes de démobilisation et de remobilisation, à la notion traditionnelle d’après-guerre, qui était celle de l’histoire diplomatique. En d’autres termes, le concept de « sortie de guerre » permet de revisiter la chronologie de la transition entre guerre et paix (comme il convient aussi de le faire pour le passage de la paix à la guerre) en étant attentif aux rituels, aux émotions, aux manifestations de l’économie morale de la reconnaissance, à tout ce qui permet à des combattants de redevenir des civils, lorsqu’ils renouent avec un quotidien évidemment très différent de celui de l’avant-guerre. Ce qui pose aussi la grande question de l’avenir de la violence après la guerre, par exemple lorsque des conflits se prolongent en guerres civiles. Ou, pour le dire autrement, l’histoire des « sorties de guerre » permet de déplier un temps replié sur lui-même en distinguant de multiples étapes, fractures, nuances, là où l’on ne voyait jusqu’ici qu’un basculement rapide d’une période à une autre.
IW&ED. – Vous venez d’évoquer la notion de « sortie de guerre », que vous avez étudiée dans votre ouvrage La Victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français (1918-1920). Dans l’Anabase, Xénophon raconte le périple des mercenaires grecs, les fameux Dix-Mille, entrés au service de Cyrus le Jeune pour détrôner son frère Artaxerxès II. Il y fait le récit de cette caravane humaine en soulignant la part d’humanité – bonne ou mauvaise – de ces hommes progressivement gagnés par la lassitude du combat sur le chemin d’un retour semé d’embûches. Pourrait-on parler ici aussi d’une « sortie de guerre » qui a bénéficié d’un renouvellement récent de l’historiographie ?
BC. – C’est un autre aspect des sorties de guerre que vous esquissez ici : la violence de guerre et son impact sur les individus, anciens combattants ou civils. Il me semble que sur cette thématique, comme sur beaucoup d’autres, le risque est grand de reporter artificiellement, par une forme de présentisme, les questionnements de la période récente sur le passé plus lointain. Je vous en donne un exemple : au milieu des années 1990 et au début des années 2000, le classiciste et psychiatre Jonathan Shay fit paraître deux ouvrages qui connurent un certain succès, Achilles in Vietnam et Odysseus in America[7]. Ils sont encore régulièrement utilisés dans les académies militaires. Son propos, pour le dire rapidement, était le suivant : se servir de l’Iliade et de l’Odyssée pour éclairer le comportement des soldats américains au combat et de retour chez eux, pendant et après la guerre du Vietnam. Même si, sur certains points, l’auteur tombe juste (comme le prouve la valeur thérapeutique des discussions sur l’œuvre d’Homère ou sur les tragédies antiques avec des vétérans souffrant de traumatismes de guerre), ses deux livres soulèvent plus d’interrogations qu’ils ne contribuent réellement à une meilleure connaissance des hommes de guerre : y aurait-il une sorte de combattant ou vétéran éternels, confrontés aux mêmes expériences depuis la guerre de Troie jusqu’à celle d’Afghanistan ? Cela n’a évidemment aucun sens. Je suis autant réservé lorsqu’on soumet Achille aux diagnostics psychiatriques de la médecine militaire moderne que lorsque mes étudiants utilisent indistinctement les termes shell shock, qui date de 1915, et « syndrome de stress post-traumatique » (PTSD), inventé après la guerre du Vietnam. La nosographie est le produit combiné de l’état de la science et du regard que nos sociétés, c'est-à-dire aussi nos systèmes de pensée, portent sur la violence de guerre et sur les anciens combattants[8].
IW&ED. – À l’Ohio State University, vous occupez la chaire Donald G. and Mary A. Dunn consacrée à l’histoire militaire. Quelle place occupe l’enseignement de l’histoire militaire dans les universités américaines ? Et quelle importance revêt encore l’histoire militaire de l’Antiquité dans cet enseignement ?
BC. – L’enseignement de l’histoire militaire s’est développé aux États-Unis dans trois cadres avec des visées distinctes. D’abord les académies militaires, dans lesquelles il contribue à la formation intellectuelle des cadets : la tradition cherchait dans les guerres du passé des modèles stratégiques et tactiques susceptibles d’être utilisés par les officiers des conflits en cours. On y enseignait par exemple les grandes batailles de l’Antiquité. L’enseignement a cependant beaucoup évolué sous l’influence du milieu académique, et parce que de plus en plus de jeunes officiers sont envoyés dans les universités publiques, comme l’Ohio State University, pour faire leur thèse de doctorat puis enseigner à leur tour dans les académies. Des historiens comme Denis Showalter (1942-2019) ou Michael Neiberg, pour ne citer que des spécialistes de la période contemporaine, ont contribué à diversifier et enrichir considérablement cet enseignement de l’histoire militaire à la U.S. Air Force Academy, à la U.S. Military Academy à West Point, à la Marine Corps University, au U.S. Army War College ou au U.S. Naval War College.
L’histoire de la guerre est également convoquée dans les programmes de « grande stratégie », comme celui développé par John Gaddis et Paul Kennedy à la Yale University, depuis 2000 : ces cours destinés à des étudiants qui iront travailler plus tard pour le Département d’État ou le ministère de la Défense visent à leur donner des bases solides sur les textes classiques (La Guerre du Péloponnèse de Thucydide, L’Art de la guerre de Sun Tzu, Le Prince de Machiavel, De la guerre de Clausewitz...) en les incitant à réfléchir sur des études de cas tirés de l’Antiquité et des époques médiévale et moderne[9]. Dans cette même perspective, on pourrait citer l’ensemble des travaux de l’historien Victor Davis Hanson, qui tournent autour de la question, par ailleurs très discutée, de la supériorité militaire de l’Occident[10].
Enfin, une poignée d’universités publiques américaines disposent de programmes d’enseignement et de recherche importants sur l’histoire militaire – ou plus largement sur ce qu’on appellerait en France, à la suite de Stéphane Audoin-Rouzeau, « l’histoire du fait guerrier » et que les historiens américains désignent ici sous les termes de new military history ou war and society : l’Ohio State University, où ont enseigné Joe Guilmartin, Allan R. Millett et Williamson Murray, compte cinq historiens spécialistes de ces questions, Mark Grimsel, Peter Mansoor, Geoffrey Parker (l’auteur de la célèbre Révolution militaire[11]), Yiğit Akin et moi-même ; d’autres programmes de ce type existent à l’University of North Carolina à Chapel Hill, à l’University of Wisconsin, à l’University of North Texas ou au Dale Center for the Study of War and Society dans le Mississippi notamment. Pour être complet sur le paysage académique, intellectuel et culturel de l’histoire militaire, il faudrait souligner l’influence de la Society for Military History, fondée en 1933, qui compte plus de 2 500 membres, et de nombreux musées, comme le National World War I Museum and Memorial à Kansas City, le National World War II Museum (anciennement D-Day Museum) à la Nouvelle-Orléans, ou d’institutions comme le Pritzker Military Museum & Library à Chicago.
Ce foisonnement de lieux de recherche et d’enseignement le montre bien : les définitions de l’histoire militaire sont multiples. Les historiens militaires plus traditionnels ont parfois souffert d’une forme de « syndrome du bunker », qui désigne le sentiment d’être tenus à l’écart, marginalisés, incompris, parfois même un peu méprisés par les autres historiens, qui ont peu de considération pour la drums and trumpets history (« l’histoire des tambours et trompettes »), c’est-à-dire une histoire-bataille peu sophistiquée. Dans le même temps, ces mêmes historiens militaires peuvent aussi se prévaloir du succès éditorial de leurs ouvrages, qui occupent des rayons entiers des librairies Barnes and Noble. En réalité, ces réactions épidermiques masquent l’évolution profonde du champ de l’histoire de la guerre, aux États-Unis comme en Europe, sous l’influence par exemple de l’histoire du genre, de l’histoire culturelle ou de l’histoire environnementale, ou parce que l’histoire militaire se détache du cadre strictement national, dans lequel elle s’est longtemps enfermée, pour embrasser des perspectives à la fois plus transnationale ou globale et interdisciplinaire.
IW&ED. – Vous abordez l’histoire militaire sous l’angle de l’histoire sociale et culturelle en plaçant les acteurs du phénomène guerrier au cœur de vos recherches. Pourriez-vous revenir brièvement sur les évolutions récentes de l’histoire militaire ?
BC. – Il est toujours délicat de déterminer des moments historiographiques ou des œuvres qui auraient réorienté un champ aussi complexe que l’histoire militaire. Mais s’il fallait retenir un ouvrage, je serais tenté de mettre en avant le grand livre de John Keegan, Anatomie de la bataille, paru en 1976[12]. Car l’historien britannique accompagne une véritable révolution du regard, amorcée un siècle plus tôt par Ardant du Picq dans ses Études sur le combat (1880)[13] : le stratège n’occupe plus le centre du dispositif narratif, l’histoire est écrite au niveau des simples combattants. On peut en tirer un double constat : le renouvellement de l’histoire militaire vient du cœur même de l’activité guerrière, le choc des armes. En d’autres termes, c’est cette histoire des batailles, tant décriée par l’école des Annales, qui ouvre la transformation en profondeur de l’historiographie, justement parce qu’elle n’est plus une histoire-bataille, mais une histoire du corps, de la violence... Par ailleurs, l’histoire vue d’en bas, proposée par Keegan, conduit également à une mutation du récit, non plus organisé artificiellement autour d’une chronologie où telle décision prise par un chef de guerre est suivie de son effet supposé sur le terrain, mais un récit déstructuré, éclaté, qui laisse une place à la pluralité des perspectives, à l’incertitude, au « brouillard de la guerre » pour reprendre l’expression introduite par Clausewitz. Fabrice à Waterloo intéresse désormais tout autant que Drouet d’Erlon, Ney, et même Napoléon.
Plus tard, d’autres perspectives sont apparues à leur tour : une histoire des représentations collectives et des pratiques de violence ; donc une histoire des croyances et des ferveurs, des investissements individuels et collectifs dans la guerre ; puis une histoire du corps, c’est-à-dire une histoire de la violence reçue et aussi, ce qui était finalement plus neuf encore, de la violence infligée ; une histoire de l’articulation des conflits entre eux, de l’arc de violence qui se déploie depuis la guerre de Sécession jusqu’aux conflits de la guerre froide, c’est-à-dire également une histoire de la guerre imaginée et de la guerre vécue, une histoire des initiations, des premières fois, une histoire des « sorties de guerre » ; une histoire globale des conflits, de leur dimension impériale, des mouvements d’hommes, des circulations de matières premières et des objets, de l’environnement, de l’interpénétration des modèles culturels, des espaces et des fronts lointains et, en même temps, une histoire du proche, du local, de l’intime – celle des rapports de genre, du deuil et de la mémoire familiale, des enfants et des vieillards, des correspondances et des récits de guerre, une histoire du témoignage, une histoire des sensibilités et des émotions.
IW&ED. – Dès l’Antiquité, la guerre est l’une des principales causes du déplacement des populations, aux conséquences souvent dramatiques. Dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules, Jules César mentionne plusieurs fois la déportation des populations vaincues. S’intéresser aux non-combattants est un des acquis récents de la recherche en histoire militaire et aussi un aspect important de vos travaux. En quoi cette approche est-elle un moyen de mettre en perspective le phénomène guerrier ?
BC. – Cela fait en réalité un certain temps, au moins depuis les années 1970, que les historiens de la Première Guerre mondiale, pour prendre l’exemple de mon domaine de recherche, s’intéressent aussi aux civils, par exemple à la place des femmes, à la production de guerre, aux mouvements sociaux. Plus neuve est la notion de « culture de guerre » (au singulier ou au pluriel) qui lie civils et combattants dans un même ensemble de représentations collectives, elles-mêmes soumises à toutes sortes de nuances locales, à des variations dans le temps, à des mécanismes de résistance. En d’autres termes, c’est l’interdépendance entre le front et le front intérieur qui intéresse de plus en plus les historiens, la manière dont les sociétés en guerre tiennent ensemble ou au contraire se disloquent (on peut penser aux épisodes révolutionnaires de la fin de la Première Guerre mondiale en Russie, en Allemagne, en Autriche-Hongrie), les phénomènes de censure et d’autocensure dans la circulation d’informations entre le front et l’arrière, l’auto-mobilisation des civils – une notion qui substitue à l’idée traditionnelle d’une mobilisation venue d’en haut, encadrée par l’État et par l’armée (qu’on appelle aussi « propagande ») une interprétation plus nuancée, qui met en avant le rôle des communautés locales, des groupements associatifs, des liens familiaux et amicaux, de l’émulation collective dans la mobilisation de chaque individu, en particulier dans les armées de volontaires comme le corps expéditionnaire ANZAC ou l’armée Kitchener. Cette étude de l’auto-mobilisation intègre des groupes sociaux, comme les enfants et les adolescents, qui étaient à peu près ignorés par les historiens de la guerre jusqu’au début des années 1990[14].
La question des civils comme victimes de la guerre est aussi un domaine en pleine expansion depuis une trentaine d’années. Je reprends le cas de l’historiographie de la Grande Guerre. Alors que les recherches historiques, jusque dans les années 1990, avaient surtout porté sur la violence de guerre sur les champs de bataille, les violences contre les civils dans les périodes d’invasion (je pense au grand livre de John Horne et Alan Kramer sur les atrocités commises par les Allemands en Belgique et dans le nord de la France à l’été 1914[15]) et d’occupation (voir les travaux pionniers d’Annette Becker[16]), ou encore les mouvements de réfugiés ont fait l’objet d’un intérêt de plus en plus soutenu. On peut avancer l’hypothèse que cette évolution historiographique ait été inspirée par l’actualité du « nettoyage ethnique » en Bosnie ou par le génocide des Tutsi au Rwanda, où les civils étaient délibérément pris pour cibles. Notons que ces recherches sur les atrocités commises contre les civils s’accompagnent aussi d’une réflexion sur la notion même de « violence extrême »[17], son contenu anthropologique et symbolique, et plus précisément sur les violences sexuelles, étudiées par Stéphane Audoin-Rouzeau ou Raphaëlle Branche[18]. Le champ d’études s’est ensuite étendu aux bombardements aériens (plus étudiés évidemment pour la Seconde Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam que pour la Première Guerre mondiale), aux blocus et à l’utilisation de l’arme de la faim, et au génocide des Arméniens.
Élargissons rapidement les enjeux de ces travaux à l’histoire de la guerre moderne en général. Mettre l’accent sur l’expérience des civils, c’est rappeler tout d’abord que la guerre est sans doute l’un des événements les plus marquants d’une vie humaine, et pas uniquement pour les militaires : chaque histoire familiale est scandée par des conflits, parfois sur plusieurs générations successives, par exemple dans le nord de la France, qui a connu trois invasions – en 1870, 1914 et 1940 – en quelques décennies. S’intéresser aux non-combattants, c’est aussi souligner l’évolution de la violence de guerre au cours du XXe siècle : pendant la Première Guerre mondiale, les civils formaient moins de 20 % des victimes de guerre ; à l’heure actuelle, près de 90 %. Enfin, en redonnant la parole aux populations civiles, on cherche aussi à apporter une interprétation renouvelée d’événements dont la signification déborde évidemment celle d’une simple opération militaire. Dans son grand livre sur le massacre de My Lai du 16 mars 1968, l’anthropologue Heonik Kwon a bien montré par exemple qu’il avait infligé aux survivants une « crise rituelle » majeure, en leur interdisant d’enterrer leurs morts selon la coutume et en condamnant les âmes de morts à errer sans fin autour du village[19].
IW&ED. – Nous arrivons au terme de notre entretien. De quelle manière les spécialistes de l’histoire antique et ceux de l’histoire contemporaine peuvent-ils nourrir mutuellement leurs réflexions dans le domaine de l’histoire militaire ?
BC. – Les perspectives de recherche communes sont multiples : l’histoire environnementale de la guerre ou l’histoire du corps, l’histoire de notions comme le charisme ou la guerre civile[20], ou encore l’histoire du genre pour ne citer que quelques exemples. Je suis frappé de ce que les historiens du fait guerrier restent souvent prisonniers de leur période de spécialité (parfois même de leur conflit de prédilection) et de ce que le dialogue s’engage rarement entre historiens de la période antique et ceux de la période contemporaine, peut-être faute de lieu dédié à une collaboration. On voit parfois des colloques thématiques sur la guerre urbaine, les violences sexuelles ou la captivité donner la parole à quelques spécialistes de l’Antiquité en guise d’ouverture, mais l’essentiel du propos se concentre ensuite sur les guerres du XIXe au XXIe siècle, l’apport des recherches des antiquisants n’étant pas véritablement intégré à une réflexion plus générale sur le phénomène guerrier.
Esquissons alors quelques pistes : par exemple, la question importante des frontières de la guerre et de la paix, de ce qui fait la spécificité du temps de la guerre (je pense au beau travail en cours de l’historien Nicolas Beaupré) et de l’espace de la guerre. Les historiens du contemporain tendent de plus en plus à souligner la porosité de la guerre et de la paix, à montrer comment l’imaginaire de la guerre a fini par s’imposer même en temps de paix, comme on le voit en ce moment avec la multiplication des métaphores guerrières en pleine pandémie de Covid. Dans l’Antiquité, la séparation entre guerre et paix était-elle plus nette ? Je l’ignore. Cette thématique invite aussi à s’interroger sur la contiguïté entre la guerre et d’autres activités comme le sport ou la chasse, sur laquelle certains historiens contemporanéistes, comme Christian Ingrao[21], ont réfléchi. Autre piste possible, les rituels de la guerre, qu’il s’agisse de l’initiation des jeunes gens (Pierre Vidal-Naquet) ou des cérémonies de l’entrée et de la sortie de guerre comme le triomphe[22], qui a désormais disparu, peut-être parce qu’on ne sait plus ni identifier, ni nommer, ni célébrer les victoires militaires. Ce qui inciterait également à écrire une histoire du courage, de la « belle mort » (Jean-Pierre Vernant[23]) de la manière dont les modèles antiques hérités du stoïcisme sont remobilisés par nos contemporains[24], ou de l’adaptation des standards militaires de la bravoure à des situations où les civils sont de plus en plus partie prenante de la guerre[25]. Une histoire de la violence paroxystique aussi, de ses dynamiques, de ses gestes, de ses représentations, de la manière dont elle est occultée, censurée, mise à distance ou au contraire exaltée[26]. Entre historiens des guerres antiques et modernes, la conversation ne fait que commencer.
[1] Marguerite Yourcenar, En pèlerin et en étranger, Paris, Gallimard, 1989.
[2] Bernard Chambaz, Dernières nouvelles du martin-pêcheur, Paris, Flammarion, 2014.
[3] Hélène Monsacré, Les Larmes d’Achille. Le héros, la femme et la souffrance dans la poésie d’Homère, Paris, Albin Michel, 1984 ; réédition Éditions du Félin, 2010.
[4] Hervé Mazurel, Vertiges de la guerre. Byron, les philhellènes et le mirage grec, Paris, Les Belles Lettres, 2013.
[5] Nicole Loraux, L’Invention d’Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la « cité classique », Paris, La Haye, New York, Mouton éditeur et Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1981.
[6] Jay Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; trad. fr. : Entre deuil et mémoire. La Grande Guerre dans l’histoire culturelle de l’Europe, Paris, Armand Colin, 2008.
[7] Jonathan Shay, Achilles in Vietnam. Combat Trauma and the Undoing of Character, New York, Scribner, 1994 ; Odysseus in America. Combat Trauma and the Trials of Homecoming, New York, Scribner, 2002.
[8] David J. Morris, The Evil Hours. A Biography of Post-Traumatic Stress Disorder, Boston, New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2015.
[9] John Lewis Gaddis, On Grand Strategy, Penguin Press, 2018 ; trad. fr. : De la grande stratégie, Paris, Les Belles Lettres, 2020.
[10] Victor Davis Hanson, Carnage and Culture : Landmark Battles in the Rise of Western Power, New York, Doubleday, 2001, trad. fr. : Carnage et culture. Les grandes batailles qui ont fait l’Occident, Paris, Flammarion, 2002.
[11] Geoffrey Parker, The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800, Cambridge et New York, Cambridge University Press, 1988, trad. fr. : La Révolution militaire. La guerre et l’essor de l’Occident, 1500-1800, Paris, Gallimard, 1993.
[12] John Keegan, The Face of Battle. A Study of Agincourt, Waterloo, and the Somme, New York, Viking Press, 1976 ; trad. fr. : Anatomie de la bataille, Paris, Robert Laffont, 1993.
[13] Charles Ardant du Picq, Études sur le combat. Combat antique et combat moderne, Paris, Hachette, 1880, réédition Paris, Économica, 2004. Voir Stéphane Audoin-Rouzeau, « Vers une anthropologie historique de la violence de combat au XIXe siècle : relire Ardant du Picq ? », Revue d’histoire du XIXe siècle, 30, 2005/1, p. 85-97.
[14] Manon Pignot, L’Appel de la guerre. Des adolescents au combat, 1914-1918, Paris, Anamosa, 2019.
[15] John Horne et Alan Kramer, German Atrocities, 1914. A History of Denial, New Haven, Yale University Press, 2001 ; trad. fr. : 1914. Les Atrocités allemandes, Paris, Tallandier, 2005.
[16] Annette Becker, Les Cicatrices rouges. 14-18. France et Belgique occupées, Paris, Fayard, 2010.
[17] Véronique Nahoum-Grappe, « Anthropologie de la violence extrême. Le crime de profanation », Revue internationale des sciences sociales, 2002/4, No. 174, p. 601-609.
[18] Stéphane Audoin-Rouzeau, L’Enfant de l’ennemi, 1914-1918, Paris, Aubier, 1995 ; Raphaëlle Branche, « Le viol, une arme de guerre ? » in Bruno Cabanes et al., dir., Une histoire de la guerre, du XIXe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2018, p. 591-604.
[19] Heonik Kwon, After the Massacre. Commemoration and Consolation in Ha My and My Lai, Berkeley, University of California Press, 2006.
[20] David Armitage, Civil Wars. A History in Ideas, New York, Knopf, 2017.
[21] Christian Ingrao, Les chasseurs noirs. La brigade Dirlewanger, Paris, Perrin, 2006.
[22] Mary Beard, The Roman Triumph, Cambridge Mass., Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.
[23] Jean-Pierre Vernant, L’individu, la mort, l’amour. Soi-même et l’autre en Grèce ancienne, Paris, Gallimard, 1989.
[24] Nancy Sherman, Stoic Warriors. The Ancient Philosophy behind the Military Mind, Oxford, Oxford University Press, 2005.
[25] Susan Grayzel, At Home and Under Fire : Air Raids and Culture in Britain from the Great War to the Blitz, New York, Cambridge University Press, 2012.
[26] Pascal Payen, Les revers de la guerre en Grèce ancienne. Histoire et historiographie, Paris, Belin, 2012.
Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel
Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon