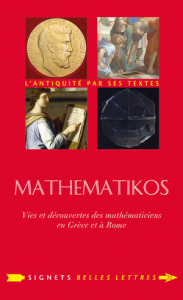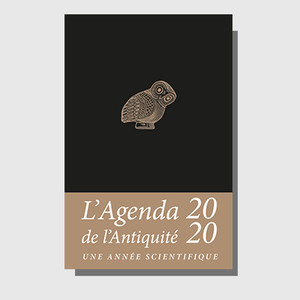Aujourd'hui, La vie des Classiques vous offre un entretien exclusif avec Antoine Houlou-Garcia, qui réalise les vidéos Arithm'Antique, récemment lauréat du prix Tangente pour son ouvrage Mathematikos. Vies et découvertes des mathématiciens en Grèce et à Rome. Il a également publié l'Agenda Belles Lettres 2020. Une année scientifique. (photographie © Édouard Thomas, magazine Tangente)
Comment vous présenter ?
J’ai trente-deux ans et vis en Italie depuis quatre ans. J'enseigne l'histoire des mathématiques grecques au sein de la Fondazione Demarchi, suis chargé de cours à l'Université de Trente en épistémologie politique, membre associé de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité. Je m’intéresse à la poésie en particulier et la littérature en général, aux mathématiques et leur histoire, et à la théorie politique.
Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre formation ?
Mes parents tout d’abord qui m’ont toujours ouvert à la culture et au savoir. Mon épouse qui m’a notamment offert la possibilité, en vivant en Italie, de consacrer un temps immense à la recherche et à l’écriture. Certains enseignants ont eu un impact déterminant : mon professeur de mathématiques spéciales, Jean-François Ruaud, qui m’a appris qu’on pouvait écrire les maths ; mon directeur de thèse, Philippe Urfalino, qui m’a appris à lire lentement. Mes coauteurs et mes éditeurs qui m'ont appris à écrire comme je ne savais pas le faire.
Quelle a été votre formation intellectuelle ?
Après des études orientées vers les mathématiques et les statistiques, en classes préparatoires puis à l’ENSAI (Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique), j’ai travaillé plusieurs années à l’Insee. J’ai repris un parcours universitaire en faisant un master à l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) et suis à présent en train de finir ma thèse sur l’usage des mathématiques en théorie politique.
Quel a été le premier texte latin et grec que vous avez traduit/lu ? Quel souvenir en gardez-vous ?
En latin, le début du De viris de Lhomond ; en grec, le début du très classique ἕρμαιον. J’en garde des souvenirs très enthousiastes, très affamés de connaître la prochaine déclinaison et de lire des textes toujours plus compliqués.
Pourquoi avoir choisi les maths, comment est née la passion ? Et comment avez-vous « entretenu la flamme » ?
Assez jeune, je me suis intéressé aux mathématiques comme on peut se prendre de passion pour un jeu : chaque nouveau théorème, chaque nouveau problème me donnait l’impression de grandir et d’être un peu plus que moi-même. C’est en autodidacte que j’en suis venu à l’histoire des mathématiques que je considère comme une histoire de la pensée humaine et de l’une de ses manières d’exprimer son génie.
Aujourd’hui, je ne fais plus de problèmes de maths comme on en fait lorsqu’on prépare des concours, mais je refais les démonstrations d’Archimède et de Diophante, en suivant leur raisonnement puis en le refaisant seul papier et crayon en main, pour m’émerveiller à chaque fois de leurs intuitions géniales.
Qu’est-ce qui pourrait vous faire baisser les bras ?
Le découragement n’existe qu’en fonction de la fin qu’on se donne. Si l’on vise le succès, le découragement menace toujours. Pour ma part, je ne souhaite que pouvoir continuer à faire ce qui me plaît : apprendre et écrire. A priori, je ne devrais donc pas me décourager.
Aimer les maths et les lettres/langues anciennes, c’est paradoxal, non ?
Ça l’est devenu dans une société qui les oppose artificiellement mais en réalité les antiquisants qui n’ont jamais lu le moindre texte d’Archimède ou de Boèce abandonnent un pan entier de ce qui devrait être de leur compétence, de même que les « matheux » qui n’ont jamais lu ces mêmes auteurs et n’ont fait que lire les transformations contemporaines de leurs résultats délaissent un champ immense de leur métier. Nos mathématiques actuelles étant directement issues d’œuvres écrites en grec et en latin, il est assez logique de réconcilier ces deux sphères que rien n’oppose. En réalité, il faudrait aussi, pour être bon mathématicien (c’est-à-dire non seulement être bon techniquement mais surtout avoir une philosophie des mathématiques un tant soit peu développée), apprendre l’arabe pour pouvoir comprendre leur cheminement historique, ainsi que le chinois et le sanskrit pour approcher d’autres manières de faire des mathématiques. Pas nécessairement être parfaitement bilingue dans chacune de ces langues, mais avoir une capacité minimale (pour lire Euclide par exemple qui écrit dans une langue assez simple).
Pourquoi sont-elles toujours présentées comme antithétiques ?
Le titre de l’ouvrage de Snow, The two Cultures, résume bien le problème : on considère depuis (grosso modo) le dix-neuvième siècle que les humanités sont distinctes des disciplines scientifiques. A l’époque victorienne, dans le système éducatif anglais, les humanités représentaient le vrai savoir destiné à l’élite tandis que les sciences étaient considérées comme plus veules parce que tournées vers l’application. Aujourd’hui, c’est l’inverse : les sciences, en particulier les mathématiques, sont vues comme la clé pour aire les études les plus brillantes et obtenir les métiers les mieux rémunérés. Dans ces deux raisonnements, on se trompe sans doute en confondant le plaisir d’apprendre des choses inutiles et valoriser des connaissances dans un but utilitaire (au sens positif du terme). Apprendre le latin et le grec est inutile parce qu’on peut tout lire en traduction ; apprendre les mathématiques est inutile parce qu’on peut demander à l’ordinateur de faire les calculs. Mais apprendre le latin et le grec, tout comme les mathématiques, sert surtout à s’éveiller à une façon de penser et de dire le monde. Cela peut avoir une conséquence pratique très positive puisqu’on peut en faire son métier, mais ce n’est pas le but premier de l’enseignement.
Peut-on les réconcilier ?
On le doit, mais cela passe par une réflexion plus générale sur l’enseignement : veut-on que les élèves deviennent des citoyens responsables, des adultes cultivés, une future main d’œuvre ? Ou veut-on simplement que le système éducatif serve de tamis pour repérer le 1% de la future élite du pays ? Tous ces buts ne sont pas nécessairement antinomiques, mais il faut au moins être au clair sur le but à donner à l’enseignement pour tenter, éventuellement, de mettre en cohérence toutes ces fins. Si l’on souhaite que les élèves nourrissent le marché du travail, alors le latin, le grec et les mathématiques sont à proscrire parce qu’il s’agit de matières qui n’ont aucun intérêt économique direct. Si l’on souhaite repérer une élite, alors ils sont très utiles mais utilisés d’une manière qui n’est sans doute pas très pertinente : on ne se passionne souvent pas pour ce qui n’est qu’un instrument de distinction sociale. Si l’on veut former de futurs citoyens et de futurs adultes, alors ce sont des matières qui ont un rôle de premier plan à jouer.
Votre ouvrage Mathématikos (2019, Les Belles Lettres) présentent les mathématiques et les mathématiciens de l’Antiquité : les grecs ont-ils dans ce domaine aussi « tout inventé » ? Se sont-ils trompés ?
Les Grecs n’ont pas tout inventé et le reconnaissaient volontiers : jamais Thalès ou Pythagore n’auraient donné leur nom à leurs théorèmes car ils savaient bien qu’ils les avaient eux-mêmes appris en Egypte et à Babylone. Les Grecs ont toujours beaucoup plus reconnu leur dette envers les autres civilisations qu’on ne le fait aujourd’hui, sans doute pour nous créer une filiation directe avec notre conception quasi mythologique de la Grèce antique qui n’a d’intérêt que de nous flatter.
En mathématiques, ils se sont souvent trompés – comme toute personne qui tente quelque chose, Euler lui-même s’est souvent trompé dans ses conjectures – comme sur l’exemple le plus célèbre : le cinquième postulat d’Euclide, que bien des mathématiciens antiques ont cru démontrer (Ptolémée, Proclus…). Mais ces « erreurs » font partie du cheminement normal de la science. Seule la religion ne se trompe pas ; la science avance en trébuchant.
Quel est le statut des maths dans l’Antiquité ? Est-elle un instrument de sélection comme elles le sont dans nos sociétés contemporaines ?
Les mathématiques de l’Antiquité sont regroupées dans ce que l’on appelle le Quadrivium : ces quatre disciplines que sont l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie et la musique (opposées au Trivium de la rhétorique, de la dialectique et de la grammaire). Astronomie et musique font ainsi partie des mathématiques : l’Almageste de Ptolémée commence par des propriétés de géométrie et la théorie musicale était fondée uniquement sur des calculs de proportion (la gamme pythagoricienne, par exemple, est fondée uniquement sur le rapport 3/2 qui correspond à la quinte).
L’ensemble Quadrivium – Trivium (les sept arts libéraux) n’était pas une fin en soi mais avait pour but de nourrir la science la plus importante : la philosophie. Les mathématiques n’étaient donc pas du tout considérées comme elles le sont aujourd’hui mais comme un instrument vers le savoir absolu. Elles n’avaient ainsi aucun rôle de sélection comparable à notre époque.
Les mathématiques ont fait un bon considérable depuis le XXe siècle, comment les mathématiciens d’aujourd’hui voient-ils les mathématiciens de l’Antiquité ?
Ils les voient peu : ils les lisent très rarement si ce n’est jamais et les considèrent au mieux comme de lointains précurseurs. C’est un point que développe avec talent Lucio Russo dans un livre que j’ai eu le plaisir de traduire et qui paraîtra aux Belles Lettres en janvier sous le titre Notre culture scientifique. Le monde antique en héritage.
Votre ouvrage Mathématikos a reçu le prix Tangente du meilleur livre de vulgarisation scientifique : qu’est-ce que c’est, la vulgarisation ?
C’est le difficile défi de rendre compréhensibles des choses compliquées sans pour autant trahir leur complexité ni leur rigueur inhérente. Mon expérience la plus difficile et qui fut aussi l’une des plus satisfaisantes fut de rendre compréhensible à des adolescents un entretien avec Claire Voisin, membre de l'Académie des sciences et titulaire de la chaire « géométrie algébrique » au Collège de France. Les réponses passionnantes de Claire Voisin étaient d’un niveau à peu près compréhensible pour un très bon étudiant en fin de classes préparatoires, mais certainement pas pour les adolescents qui lisent le magazine Cosinus, auquel je contribue régulièrement. J’ai donc dû trouver des métaphores, des images pour rendre accessibles des concepts difficiles de géométrie algébrique à de jeunes lecteurs qui ne possèdent pas une grande technique mathématique mais qui ont en revanche une forte capacité d’imagination.
Vidéo, livre, conférence et aujourd’hui vous publiez un agenda sur les sciences : quel est votre support préféré ? Pourquoi ?
Je me suis beaucoup amusé à faire l’Agenda Belles Lettres 2020 autour du thème de la science antique : il fallait trouver des textes très brefs à contenu intéressant et surprenant pour les lecteurs. C’est un peu comme dans les vidéos où j’essaye de proposer des angles inédits. Dans les conférences que je suis amené à faire, j’ai plus de temps pour creuser un point particulier, parfois complexe, surtout dans les interventions universitaires. C’est une chose très enthousiasmante à faire parce que cela permet de proposer une réflexion encore en cheminement à des personnes capables de vous faire douter et progresser. C’est sans doute le format le plus plaisant, bien que les livres apportent évidemment une satisfaction plus durable.
Que pensez-vous de l’enseignement des maths en France ? La culture et l’histoire des mathématiques y ont-elles leur place ?
Je pense que l’enseignement des mathématiques en France – mais également dans beaucoup d’autres pays – est catastrophique et permet seulement aux élèves déjà bons en maths de les apprécier. L’entretien avec Olivier Peyon, en ouverture de Mathematikos, en brosse un tableau qui n’est pas brillant. Les mathématiques sont trop souvent enseignées comme une vérité absolue à laquelle il faut adhérer, faute de quoi on est idiot. Si l’on enseignait plus l’histoire des mathématiques – non pas au sens de connaître un ou deux noms de mathématiciens mais en montrant le tâtonnement des mathématiciens – on pourrait peut-être en partie vaincre ce sentiment de météore froid qui caractérise les mathématiques. Si l’on montrait également la beauté des mathématiques, on éveillerait la curiosité de bien des élèves car, contrairement à une idée reçue, il ne faut pas avoir un doctorat en mathématiques pour en percevoir la beauté : la décomposition des carrés et des cubes en suites de nombres impairs est une chose qu’un collégien peut comprendre et apprécier (1²=1 ; 2²=1+3 ; 3²=1+3+5 ; 4²=1+3+5+7 etc.). Pour donner encore plus d’intérêt à ces résultats, il suffirait d’expliquer qu’ils ont été établis dans le cadre de la pensée pythagoricienne qui se penchait sur le sens magique des nombres.
La situation des mathématiques en France est-elle différente des autres pays européens ?
Je ne peux témoigner que pour l’Italie où la seule différence est qu’on y a une approche plus géométrique de la géométrie là où en France on a une approche analytique et algébrique. Par exemple, en Italie, on apprend la définition géométrique de la parabole avant d’en apprendre l’équation, ce qui est une très bonne chose pour mieux saisir l’essence de ce type de courbe.
A quoi ressemble votre bibliothèque ?
Une bonne moitié provient des Belles Lettres, avec les textes scientifiques anciens et médiévaux (d'Archimède à Al-Tusi) mais aussi des traités récents sur la science ancienne (sur la gnomonique par exemple), mais aussi de nombreux textes littéraires de la collection chinoise et de la collection allemande notamment. Le reste, hors Belles Lettres, est constitué majoritairement de poésie. Quant à la bibliothèque de mon ordinateur, elle est faite essentiellement d’articles de recherche en théorie politique et en histoire des sciences.
Quelle est la part de l’Antiquité ?
Prépondérante, par goût et par métier.
Qui est votre mathématicien préféré ? Pourquoi ?
Archimède pour son génie, son instinct, ses démonstrations où il ne s’embarrasse pas d’une rédaction précise comme celle d’Euclide parce qu’il estime que son lecteur comprendra de lui-même, sa capacité à comprendre qu’il ne fallait pas chercher une valeur exacte de π mais une approximation, le fait qu’il démontre tout en géomètre, y compris ses résultats en physique et en hydrostatique, et parce que ce qu’on connaît de lui lorsqu’on ne sait rien de ses œuvres ne représente qu’une partie infime de ses découvertes.
Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel
Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon