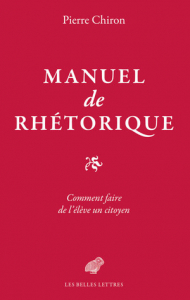Pierre Chiron, helléniste, philologue, historien de la rhétorique, est professeur à l’Université Paris-Est, membre de l’Institut universitaire de France et romancier. A l’occasion de la sortie de son petit Manuel de rhétorique, il offre à La Vie des Classiques un entretien exclusif.
- Comment vous présenter ?
Eh bien c’est tout simple… et un peu compliqué en même temps : je finis ma carrière de professeur de langue et littérature grecques à l’Université Paris-Est Créteil. Mais depuis dix ans, j’appartiens aussi à l’Institut Universitaire de France, établissement sans murs, qui m’a permis, sans quitter l’enseignement, et notamment les séminaires de Master et la direction de thèses, de me concentrer davantage sur la recherche. Je suis également, pour un an, président de l’Association des Études grecques, une association ancienne mais toujours bien vivante, qui s’efforce d’encourager la pratique de cette langue. Nous recrutons chaque mois de nouveaux membres et l’intérêt pour cette culture ne se dément pas : la tragédie, la philosophie, l’histoire des sciences, la médecine notamment, la rhétorique, la démocratie et j’en passe, sont autant de domaines de l’art et de la pensée qui doivent beaucoup à la Grèce ancienne. Le problème – et j’en parle en tant qu’ancien président de la 8e section du CNU, chargée des recrutements et des carrières universitaires dans ce domaine – c’est plutôt la politique universitaire, qui n’a pas encore, malgré des prises de conscience récentes, pris en compte à la fois l’importance et la fragilité de ce patrimoine, qui mériteraient que soient sanctuarisés, en quelque sorte, un certain nombre de postes dans l’enseignement supérieur. Sans ces perspectives d’avenir, le risque est grand que des jeunes gens passionnés et brillants se détournent à tout jamais d’études qui, à mes yeux, sont à la fois passionnantes et utiles à la collectivité, si cette dernière veut savoir d’où elle vient et ce qu’elle est.
Une autre de mes « casquettes » est celle de vice-président d’une association internationale, la SIBC, Société Internationale de Bibliographie Classique, qui veille à alimenter une base de données bibliographiques sur l’Antiquité, accessible en format papier et en ligne. Cette entreprise, d’origine française, est maintenant pleinement internationale. C’est un travail sans fin que d’assurer la production et la diffusion de notices permettant d’informer les Antiquisants, en temps réel, des avancées de la recherche dans les domaines qui les intéressent.
2) Quel a été votre parcours ? Quelles ont été les rencontres (de chair ou de papier) déterminantes?
Mon parcours a été celui d’un helléniste de ma génération : les études de lettres, les concours, notamment l’agrégation, et puis la thèse et l’Habilitation à Diriger des Recherches. Plus originales, les quatre années que j’ai passées comme « caïman » à l’ENS-Ulm, qui m’ont permis de passer de la thèse à l’HDR, et de devenir professeur sans passer par la case « maître de conférences ».
Sur le plan de l’enseignement, j’ai beaucoup appris comme professeur au Lycée Marie Curie de Sceaux, qui m’a permis de me frotter à des intelligences juvéniles non encore engagées dans un domaine précis. J’ai des souvenirs merveilleux de classes scientifiques, a priori peu attirées par les lettres, et pourtant enthousiasmées par les beaux textes, de Ronsard à Jean-Paul Sartre. Évidemment, à l’ENS, j’ai rencontré des jeunes gens extraordinaires, dont ceux qui ont fait leur thèse avec moi, comme Frédérique Woerther et Charles Guérin, et qui sont maintenant des collègues et des amis.
Du côté des maîtres, je veux mentionner Germaine Aujac, qui a dirigé ma thèse de troisième cycle, Jean Irigoin, un philologue de très haute volée, que je me plais à saluer comme « mon » maître. Michel Patillon, l’un de ceux qui ont le plus profondément transformé le champ des études rhétoriques au niveau non seulement français, mais mondial. Je joue le modeste rôle de réviseur des éditions qu’il publie à jet continu dans la Collection Budé. Il exploite un gisement d’une richesse inouïe.
Parmi mes contemporains ou quasi-contemporains, j’ai eu la chance de rencontrer, et de travailler avec des collègues brillantissimes comme Philippe Hoffmann, Carlos Lévy ou Christian Jacob. En Allemagne Manfred Kraus, au Royaume-Uni Michael Edwards, en Italie Lucia Calboli Montefusco.
Pour les rencontres de papier, sans être véritablement relié à l’« Ecole de Paris », car ma formation est celle, plus traditionnelle, d’un philologue, je voue une admiration sans borne à Jean-Pierre Vernant. Son « Les origines de la pensée grecque », que j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de présenter à des étudiants, demeure un stimulant incroyable, dans ses faiblesses mêmes. Pour la rhétorique, je pourrais mentionner Perelman, Toulmin, et bien d’autres.
3) Quel est le premier texte grec que vous avez traduit? Quelles ont été vos impressions? Et en latin?
En grec, au Lycée, mes premiers émois véritables – je ne parle pas des premiers mots ni des premières phrases abordées dans une perspective grammaticale – ont été Homère et Démosthène, la grâce et l’énergie. En tant que philologue, j’ai consacré ma première thèse à un petit traité d’Euclide, qui posait des problèmes d’ordre scientifique. Ma première « vraie » traduction, au sens où il s’agissait d’un texte beaucoup plus riche sur le plan littéraire, a été celle du traité « Du Style » du Ps.-Démétrios de Phalère, que j’ai ensuite édité dans la collection Budé. Un texte apparemment très technique – qui analyse les caractères stylistiques et leur affecte un certain nombre de procédés à imiter – mais où l’on détecte sans trop de mal une pédagogie extraordinairement vivante, attentive à donner à l’élève les moyens d’impressionner son auditeur ou son lecteur, de le séduire, de lui communiquer des images mentales et les émotions qui vont avec, ou de lui imposer son autorité. J’y ai éprouvé, dans la pratique, les difficultés de la traduction, exercice permanent de « décentrement ». Il s’agit de penser depuis un autre point de vue, de jouer si possible le même air avec un autre instrument. J’adhère pleinement aux valeurs qu’affecte Barbara Cassin à cet exercice, où elle voit la langue de l’Europe. Le mot civilisation paraît dangereux à certains. On peut en abuser, c’est certain, et s’en servir pour exclure. Mais je pense profondément que la traduction est un exercice civilisateur.
En latin, je me souviens avec bonheur de l’époque où je passais l’agrégation et où je lisais l’Énéide presque aussi facilement qu’Homère. Tacite, aussi, m’a fortement impressionné, par une sorte de froideur lucide. Autre bonheur : le De viris illustribus, adaptation scolaire, certes, mais exigeante, des bons historiens de Rome. La liste n’est pas close. La latinité a fourni l’un des plus grands professeurs qui soient, Quintilien.
4) Entre la langue grecque et vous, c’est un mariage de passion ou de raison?
Et si le logos – terme grec dont l’acception réunit le langage, avec toutes ses ressources, et la raison discursive – faisait échapper à l’alternative ? Je ne choisis pas. J’aime dans le grec la clarté, la rigueur, mais cette clarté est solaire, indissociable des sensations et des émotions, du désespoir d’Antigone quand elle doit renoncer à l’astre du jour. Je déteste les philosophes qui croient pouvoir se passer du langage, les spiritualistes qui croient pouvoir se passer de leur corps. La philosophie est un effort, une aspiration, mais qui n’est jamais coupée du pas de tir d’où elle a commencé à s’élever. Un des avertissements les plus forts de Pascal est : « qui veut faire l’ange fait la bête ». On en a vu l’illustration récemment avec ces jeunes gens, criminels imbéciles, qui impliquaient Allah dans l’assassinat de dessinateurs coupables à leurs yeux de penser librement. Quelle théologie peut-il y avoir derrière un acte pareil ? La bêtise, l’ignorance de soi, la brutalité, requièrent comme antidote la capacité de se parler à soi-même et ainsi, peu à peu, de se connaître, de se construire comme être humain, pétri de passion et de raison s’équilibrant l’une l’autre.
5) Vous avez un nom quasi prédestiné pour un professeur de grec, mais si la vie avait été autre, quel métier auriez-vous voulu exercer?
Ma mère était institutrice dans un bourg de campagne, et mon patronyme, en cas de punition mal vécue, a parfois donné lieu à des variantes, disons… scatologiques. Il réfère, en réalité, à des parcelles de terrain rendues inexploitables par la présence d’une grosse pierre. Un chiron, ou un chirac, c’est un gros caillou et, par métonymie, le terrain où il se trouve. Mais évidemment, c’est aussi un personnage de la mythologie… mi ange, mi bête. Vous voyez, on y revient. Comme centaure, il représente la bestialité dans l’homme, mais, fort heureusement, il fut le seul à échapper à son destin et à se faire l’éducateur des héros. Il a choisi de renoncer à l’immortalité. Oui, c’est une figure intéressante et inspirante.
Pour en revenir à votre question, si je n’avais pas été professeur de grec – choix que je dois, en réalité, à une série de professeurs de lettres extraordinaires rencontrés depuis la sixième jusqu’à la première – je crois que j’aurais été cuisinier, et que j’aurais travaillé ce lien dynamique qui mène de la chair à l’esprit. Chez moi, la cuisine est mon domaine, et ma fille a collé récemment sur la porte une pancarte ainsi libellée : « Chez papa ».
6) Vous publiez ces jours-ci un « Manuel de rhétorique. Comment faire de l’élève un citoyen »: le titre est alléchant mais de quoi s’agit-il?
C’est un petit livre, mais au fond très ambitieux. Mon point de départ est la crise très profonde que vit actuellement l’enseignement des Lettres, crise qui affecte en réalité l’éducation dans son ensemble, parce qu’elle se manifeste chez beaucoup de jeunes par une maîtrise de l’écrit – mais aussi de l’oral – très limitée, très limitante, par des lacunes dans le vocabulaire, etc. qui compromettent l’avenir professionnel et culturel de beaucoup d’entre eux, justement ceux qui auraient besoin d’un soutien dans ces domaines. Deux nouveautés ont profondément affecté cet enseignement des lettres : la massification, qui date déjà d’une cinquantaine d’années, et qui n’a pas été maîtrisée. Seconde mutation : les Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication, qui ont fait disparaître presque complètement la pratique de la lecture – en tout cas de textes longs et élaborés – et soumis les enfants sans défense à la culture industrielle. Le résultat est que l’égalité des chances a régressé. Sans vouloir être catastrophiste, il y a de quoi être inquiet quand on lit des études sur le temps énorme passé devant des écrans par les enfants et les adolescents. Or les contenus véhiculés sur ces écrans sont dictés par une logique commerciale. Ce que Platon reprochait déjà à la rhétorique – accusée de ne dire aux gens que ce qu’ils voulaient bien entendre, et d’être incapable d’enseigner aucune vérité –, on peut l’imputer bien davantage aux NTIC : les algorithmes ne vous nourrissent que des informations que vous avez déjà cherchées, vous enfermant dans un univers d’opinions complètement fermé.
Je décris dans mon petit ouvrage ce qui pourrait bien être un antidote à cette aliénation. Une série d’exercices, mis au point dans la période hellénistique, et pratiqués dans les écoles jusqu’au 19e siècle européen, et qui enseigne aux adolescents toutes les formes discursives dont on a besoin pour maîtriser les échanges personnels et sociaux. Cet enseignement est actif, et non passif. Il est égalitaire : parmi ses promoteurs, il y a eu les réformateurs, soucieux de promouvoir l’égalité face à l’establishment catholique. C’est un enseignement progressif, qui mène des formes les plus ludiques et les plus simples comme la fable jusqu’aux plus complexes comme la thèse. L’azimuth de la série n’est autre que la proposition de loi, qui atteste le caractère politique – démocratique – de l’entreprise. Le citoyen accompli est celui qui sait promouvoir et faire accepter des règles de vies communes. C’est enfin un enseignement intégré, qui perfectionne des compétences complémentaires et qui se consolident entre elles : les compétences linguistiques, les compétences littéraires ou expressives, et enfin les compétences argumentatives.
7) D’où est née l’idée de ce livre?
L’origine de ce livre se trouve dans mes recherches d’historien des textes rhétoriques. Les exercices en question s’appellent en grec progymnasmata. Les plus anciens traités qui les décrivent sont édités et traduits depuis peu – Michel Patillon, dont je parlais tout à l’heure, a fait beaucoup dans ce domaine. Bref, ce petit livre est né de la conjonction entre une crise contemporaine et des découvertes philologiques récentes. Sur le plan scientifique, je prépare avec un jeune collègue de l’université libre de Bruxelles, Benoit Sans, l’édition des Actes d’un colloque qui a eu lieu à Créteil en janvier dernier, et qui était axé justement sur les récentes découvertes faites sur l’histoire de ces exercices et de leur mise en pratique, depuis l’antiquité et les sources papyrologiques jusqu’à la Suède ou les USA, la Suisse ou la France d’aujourd’hui.
8) A qui s’adresse-t-il? A quoi sert-il?
Ce petit livre s’adresse au grand public cultivé, mais aussi plus spécialement aux enseignants, et je suis sûr qu’il peut intéresser des adolescents. J’espère même qu’il sera lu par quelques politiques. J’y parle de la reprise par Donald Trump de thèmes de la propagande nazie, j’y décris dans le détail comment jouer avec ces exercices. Chacun, je crois, peut y trouver assez de matériau pour construire sa propre pratique. Il s’agit de fluidifier, d’enrichir et de structurer les échanges verbaux. Ce n’est pas rien.
9) Le livre propose une série d’exercices à pratiquer: pourriez - vous en développer un ou deux ?
Je pourrais évoquer la fable, à cause du large éventail de compétences qu’elle développe : la narration, la construction de caractères, le dialogue, les relais de parole, l’énonciation de type gnomique, celle qui donne une forme aisément mémorisable à des généralités, etc. mais j’évoquerai plutôt la paraphrase. C’était un exercice, pratiqué quotidiennement, de reformulation. L’objectif était d’apprendre à l’élève comment une pensée peut rester la même par-delà les variations de son expression. Ces manipulations n’étaient pas faites au petit bonheur la chance. On enseignait les modes principaux de la paraphrase, qui consistaient à ajouter, à enlever, à permuter ou à changer les termes. C’est un exercice de rigueur en fait, et d’ouverture à l’autre. Combien de gens se disputent alors qu’ils pensent la même chose !
Un autre exercice très enrichissant était l’éthopée, tous sont passionnants.
10) L’ouvrage mentionne aussi les découvertes récentes des neuro-sciences : la rhétorique permet de développer le cerveau? La rhétorique c’est plus efficace que le sudoku?
Que l’exercice intellectuel soit bon pour le cerveau n’est plus à démontrer. Entre une personne cultivée et une personne inculte, pour la même atteinte de la maladie d’Alzheimer, il y a jusqu’à dix ans d’écart dans la gravité du handicap. Le cerveau cultivé trouve des stratégies de rechange et pallie plus longtemps les conséquences de l’atteinte neurologique. Mais pour ce qui nous intéresse, la validation de l’efficacité des progymnasmata (les progyms, comme les appelle un collègue américain) par la neuro-pédagogie n’en est qu’à ses débuts. Dans les actes du colloque dont nous préparons l’édition avec Benoît Sans, il y aura une étude pionnière dans ce domaine. Ce que l’on peut dire tout de suite, ce sont trois choses : le caractère actif de cet enseignement est un atout considérable. On apprend bien plus et bien mieux quand on est acteur de sa formation. Deuxièmement, la conjonction de la rationalité et des affects est un auxiliaire très efficace de la mémoire. Quand vous apprenez, dans le cadre de l’exercice d’éthopée, à faire parler un personnage doté d’un idiolecte, c’est-à-dire d’un mode d’expression typé, lié à son âge, à sa catégorie sociale, etc. – un personnage de la mythologie, par exemple, ou de la culture contemporaine, comme Mowgli ou le professeur Dumbledore – dans une circonstance particulièrement dramatique – Mowgli entre les griffes de Shere Khan lui demandant le vie sauve, par exemple – vous combinez l’argument et l’intensité des émotions, et les deux se renforcent et s’impriment profondément. Troisièmement, cette éducation antique recourt aux algorithmes, mais de manière active, et non passive, ce qui permet de compenser, par la stimulation de la zone frontale, l’effet nocif de mécanismes irréfléchis.
11) Ces exercices avaient une portée politique dans l’Antiquité? Pourraient-ils en avoir une aujourd’hui ?
Naturellement. La rhétorique grecque est née avec la démocratie. Elle fournit un soutien technique à ce qui fait la définition même de la démocratie : la verbalisation des interactions et des conflits sociaux. La substitution de l’argumentation à la domination physique et à la violence. Pour ce qui est de l’actualité de ces exercices, elle est proportionnelle à notre attachement à la démocratie. Ma conviction est que si nous voulons la démocratie, nous devons savoir former des citoyens. C’est un travail, c’est même une sorte d’ascèse. Nous ne sommes pas naturellement enclins à préférer l’intérêt collectif à notre intérêt particulier. Mais qui ne voit que la solution des problèmes économiques et écologiques aujourd’hui dépend de notre aptitude à ce type de choix ? Les progymnasmata sont un dispositif qui nous enseigne à forger ensemble l’intérêt commun, au-delà de nos égoïsmes. J’irais jusqu’à dire que c’est une question de survie.
12) S’il fallait retenir une phrase de votre ouvrage, ce serait laquelle?
Dans une recension très favorable qu’il a faite de mon petit livre, où il voir un manuel de résistance,le journaliste Laurent Lemire cite cette phrase que je me permets de reprendre à nouveau : « Ciblés par des algorithmes qui ne leur proposent que ce qui conforte leurs préjugés et leurs passions, trop de jeunes gens ne reçoivent plus les armes du logos – langage et raison mêlés – et de l’esprit critique contre la paranoia du complot et des fake news ».
Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel
Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon