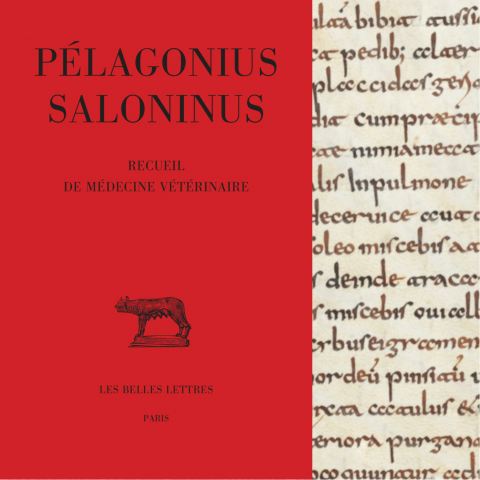
Comment les Anciens soignaient-ils leurs animaux, et en particulier les chevaux qui leur étaient de première utilité ? En lien avec le thème de Culture Antique des CPGE, « L’homme et l’animal », Valérie Gitton-Ripoll, qui a publié l’édition, la traduction et le commentaire du Recueil de médecine vétérinaire de Pélagonius Saloninus dans la Collection des Universités de France, nous fait l’honneur d’un entretien exclusif pour nous raconter la médecine vétérinaire antique.
La Vie des Classiques : Comment vous présenter ? Quelle a été votre formation intellectuelle ?
Valérie Gitton-Ripoll : Je suis maître de conférences en latin à l’Université Toulouse 2, où j’enseigne depuis 2001. J’ai fait un cursus de Lettres Classiques à l’Université de Paris IV, où j’ai passé l’agrégation de grammaire, et j’ai soutenu ma thèse de doctorat à Lyon 2, qui était un pôle d’étude des textes médicaux latins. Au début de ma carrière, j’ai été assistante à l’université de Bordeaux 3 (on dit « ATER »). Mais la formation intellectuelle ne se limite pas aux études, pour les chercheurs : en plus de mon enseignement, j’ai appartenu aux laboratoires de recherches Hisoma (à Lyon) et Crata (à Toulouse).
L.V.D.C. : Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre parcours ?
V.G.R. : J’ai toujours été très impressionnée par mes professeurs de latin, depuis le secondaire. – mon lycée ne proposait que le latin, pas le grec. Je leur trouvais une clarté pédagogique, une culture et une curiosité intellectuelle que je n’avais pas l’impression de rencontrer ailleurs. En hypokhâgne, j’ai eu un excellent professeur pour commencer le grec (Danielle Jouanna), qui nous a fait presque rattraper le niveau de ceux qui avaient commencé plus jeunes. Mais le plus important, à ce moment-là, était la complicité entre camarades, qui partagions la même passion : traduire des textes anciens et étudier l’Antiquité, et nous nous soutenions mutuellement dans les moments difficiles (interrogations orales sur les verbes irréguliers grecs). Ensuite, à l’université, j’hésitais entre plusieurs sujets qui tous me plaisaient : la linguistique latine et comparée, l’étude des mythes (et surtout de la mythologie comparée), l’étruscologie… Mais la révélation est venue des cours de linguistique latine (cours de M. Baratin, F. Biville, J. Dangel, M. Fruyt, Cl. Moussy, P. Flobert…), qui m’ont fascinée, parce que j’y trouvais une explication logique de tous les phénomènes de la langue, tant sur le plan phonétique que morphologique ou sémantique, et un dépassement du clivage que j’avais connu jusque là : bon/mauvais usage de la langue ; en réalité tout s’expliquait, et tout avait une logique, y compris le latin dit vulgaire. J’aurais pu faire de la linguistique pure ; mais j’ai finalement opté pour une voie médiane, l’étude des textes « scientifiques » latins, qui est une sorte de linguistique appliquée. C’est ce qu’on appelle aussi la philologie, que j’entends comme la linguistique au service de l’étude des textes.
L.V.D.C. : Comment est née votre passion des langues anciennes, et notamment du latin ? Et comment avez-vous « entretenu la flamme » ?
V.G.R. : Au début, ce n’était pas encore la langue qui me fascinait, mais l’idée que par la connaissance de cette langue on pouvait accéder à la pensée de gens qui avaient vécu deux mille ans avant nous : on pouvait restituer d’après leurs textes les traces d’un monde tout à fait différent du nôtre, très dépaysant, dépourvu certes de technologie avancée, mais qui semblait très proche de nous sur le plan humain. L’aspect « décryptage » auquel peut s’apparenter la traduction du latin au début des études me plaisait aussi : en appliquant les règles qui nous étaient données, on pouvait logiquement réussir à traduire une phrase dont le fonctionnement était tout à fait différent de celui du français.
Pour ce qui est d’entretenir la flamme, une fois qu’on enseigne, ce n’est pas difficile : la supplication muette (et parfois explicite) des étudiants désireux d’apprendre quelque chose est le plus puissant moteur de l’effort pédagogique et du dépassement de ses propres compétences : c’est un métier où l’on doit sans cesse remettre ses connaissances à jour, pour anticiper les futures questions.
L.V.D.C. : Quel a été le premier texte latin et/ou grec que vous avez traduit/lu ? Quel souvenir en gardez-vous ?
V.G.R. : Le premier texte que j’ai traduit en continu, c’était le De signis de Cicéron, en seconde. J’ai un très mauvais souvenir de la description interminable du candélabre d’Antiochus, que je n’ai jamais donné ensuite en version aux étudiants. J’ai ensuite lu l’Énéide de Virgile, et j’avais été très impressionnée par la crudité des descriptions guerrières. Heureusement, il y avait aussi Ovide au programme de troisième, dont l’Art d’aimer était très apprécié des adolescents que nous étions. Tout cela m’avait persuadée qu’il y avait dans la littérature latine à la fois une originalité fondamentale et une humanité profonde qui parlait à tous, quel que soit le siècle, parce qu’elle savait exprimer les ressorts de l’âme humaine, et mettre en valeur ceux qui étaient positifs. Et puis ce qui me plaisait surtout, c’est que c’étaient des gens qui savaient rigoler. J’ai découvert Aristophane au lycée, et j’ai été enthousiasmée par la liberté de ton et les jeux de mots – dans la traduction, parce je ne savais pas encore le grec.
L.V.D.C. : Les antiquisants en herbe pratiquent souvent l’exercice formateur du « petit latin » ou du « petit grec ». L’avez-vous également pratiqué, et/ou le pratiquez-vous encore ? Quels auteurs vous ont accompagnée ?
V.G.R. : C’est vrai que c’est un exercice qui est recommandé dans les études supérieures. Toute la difficulté est de trouver des auteurs suffisamment faciles à lire pour que l’exercice ne dure pas trop longtemps et soit un peu satisfaisant au niveau de l’amour propre (réussir à traduire assez rapidement sans trop d’aide). À l’époque, la collection des Classiques en poche, qui est très appropriée à cet exercice parce qu’elle est moins chère et facile à transporter partout, n’existait pas encore. Quand j’étais étudiante, je me souviens d’avoir fréquenté régulièrement les librairies qui proposaient des Budés « en solde », et c’est ainsi que j’ai démarré ma collection : évidemment on ne pouvait pas choisir l’auteur, il fallait évaluer le ratio coût financier / utilité de l’auteur, avec quelques surprises : il y avait encore en circulation à cette époque des Budés sans traduction, ou de vieilles éditions périmées parce que refaites. Mais la vérité est que j’ai passé plus de temps à traduire les auteurs des programmes qu’à faire du petit latin. J’ai fait du petit latin sur les auteurs du programme, si vous préférez.
L.V.D.C. : Parmi les très nombreux textes qui composent la littérature antique nous sont parvenues de œuvres dites « techniques » ou « scientifiques », en grec comme en latin : en quoi sont-elles différentes des œuvres dites « littéraires » ? ont-elles des caractéristiques propres ?
V.G.R. : Je vous dirais bien dans un premier temps que ces œuvres visent une utilité pratique, qu’elles sont des manuels destinés à mettre en application une technique dans un domaine précis : par exemple, une grande partie de l’Histoire Naturelle de Pline porte sur les remèdes simples tirés des plantes, des animaux, des minéraux, faciles à se procurer et à préparer sans recourir à un médecin. Pline s’adresse aux Romains lettrés, qui veulent éviter les dépenses et les errements de la médecine grecque (c’est lui qui le dit dans le livre 29). Il en est de même des traités agricoles de Caton, Varron ou Columelle : ils entendent aider le propriétaire à mieux faire valoir ses domaines, et s’inscrivent dans un souci de restauration de l’agriculture italienne, à laquelle les propriétaires n’accordent pas assez de soin, disent-ils. On y apprend donc où, quand et comment planter quelles espèces, ainsi que les soins à porter aux troupeaux.
Mais dans un deuxième temps, ces textes ne se distinguent pas foncièrement des textes dits littéraires : la distinction littéraire / scientifique est une distinction moderne. Les lecteurs sont les mêmes, les techniques d’écriture sont les mêmes (on peut aussi analyser les procédés rhétoriques mis en œuvre par ces traités), on y trouve de l’humour (chez Varron notamment), les auteurs ne sont pas forcément des spécialistes et peuvent avoir composé aussi des œuvres qualifiées par nous de littéraires (Sénèque a écrit sur les Questions naturelles, Varron sur de multiples autres sujets). Le mot qu’ils utilisaient est non pas scientia mais ars, et cela désigne les règles qui fondent une discipline et la façon de mettre en œuvre cette discipline ; le mot vaut autant pour l’art oratoire que pour l’art de la médecine, mais les traités de Cicéron sur l’éloquence sont classés dans la littérature. La différence est que l’art médical, l’architecture ou l’agronomie s’appliquent à autre chose que la langue. Nos catégories engendrent des frontières floues : comment classer la poésie didactique, par exemple, d’Hésiode (Les Travaux et les jours) à Virgile (Les Géorgiques) : s’agit-il d’une œuvre scientifique ou d’une œuvre littéraire ? Même le critère de l’utilité pratique est à relativiser : après tout, les auteurs d’épopée eux aussi visaient ce même objectif, puisque les petits enfants apprenaient à lire dans Homère parce qu’ils étaient censés y trouver tous les éléments nécessaires à la compréhension de la vie courante.
L.V.D.C. : Si nous pensons à la médecine antique, celle-ci est souvent réduite à un homme, Hippocrate, et aux écrits que lui attribue la tradition, occultant ainsi toute la part romaine et latine de cette ‘science’, ou plutôt de cet ‘art’ : est-il légitime de parler de « médecine romaine » ? des traités médicaux latins sont-ils parvenus jusqu’à nous ?
V.G.R. : Concernant la médecine, le rôle d’Hippocrate est en effet essentiel (et par ce nom on entend l’ensemble des œuvres qui lui ont été attribuées et qui présentent une certaine cohérence doctrinale et linguistique, qu’elles soient ou non de lui). Les médecins ultérieurs se positionnent en effet par rapport à lui, pour en commenter la pensée ou au contraire pour la réfuter. Il nous manque malheureusement, dans les textes médicaux grecs, ceux qui ont été écrits après Hippocrate, à l’époque alexandrine : ce sont ces textes qui ont été la source d’inspiration des auteurs romains, qui, à partir du début de l’Empire, ont entrepris de traduire cet art grec pour le mettre à disposition des patients latinophones. Ces latins sont, au premier siècle, Celse avec le De medicina ; Scribonius Largus avec les Compositiones (traduit dans la CUF) ; au IVe siècle Cassius Félix (CUF). Mais il existe encore beaucoup d’autres traités latins non encore traduits (Célius Aurélien, Marcellus Empiricus, Quintus Serenus Sammonicus, le pseudo-Pline de la Medicina Plinii, le pseudo-Apulée de l’Herbarius, ainsi que beaucoup de traductions latines tardives d’auteurs grecs).
Cette médecine latine, pour ce qui nous en reste, est moins spéculative que la médecine grecque, et tournée vers la composition des remèdes plutôt que vers la théorie médicale. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y avait pas de débats théoriques : à Rome s’affrontaient dès le début de l’Empire plusieurs sectes médicales, qui se distinguaient par les méthodes de soins et par l’analyse des causes de la maladie : les successeurs d’Hippocrate, que Celse appelle dogmatiques, s’en tenaient aux mouvements des humeurs ; les empiriques fondaient leur démarche sur l’expérience, et retenaient les remèdes à l’efficacité prouvée, sans se prononcer sur les causes ; les méthodiques, eux, nouvellement apparus à Rome au premier siècle, et ayant connu un vif succès (et combattus par Galien), estimaient que l’art médical s’apprenait en six mois et revendiquaient une méthode plus simple pour comprendre l’origine des maladies et déterminer leur traitement, qui tenait en trois points (pour faire simple moi aussi) : la maladie était causée par un resserrrement, un relâchement ou un état mixte. Leurs traitements étaient très appréciés : promenades en litière, à cheval, en mer, frictions, bains chauds, vin.
L.V.D.C. : Vous avez récemment publié, dans la C.U.F. (ed. Les Belles Lettres), l’édition, la traduction et le commentaire du Recueil de médecine vétérinaire de Pélagonius Saloninus, une première en France ! Comment est né ce projet ? Quels ont été les étapes les plus importantes de votre travail ? Avez-vous dû développer des compétences en médecine et/ou faire appel à des professionnels pour éclairer certains passages ?
V.G.R. : Cette traduction, que j’avais faite dans ma thèse de doctorat, est née de la demande de la Société d’histoire de la médecine vétérinaire de Maisons-Alfort, qui se plaignait de n’avoir pas de traduction de cet auteur (il n’en existait en effet aucune française, alors que les agronomes latins (Caton, Varron, Columelle, Palladius) ont été traduits dans la collection Nisard en 1844, et Végèce par Saboureux de la Bonneterie en 1775. Le travail me semblait intéressant et utile, mais je n’en avais pas dans un premier temps évalué toutes les difficultés. Ces textes sont en effet bien plus précis qu’on ne l’imagine, et il faut chercher la vraisemblance hippologique et médicale, en partant du principe que les maladies des chevaux antiques se retrouvent dans la pathologie des chevaux de labeur des traités modernes, jusqu’au vingtième siècle. Ensuite, le cheval a changé de fonction, et les maladies ne sont plus maintenant autant en lien avec le travail quotidien (bât qui provoque des blessures sur le cuir, excès de travail, malnutrition) ; il n’y a plus d’usage militaire du cheval depuis la fin de la grande guerre. Il m’a donc fallu travailler avec un vétérinaire, François Vallat, fin connaisseur de l’histoire de la médecine vétérinaire moderne, qui a cherché à reconnaître les maladies sous leur nom latin – et il n’y a pas forcément de rapport entre le mot latin et français : le cheval cardiacus n’est pas toujours cardiaque et le uirus est un poison, pas un virus... Pour certaines maladies, le travail avait déjà été fait par d’autres chercheurs, mais pas pour toutes, et il n’est pas sûr que toutes soient identifiables d’ailleurs : on ne sait pas encore ce qu’est exactement le coriage (coriago), une maladie du cuir qui s’accompagne d’un amaigrissement ; la léthargie (lethargus equus) est pour nous plutôt un symptôme qu’une maladie ; les douleurs du ventre (tormenta uentris) sont plutôt vagues…
L.V.D.C. : Cette œuvre s’inscrit dans toute une tradition vétérinaire, et notamment hippiatrique, gréco-romaine : quelle importance les Anciens accordaient-ils au soin des animaux, et en particulier au soin des équidés, au centre du Recueil de Pélagonius Saloninus ? Quel degré de conscience avaient-ils du bien-être animal ?
V.G.R. : Parmi les textes vétérinaires antiques qui nous sont parvenus, ce sont ceux sur les chevaux et les équidés qui sont le plus nombreux. En effet, cet animal est indispensable économiquement (armée, transport des biens et des personnes) et socialement, dans les courses de char et les spectacles de voltige équestre ; un des trois ordres de Rome, les equites, se fonde sur la possession d’un cheval et donc d’un certain niveau de revenu, puisque l’entretien de cet animal coûte cher (il faut disposer d’écuries, de pâturages, dispenser des soins car le cheval est bien plus fragile que l’âne ou la mule). Comme son dressage est long, la vie de l’animal acquiert plus de prix. Le nom du vétérinaire en latin est d’ailleurs ueterinarius sous le Haut-Empire, celui qui soigne les ‘vieux animaux’, ueterina, c’est-à-dire ceux qu’on laisse vieillir et qu’on n’abat pas jeunes pour la boucherie (pas d’hippophagie en Italie) ; plus tard, ce mot est détrôné par mulomedicus, le ‘médecin des mules’. En grec, le vétérinaire se dit hippiatros, ‘médecin des chevaux’. Les autres animaux (bovins, ovins, caprins) étaient soignés eux aussi, mais nous n’avons pas de mention d’un vétérinaire spécialisé dans ces espèces ; Varron délègue cette tâche au magister pecorum, l’esclave chargé de la gestion des troupeaux d’une uilla.
Concernant le bien-être animal, la question n’était pas envisagée de la même façon qu’aujourd’hui, et ce n’était pas une valeur en soi. Les cavaliers prenaient soin de ne pas faire souffrir ni brutaliser leur monture, c’est Xénophon qui le préconise dans l’Art équestre, non seulement pour la garder en état de servir, mais pour s’assurer de son soutien (au sens propre) dans les situations périlleuses de la guerre, où la vie du cavalier dépend aussi de sa monture. Les textes vétérinaires manifestent tout de même le souci de soigner les animaux à tout prix (même avec des remèdes très chers…), mais il n’est pas sûr que les propriétaires l’entendaient tous de cette oreille. Végèce, à la fin du IVe siècle, s’indigne contre ceux qui croient faire des économies en laissant leurs bêtes en pleine nature même l’hiver, sans aucun soin, sur l’exemple des Huns : mais les chevaux romains, dit-ils, sont habitués à un autre confort que les chevaux huns, et n’y survivent pas. Et en effet, on relève au fil des textes la présence de cheminées dans les écuries, pour les chevaux malades, de piscines pour la rééducation après des lésions tendineuses. Pourtant, paradoxalement, il n’y a pas de souci de soulager la douleur en soi : bien que les antalgiques à base de plantes aient été connus (en particulier l’opium), on soignait avant tout la maladie, et la douleur devait disparaître avec elle. Ainsi, les opérations chirugicales étaient pratiquées sans anesthésie, comme pour les hommes, et supposaient une contention très sévère, à l’aide de cordes, ou pour les plus légères d’un tord-nez, afin que l’animal ne bouge pas pendant l’opération.
L.V.D.C. : Ainsi, existait-il des liens entre la médecine ‘générale’ et la médecine vétérinaire ?
V.G.R. : Les maladies et les traitements du cheval trouvent des parallèles dans les traités médicaux humains, surtout ceux du corpus hippocratique. Aristote, et Pline l’Ancien après lui, estimaient que le cheval avait les mêmes maladies que l’homme. Il est donc fort probable que les traités médicaux aient été adaptés pour constituer la première médecine équine (que nous n’avons plus). La léthargie, par exemple, est recensée comme une maladie dans le corpus hippocratique ; on la retrouve dans Pélagonius. De même, le nom de podagra, qui désigne la goutte chez l’homme, a été appliqué à diverses maladies du pied du cheval. Cet anthropomorphisme s’est fait au prix de petites invraisemblances : dans les textes vétérinaires, les chevaux pleurent et gémissent de douleur (mais après tout, les chevaux d’Achille pleurent eux aussi, quand ils lui prédisent sa mort). On y décerne même l’influence des sectes médicales : certains sont empiriques (Pélagonius notamment), c’est-à-dire qu’ils font appel, pour justifier de la valeur d’un traitement, à l’expérience passée (« traitement éprouvé ») ; d’autres sont méthodiques, comme Chiron, et soignent les maladies du resserrement par la saignée, qui relâche les veines, les maladies du relâchement par la cautérisation (l’application du fer rouge pour brûler la partie malade). Cette dernière opération était toutefois beaucoup plus pratiquée sur les chevaux que sur les hommes : Chiron estime que la cautérisation a tant de force qu’elle ne peut être supportée que par un animal muet…
L.V.D.C. : D’une manière plus générale, on trouve de nombreux chevaux (ou des créatures hybrides) dans la culture et la mythologie gréco-romaine, tel Pégase ou le cheval de Troie : est-ce le signe d’une symbolique particulière attribuée à cet animal dans l’Antiquité ?
V.G.R. : Le cheval était en effet vecteur de multiples significations dans les mythes : la vitesse, qui se traduit par les ailes (Pégase), puisque il était, si l’on y réfléchit, le moyen de déplacement le plus rapide que possédait l’homme (60 km/h au galop) ; c’était la monture des rois et des héros ; il inquiétait aussi par son côté sauvage, comme en témoigne la légende des cavales anthropophages de Diomède dans le cycle d’Héraclès, et on se défiait particulièrement de ses morsures, en lui mettant une muselière (Xénophon le recommande). C’est en tant qu’animal tempêtueux et imprévisible qu’il était lié à Poséidon Hippios ; il est lui aussi un « ébranleur du sol ». À la frontière entre médecine et mythologie, on trouve la figure de Chiron, un centaure qui est le premier (dans les mythes) à répandre les connaissances médicales (c’est lui qui enseigne la médecine à Achille) ; c’est son nom qu’un vétérinaire latin choisit comme pseudonyme pour écrire le traité le plus complet d’hippiatrie (la Mulomedicina Chironis). L’Antiquité croyait à l’existence réelle des centaures : Pline affirme en avoir vu un de ses yeux, momifié, Galien estime nécessaire de réfuter la possibilité de leur existence. Cette proximité mythique entre le cheval et l’homme a dû faciliter le transfert de connaissances entre médecine humaine et médecine équine. Quant au cheval de Troie, il est à mi-chemin entre la symbolique du navire de guerre (construit en bois, contenant des guerriers, allant à l’assaut) et du sacrifice du cheval décrit par Dumézil et ses successeurs.
L.V.D.C. : Quant à la langue, Pélagonius Saloninus a-t-il un ‘style’ ? Des traits de langue reconnaissables entre tous ? Est-ce un auteur difficile à traduire ?
V.G.R. : La langue n’est pas syntaxiquement difficile à traduire (quoi qu’on trouve quelques accusatifs absolus qui surprennent un peu au premier abord), mais le sens des termes techniques n’est pas proposé par le Gaffiot, qui propose « espèce de plante » ou « maladie du cheval ». Il y a donc à faire une longue recherche lexicale pour chaque mot ; avec un peu de chance, le mot a été étudié dans un article scientifique, sinon il faut faire la recherche soi-même (et c’est ce que passent leur temps à faire les traducteurs des textes médicaux). Pour le style, la question est plus délicate. L’œuvre de Pélagonius est une collection de textes antérieurs (qui nous sont perdus) reproduits sans réécriture : voisinent donc des styles et des niveaux de langue différents selon les paragraphes. On décèle plusieurs strates : une tardive, du IVe siècle, notamment dans la préface, une autre qui date du début de l’Empire, et qui se signale par la recherche d’une langue châtiée et sans trop d’hellénismes, comme celle de Celse et de Columelle ; et des passages au lexique plus trivial, qui ne s’embarrassent pas de métaphore quand il faut évoquer crûment certaines réalités (ingrédients répugnants, pas de censure des termes anatomiques).
L.V.D.C. : Le lecteur moderne peut-être surpris de trouver, dans votre édition, des passages en grec au milieu du texte latin : est-ce lié à l’histoire du texte ?
V.G.R. : Le texte de Pélagonius nous est transmis dans les deux langues. Il est en effet traduit dans la Collection d’hippiatrie grecque (CHG), d’époque byzantine, qui réunit un certain nombre d’auteurs importants de la discipline. On peut ainsi, pour la majeure partie du texte, faire correspondre le latin et sa traduction grecque (et dans ce cas seul le texte latin est publié). Mais il existe des passages grecs qui n’ont pas de correspondant latin, ce qui laisse penser qu’une partie du texte latin a été perdue : et en effet, les manuscrits que nous avons sont tous incomplets, aucun ne donne le texte latin dans sa totalité. J’ai donc fait le choix d’intégrer ces paragraphes grecs dans les chapitres latins, afin de donner une idée plus complète de l’ensemble de l’œuvre.
L.V.D.C. : Pour finir, pensez-vous que certains des remèdes évoqués puissent être toujours utilisés ? Sont-ce là des « remèdes de grand-mère » ?
V.G.R. : La saignée et la cautérisation du cheval sont abandonnées par la médecine vétérinaire moderne, mais seulement depuis le vingtième siècle. Il n’est pas exclu que la saignée ait pu avoir une efficacité thérapeutique, en provoquant un choc entraînant la production de corticoïdes, qui ont un effet anti-inflammatoire. Certains ont voulu voir dans l’application d’excréments animaux sur les plaies une sorte de paléovaccination, dans la mesure où ces matières contiendraient des germes. On a cherché les propriétés des plantes recommandées dans telle ou telle composition, par exemple la ‘potion de quadrige’ donnée avant les courses, qui comprend un certain nombre de plantes cardio-toniques (réglisse, cannelle) : c’était une sorte de dopage. Mais la différence entre cette médecine et la nôtre est que ces recettes n’ont pas fait l’objet d’un protocole thérapeutique visant à vérifier leur efficacité et leur absence de nocivité… Il faut donc éviter, par exemple, de faire consommer au cheval des feuilles de buis et de ciguë, même pour tuer le démon qui se cache dans son corps.
Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel
Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon
