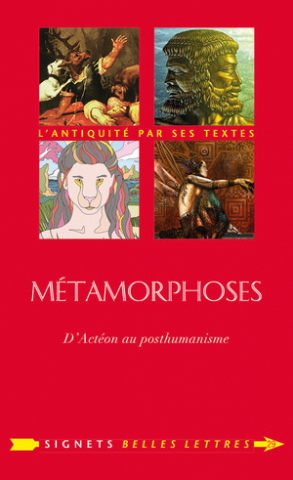
Cinéaste, metteur en scène, scénariste et romancier, Christophe Honoré a renouvelé le cinéma français des années 2000 avec des films souvent ancrés dans le Paris contemporain, mettant en scène de manière douce-amère le couple et la jeunesse, avec toujours un arrière-plan politique (Dans Paris, Les Chansons d’amour, Non ma fille, tu n’iras pas danser, Les Bien-aimés). Il a réuni autour de lui des acteurs dont il a contribué à assurer le succès : Louis Garrel, Chiara Mastroiani, Léa Seydoux, Ludivine Sagnier…
Christophe Honoré puise souvent son inspiration dans la littérature : Ma mère de George Bataille, La Princesse de Clèves (dont La Belle Personne est une adaptation libre), Les Caprices de Marianne de Musset (pour le scénario du film de Louis Garrel Les Deux Amis), Les Malheurs de Sophie. Au théâtre, il a notamment mis en scène Angelo, tyran de Padoue de Hugo, Les Bacchantes d’Euripide (Dionysos impuissant au Festival d’Avignon), conçu un spectacle sur les auteurs du Nouveau Roman, monté Così fan tutte au Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence. En 2014 est sorti son film Métamorphoses, remarquable transposition d’Ovide dans la France d’aujourd’hui.
Blanche Cerquiglini. – Le fil conducteur de votre film, à travers le personnage d’Europe, et bien d’autres personnages qu’elle rencontre en chemin, me semble être la question des âges de la vie : la transition, le passage d’un âge à l’autre. Poursuivez-vous avec Métamorphoses l’enquête que vous menez dans d’autres de vos films sur l’adolescence, cette période intermédiaire cruciale, où tous les choix sont possibles ?
Christophe Honoré. – Je n’envisage jamais la scénarisation des oeuvres littéraires comme une illustration. Je travaille plutôt comme les metteurs en scène de théâtre en offrant, plus qu’une adaptation, une lecture de l’oeuvre. Le personnage principal que j’ai retenu, Europe, est lui-même au stade de la métamorphose. L’adolescence est, dans notre vie, la période de la métamorphose : transformation physique, bien sûr, qui montre qu’on porte en soi un autre soi ; mais aussi en termes d’affranchissement. L’adolescence est ce moment où, parce qu’on a croisé quelqu’un, ou une oeuvre d’art, ou un ami, on se dit soudain qu’on va devenir autre ; on sent la possibilité de se dépasser. C’est ce que je lis dans Les Métamorphoses d’Ovide : la possibilité d’atteindre un autre état, pas totalement distinct de ce qu’on est, mais plutôt comme une nouvelle étape de son développement. C’est pourquoi j’ai choisi Europe comme fil conducteur, bien que ce ne soit pas, dans le film comme dans le livre, un personnage central.
D’autres considérations m’ont aussi poussé à faire ce choix : j’ai réalisé ce film au moment où l’on parlait beaucoup de la dette grecque, de la fermeture de l’Europe à la Turquie, du poids des pays du Sud qui tireraient l’Europe vers le bas… Il me semblait que la construction européenne se faisait en regardant vers le Nord. Or, d’un point de vue culturel, l’Europe, et notamment la France, est liée à la Méditerranée. Je trouvais qu’il était important de rappeler à l’Europe son passé, son passé plein de dieux grecs et latins. D’où l’idée de cette jeune fille ignorante qui, en tant qu’adolescente, peut prendre des directions différentes, et qui croise des dieux gréco-latins qui viennent lui rappeler d’où elle vient.
Enfin, le fait de choisir une jeune fille maghrébine pour incarner Europe est une manière de dire à cette jeunesse-là – et à cette comédienne-là, qui n’est pas une actrice professionnelle, comme tous les acteurs du film – qu’ils appartiennent à une culture méditerranéenne qui est en fait aussi européenne et que, bien loin d’être des étrangers, ils peuvent être fiers de représenter cette culture – n’oublions pas qu’Europe est dans la mythologie une princesse turque. C’était une manière de dire à ces acteurs, recrutés dans des castings de rue, que le cinéma pouvait s’intéresser à eux.
Rappeler tout cela a été le point de départ du film : l’adolescence ; les origines méditerranéennes de l’Europe et de ses habitants.
Bl. C. : Europe n’a pas peur de suivre Jupiter ; c’est plutôt pour elle l’échappatoire à un quotidien morose : « Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Je te kidnappe », lui dit Jupiter. « Tu me sauves », lui répond-elle. Là encore se pose la question du passage, de la transition : Europe va-t‑elle accepter de suivre Jupiter dans toutes ses pérégrinations ? Va-t‑elle lui faire confiance ? Sa curiosité sera-t‑elle punie ou récompensée ? Les acteurs devaient eux-mêmes vous faire confiance. Ils étaient tous dans la position d’Europe : vous suivre, vous croire.
Ch. H. – Oui, et croire à nos histoires. La réalisation de ce genre de film repose sur la croyance. D’ailleurs tout film est un système de croyance : il s’agit de réunir autour de soi des gens – les acteurs – à qui on fait croire à une histoire et à qui on demande de l’incarner. Ce qui est le principe des Métamorphoses d’Ovide, avec les lecteurs. On convoque une jeunesse qu’on confronte à des fables, et on fait en sorte que l’histoire passe à travers leur corps, à tel point qu’elle change leur corps. On pourrait même donner le prologue d’Ovide comme définition du cinéma : « les métamorphoses des formes en des corps nouveaux ».
On filme des gens pour en inventer d’autres. Filmer dans telle rue va permettre d’inventer une autre rue.
L’acte de filmer est un acte de métamorphose. Et aussi, d’ailleurs, un acte de condamnation. La métamorphose chez Ovide peut être punitive ; elle est le plus souvent brutale ; elle détruit une part de l’identité. Or filmer quelqu’un, c’est détruire une part de lui. De même qu’écrire sur quelqu’un – comme le rappelle Salinger, qui ne voulait pas écrire sur ses proches par crainte que cela les éloigne de lui ; ou comme ces cinéastes amoureux de leur actrice mais qui ne peuvent plus l’être une fois le film fini, car quelque chose a été détruit.
Bl. C. – Les métamorphoses se jouent entre humanité et animalité. Vous montrez la continuité entre hommes et bêtes, dieux et hommes, nature et civilisation. Vous envisagez le monde comme un grand Tout, un cosmos. Vous confronter à la question de l’irréalité était-il dans votre projet ?
Ch. H. – Oui, car le surnaturel fait partie du plaisir. Je savais que je n’arrivais pas avec les armes d’Hollywood, que je n’allais pas créer des images phénoménales ou spectaculaires. Je tenais à ce que le surnaturel advienne toujours de la manière la plus simple et la plus modeste possible. Il y a très peu d’effets spéciaux, qui sont tous des effets de tournage ou de montage (par exemple pour représenter
Argus et ses cent yeux). Le réalisme, pour moi, ne consiste pas à être vraisemblable mais à créer un réel qui échappe aux conventions. Avec le jeu, c’est pareil : j’ai choisi ces acteurs parce qu’ils avaient tous un phrasé particulier, assez peu naturaliste. Cela me semblait par exemple important que Tirésias soit joué par un écrivain (Rachid O.), dont je fais un pédiatre.
L’enjeu était donc de rendre compte des émotions ou des idées en les transformant en situations de fiction, par des choix de mise en scène et non par une simple illustration (cela n’aurait pas eu de sens de mettre Tirésias dans un bois…). Car c’est un film qui parie sur la croyance du spectateur : c’est lui qui construit l’image des dieux. Je crois être là assez proche d’Ovide : c’est la lecture qui crée le dieu.
Bl. C. – On a d’ailleurs assez peu de descriptions chez Ovide : on peut imaginer les dieux comme on veut.
Ch. H. – Oui, ce ne sont pas des dieux qui s’imposent à nous. J’aimais bien l’idée que ce soit des dieux perdus. Ils reviennent aujourd’hui, et plus personne ne croit en eux. Ils sont tous dans la situation de Bacchus, qui se plaint que les mortels refusent de croire en lui. Ce sont des dieux auxquels plus personne ne croit. Cette question de la perte de croyance était intéressante à mettre en scène. Jupiter n’est pas très impressionnant dans mon film : il a un physique de joli garçon qui peut plaire aux jeunes filles, il a un camion au début, mais il n’est en rien un superhéros. On pourrait très bien imaginer exactement le même scénario à Hollywood, et ce serait un film de superhéros – ce qui pourrait d’ailleurs être intéressant. Mais j’ai plutôt voulu reprendre la phrase de saint Paul : « Il faut faire croire à l’invisible par le visible. » C’était un bon principe de mise en scène.
Bl. C. – C’est fondamentalement la question de la fable qui est en jeu. Vous cherchez à mettre en scène, à animer, ce qu’est une fable : un récit qui semble incroyable et qui a pourtant des effets dans le réel. Quel statut accorder aux Métamorphoses d’Ovide ? Poème purement fantaisiste ou récit sur les origines de l’homme ? Là encore, on retrouve la question de la croyance : faut-il croire à ces histoires ? « Vous n’avez rien à craindre si vous ne croyez pas à nos histoires », dit Bacchus. Les Métamorphoses seraient-elles une ode à la fiction ?
Ch. H. – L’enjeu pour moi était en effet plus fort que la représentation du surnaturel. Europe est à un âge où elle a besoin de croire aux histoires. La phrase la plus importante est celle qu’elle écrit avec des galets sur le sable : « Je veux une histoire. » « Je veux vivre une histoire » : c’est ce qu’on veut quand on a 16 ans. On n’a peur que d’une chose, c’est qu’il ne nous arrive rien, qu’on ait une vie sans histoires (comme celle de nos parents, croit-on). L’idée était qu’elle croise des gens qui lui fassent vivre des histoires. Je voulais interroger le rapport entre crédulité, doute et soupçon. Au début, Europe prend Jupiter pour un illuminé, elle ne croit pas en lui. Et je voulais terminer le film autour du personnage d’Orphée, qui n’est pas un dieu mais plutôt un chef de secte, et qui, dans le film, prône un retour à un état primitif. J’aimais bien l’idée qu’Europe finisse dans cette bande orphique, qui aujourd’hui ne peut être que clandestine : des marginaux qui traînent et sont toujours chassés. C’est comme s’il n’y avait plus de place pour un surnaturel qui soit poétique et non pas prophétique. Le film parle en fait énormément d’aujourd’hui. Finalement, l’aller-retour entre un très lointain passé – ce texte d’Ovide qui a plus de 2 000 ans – et notre présent a produit le film le plus contemporain que j’aie fait.
Bl. C. – Qui parle finalement plus de politique que vos autres films.
Ch. H. – Beaucoup plus. Et pas uniquement en métaphore. C’est comme si j’étais allé chercher dans le passé une loupe pour regarder le présent. Et c’est la force de ces textes-là, et la force du mythe. Après-guerre, en France, on l’a beaucoup fait : Cocteau, Anouilh, Giraudoux… Il y a eu un retour du mythe qui permettait de parler du réel. Mais aujourd’hui le mythe a de nouveau disparu : on veut des histoires littérales, et pas mythologiques, surtout dans le cinéma (en littérature, quelqu’un comme Pascal Quignard continue à interroger ce qui fait mythe). Pourquoi un mythe – et parfois un mythe se réduit à trois phrases… –, pourquoi ces trois phrases racontent-elles soudain quelque chose sur le présent plus fort que n’importe quel documentaire ?
Bl. C. – Votre film oscille entre réalisme et irréalité. Vous montrez une nature enchantée et heureuse, gorgée de soleil, mais aussi mouvante, en perpétuelle évolution, propice à toutes les rencontres et féeries – comme l’illustrent les périphéries urbaines, ces non-lieux entre ville et campagne, espaces indéterminés où tout peut arriver. Est-ce aussi un portrait de la banlieue ?
Ch. H. – En préparant le film, je me suis demandé : où les dieux peuvent-ils réapparaître ? En les faisant surgir à Paris, j’avais peur de les transformer en anges gardiens, comme dans Les Ailes du désir de Wenders.
Dans Les Métamorphoses, la nature est trop importante pour être évacuée. Il faut qu’ils viennent errer à la frontière des villes, dans les zones périurbaines autrefois très investies par les industries mais qui, à cause de la situation économique, ont été abandonnés ; et où la nature reprend ses droits sur des vieilles voies ferrées, des entrepôts… On a construit des autoroutes mais en laissant la nature revenir. Je me suis dit qu’il y avait là quelque chose de la nature primitive, mythologique, qui est sous nos yeux mais qu’on ne voit plus. Il m’a semblé qu’il était intéressant de les faire revenir à ces endroits-là : non pas en pleine nature où ils seraient perdus, car ce sont toujours des dieux qui veulent avoir commerce avec les humains ; ils veulent les séduire, les capturer. Il ne faut pas non plus qu’ils soient en centre-ville mais qu’ils « zonent » dans des territoires de terrains vagues et de faits divers. On est donc allés dans le Sud, vers la Méditerranée, mais autour des villes – Nîmes, Marseille, Montpellier – pour explorer ces zones souvent abandonnées où vivent des populations délaissées. Je voulais ranimer ces lieux, par la jeunesse de mes acteurs, par la nudité, par une approche hédoniste et neuve de ces territoires qui sont en même temps souvent des lieux de prostitution – on s’y retire pour avoir des activités sexuelles clandestines. Ces dieux sont donc tous marginaux – dans une scène, je me suis amusé à leur faire faire la manche à la sortie d’une église, avec leurs chiens, comme les marginaux d’aujourd’hui.
Bl. C. – Au fur et à mesure, la nature s’anime et devient beaucoup plus belle, riante, ensoleillée, avec ces scènes de baignade… Chacun accepte sa nudité. Il règne une grande sensualité. C’est comme si les corps avaient une vie secrète, indépendante de l’âme, presque autonome.
Ch. H. – Les dieux ont rappelé à Europe son passé. Ils l’éloignent de la ville pour la remettre dans une espèce d’Éden, une nature sauvage où le rapport aux éléments est plus franc, plus sensuel. Ainsi, la comédienne, qui est le prototype de la beurette, est dépouillée du caractère sociologique qu’on a toujours tendance à plaquer sur ce genre de jeunesse de banlieue. Europe vit une métamorphose : la question n’est alors plus de savoir si elle a des parents algériens, si elle vit dans un HLM, si elle a des problèmes de scolarité. Débarrassée de toute forme de déterminisme social, elle redevient une simple figure de jeune femme, belle, sensuelle, innocente, au cœur de la nature.
C’est pour cela que j’aime beaucoup la dernière scène où, malgré le carnage des orphistes, elle attend Jupiter ; même si c’est une manière de se mettre hors de la vie, elle est prête à entrer dans la fable, à rentrer dans son histoire : à être Europe, la jeune fille enlevée par Jupiter. Comme chez Ovide : pour un mortel, le fait d’être, à un moment donné, en contact avec un dieu, s’apparente à une révélation – quelque chose qui le révèle à autre chose. Europe découvre une culture commune dont elle ignorait même l’existence.
Bl. C. – Cela nous ramène à la question politique, celle de la place de la Grèce, qui est un espace à la fois historiquement central et économiquement périphérique : une sorte de banlieue de l’Europe alors que, pour notre civilisation, elle en est le coeur.
Ch. H. – C’est tout le drame. Faute de pouvoir payer leur dette, les Grecs devraient sortir de l’Europe ? La violence envers la Grèce a été insensée. Alors que l’Europe lui doit tellement. J’ai été surpris qu’on ne mette pas cela plus en avant, au moment de ces débats. Certes la Grèce actuelle est un pays qui a saboté sa culture, ses sites historiques. Ce film était de l’ordre du geste d’amour. Ce film était de l’ordre du geste d’amour. Ce ne pouvait pas être un antidote contre les choses empoisonnées qu’on entendait à l’époque, mais malgré tout c’était un rappel de nos origines méditerranéennes. Je ne comprends pas comment on peut envisager l’Europe sans la Méditerranée. Pour toute personne qui a lu l’Iliade, l’Odyssée et Les Métamorphoses, il est impossible d’imaginer que l’Europe se fasse à partir de, disons, Poitiers. Car on a beaucoup plus été façonnés, surtout en tant que Français, par les récits turcs, maghrébins, grecs et latins que par les récits nordiques.
Bl. C. – Vous montrez que la mythologie est bien vivante : même s’ils peuvent sembler loin de nous, ces mythes sont en fait des histoires universelles et atemporelles, la matrice de bien des récits actuels, leurs sous-textes méconnus. En somme, notre culture et notre passé communs, notre héritage.
Ch. H. – Notre quotidien en est imprégné : qu’on en juge par les enseignes des magasins, Repaire de Bacchus et autres… Quand j’ai montré le film, les gens éprouvaient parfois de la méfiance face au côté culturel des Métamorphoses d’Ovide, mais ils finissaient par dire : « Ah, mais je la connais, cette histoire ! » Car ces histoires irriguent notre culture. Ce n’est d’ailleurs pas seulement une culture érudite mais une connaissance populaire. La renier comme on le fait quand on parle de l’Europe me semble insensé.
Bl. C. – Avez-vous projeté le film devant des élèves de collège ou de lycée ?
Ch. H. – Je me souviens que j’ai travaillé avec un groupe de jeunes qui a été très choqué, dans l’histoire d’Atalante, par la scène dans la mosquée, où Hippomène et Atalante font l’amour avant d’être transformés en lions. Certains élèves sont sortis de la salle parce qu’ils voyaient dans la scène la profanation d’un lieu sacré. Or c’est bien le problème soulevé par Ovide ! Hippomène et Atalante profanent un temple et en sont punis. Aujourd’hui, s’il y a bien un lieu où, surtout en tant qu’Occidental non musulman, on n’a pas le droit de poser un regard, c’est bien la mosquée.
C’était juste avant les attentats contre Charlie Hebdo, et cela m’a fait un peu peur. J’ai essayé de leur expliquer l’intérêt de la profanation dans l’art, en leur disant que l’artiste a le droit de tout interroger, et ils me répondaient : « Mais, monsieur, vous allez être puni. » Je leur ai expliqué que ce n’était pas une vraie mosquée, que ce n’était pas le réel mais une métaphore du réel, mais pour eux il y avait une littéralité dont ils ne pouvaient pas se dépêtrer. Cela les choquait profondément. Ils étaient prêts à accepter que les dieux forniquent, tuent, mais que ce lieu soit profané, non. Et c’est précisément le propos du film : le religieux aujourd’hui. Dans le film, on peut avoir l’impression que le sentiment religieux n’est pas pris au sérieux, notamment quand Bacchus se plaint d’être le dernier des dieux et réclame l’attention des mortels, car tout cela reste de l’ordre de la fable. Mais un simple tapis de prière dans un gymnase (là où on a tourné la scène) suffit à créer le scandale religieux. Cela pose beaucoup de questions sur la représentation au cinéma, la force d’un plan, et dit bien qu’on ne peut pas dégager le film de son contexte historique, du lieu et de l’époque où il est vu.
Bl. C. – Vous avez finalement montré le rapport très intime que nous entretenons avec les images, les légendes, les mythes – ce va-et-vient entre l’universel et le personnel.
Ch. H. – J’ai tenté avec ce film de cerner des figures, des modèles en mouvement. J’ai été soucieux de ne pas les enfermer dans un « costume » psychologique ou sociologique. Et, après de nombreux peintres, musiciens et écrivains, de les faire revivre dans une mosaïque de fables qui permet les interprétations les plus diverses – convaincu, comme l’écrivait Henry Bauchau, que « les mythes fondateurs ne naissent pas d’un effort intellectuel, mais des profondeurs de chacun ». Certains cinéastes savent représenter le monde tel qu’il est, moi je m’efforce de retrouver le monde tel que je l’ai lu.
Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel
Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon
